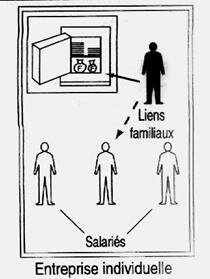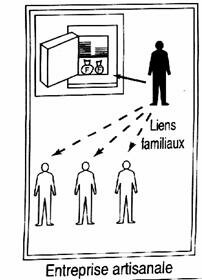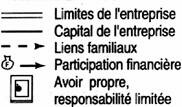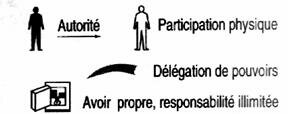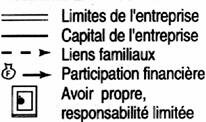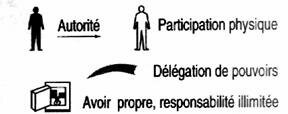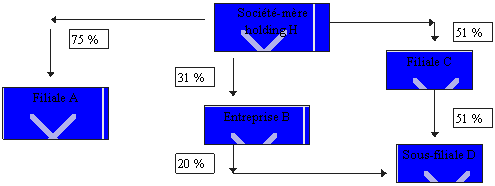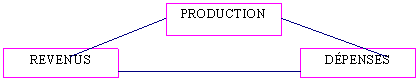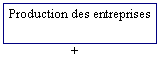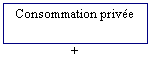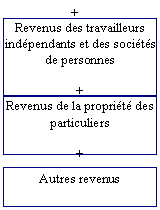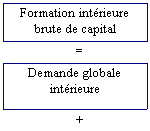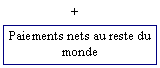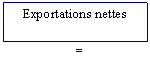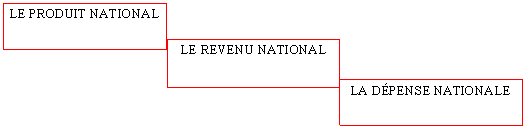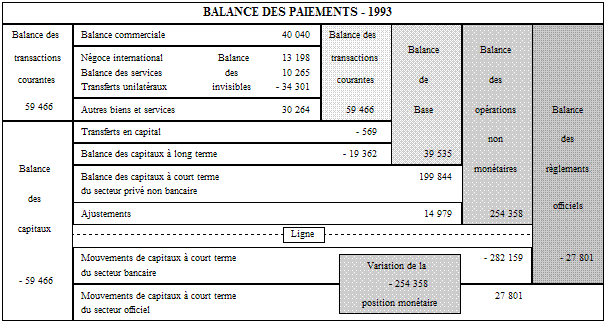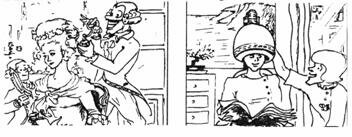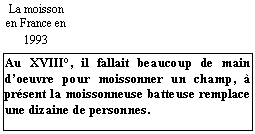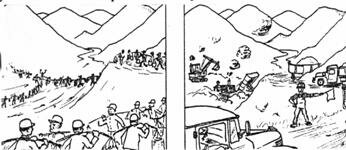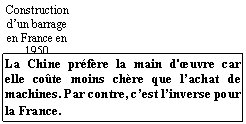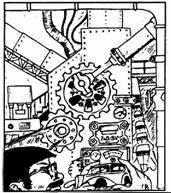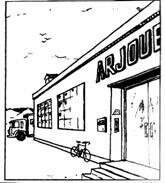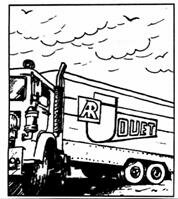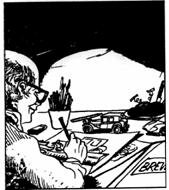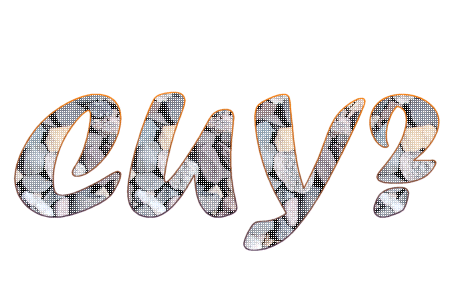♦ troisième étape : l'entreprise "Pacher" dans l'économie belge |
- comment est née l'entreprise "Pacher" ?
- l'avenir des entreprises belges
- l'exploitation des cousins Dupont
- l'évolution de l'agriculture belge
- comment une entreprise peut-elle progresser ?
- comment renouveler le capital ?
- suffit-il à une entreprise d'investir pour croître ?
Pour produire et ainsi pour satisfaire les besoins des Belges, il faut combiner le capital et le travail au sein des entreprises, telles que l'entreprise "Pacher" où travaille M. Van Vlees. Certains y ajoutent la nature.
I. comment est née l'entreprise "Pacher" ?
I. Avant la guerre de 1945, Auguste Pacher possédait un petit atelier de réparation de postes de radio. C'était un simple _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui travaillait avec un seul employé qu'on appelait _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Après la guerre, son fils, Jules Pacher, décida, grâce à la petite fortune que lui avait laissée son père, de fabriquer des postes de radio, les postes "Pacher". Au début, il n'eut qu'une vingtaine d'ouvriers qui assemblaient les pièces achetées à de grandes entreprises. À cette époque, ce n'était plus une entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c'était déjà une petite entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. Par la suite, l'entreprise Pacher continua de croître. Elle devint ainsi une importante maison de construction de postes à transistors. Son effectif atteignit bientôt 150 ouvriers : l'atelier était devenu une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L'entreprise "Pacher" était donc devenue une entreprise industrielle m_ _ _ _ _ _ _ _ , mais elle restait la propriété de Jules Pacher ; on parle à ce propos d'entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IV. Lorsque Jules Pacher voulut produire des postes de télévision, il dut envisager de construire de nouveaux bâtiments et d'acheter des équipements électroniques très onéreux. Sa fortune personnelle ne suffisait plus. Alors, il propose à des parents et à des amis qui lui faisaient confiance de les associer financièrement à l'édification de sa nouvelle entreprise. Ainsi fut créée la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pacher.
V. Il y a plusieurs manières d'associer des personnes pour créer une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Généralement, on divise la valeur du capital de l'entreprise en un certains nombres de parts égales. Le capital de certaines entreprises est ainsi divisé en plusieurs centaines de milliers de parts. Chacune des parts du capital de l'entreprise s'appelle une _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ces _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont vendues parfois à des personnes que le directeur connaît, mais le plus souvent, dans le public, à des personnes qui gardent l'anonymat ; c'est pourquoi, on appelle les sociétés ainsi constituées les sociétés _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ce procédé permet de rassembler les sommes considérables qui sont nécessaires à la croissance d'une entreprise moderne.
VI. Les propriétaires d' _ _ _ _ _ _ _ _ _ d'une S.A., qu'on appelle porteurs d'actions ou _ _ _ _ _ _ _ _ se réunissent en assemblée générale pour élire un Conseil d'Administration. Celui-ci nomme un ou plusieurs administrateurs-délégués et désignent un directeur. Si la société fait des bénéfices, on les partage entre tous les actionnaires. Le bénéfice qui revient à chaque action s'appelle le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VII. Ainsi, Jules Pacher créa une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au capital (financier) de 5 millions de francs, divisé en 1000 actions valant chacune 5000 BEF. Il en garda 510 et vendit toutes les autres. Comme chaque action donne droit à une voix dans l'assemblée générale. Il fut élu par le Conseil d'Administration directeur de la société anonyme Pacher.
VIII. La société Pacher grandit rapidement. Mais quand il fallut envisager la production de postes de télévision en couleur, Jules Pacher ne put trouver parmi ses parents et amis le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nécessaire pour l'achat du nouveau matériel nécessaire. Or, son entreprise n'était pas suffisamment importante pour vendre des actions dans le public. Il dut accepter qu'une grande entreprise, la firme Nyso souscrive à l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ du capital. Ainsi, en souscrivant à l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ du capital, cette firme a acquis la majorité des actions de la société "Pacher". Par cette opération, la société "Pacher" fut, en quelque sorte, affiliée à la firme Nyso, et en devint ainsi une simple _ _ _ _ _ _ _ _ . Jules Pacher conserva la direction de l'entreprise.
i) artisan, compagnon
ii) artisanale, industrielle
iii) usine moyenne familiale (individuelle)
iv) société
v) société action actions (sociétés) anonymes
vi) actions actionnaire dividende
vii) société anonyme
viii) capital augmentation augmentation filiale
relais
Pour construire de puissantes entreprises industrielles, parfois appelées firmes, et acheter le matériel nécessaire à leur fonctionnement, la richesse d'un individu ou même celle d'une famille est devenue insuffisante. Dans une économie moderne, la propriété individuelle et familiale a cédé la place à la propriété sociétaire. À l'origine, celle-ci était constituée par l'association de quelques personnes, mais il apparut rapidement que, pour rassembler des capitaux considérables, il fallait faire appel à une plus large catégorie de personnes. On a alors vendu sous forme d'actions, dans le public, une partie de la propriété du capital des entreprises. Le caractère anonyme de cette vente a fait appeler ce type de société, crée par la loi du $$$$, société anonyme. Dans une S.A., prennent les décisions importantes, les actionnaires lors de l'Assemblée Générale des actionnaires (A.G.), réunie au moins une fois par an. Les décisions plus "courantes" sont prises par le Conseil d'Administration, ou par un Administrateur délégué. Les sociétés (anonymes) ont été à la base de l'expansion industrielle de la Belgique et des pays occidentaux à économie moderne.
Par la suite, la propriété de certaines entreprises dont l'activité revêtait un caractère national (transport, énergie) fut transférée à l'État ; ce sont des entreprises nationalisées (S.N.C.B., S.A.B.E.N.A.). Notons que certains services publics, Belgacom par exemple, sont organisés comme des entreprises. Dans d'autres secteurs, l'État, sans supprimer la propriété privée, s'est associé aux intérêts privés pour soutenir ou contrôler certaines productions ; ces associations ont donné naissance aux sociétés d'économie mixte.
test de progression
Les sociétés représentaient en France et en 1975, 10,2 % du nombre total des entreprises industrielles et commerciales ; selon votre estimation, quelle est leur part :
dans l'ensemble des ventes des entreprises ?
dans l'ensemble des salaires distribués par celles‑ci ?
ventes : 20 % 45 % 60 % 75 % 90 %
salaires : 20 % 45 % 60 % 85 % 95 %
(Entourez les % qui vous paraissent justes).
Faites un schéma représentant les divers organes constitutifs d'une société anonyme, dont on a fait la connaissance.
II. l'avenir des entreprises belges
I. L'histoire de l'entreprise Pacher est imaginaire. Mais elle raconte l'évolution de nombreuses entreprises industrielles belges. Progressivement, celles-ci s'agrandissent et les plus grandes d'entre elles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ celles qui ne peuvent plus croître par leurs propres moyens. Peu à peu, une grande partie de la production est ainsi réalisée par un nombre restreint d'entreprises. On dit qu'il y a _ _ _ _ _ _ _ _ _ économique.
II. Combien y a-t-il d'entreprises françaises produisant des voitures ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. En France, les entreprises industrielles et commerciales faisant plus de 10 millions FRF de chiffre d'affaires (ventes d'une entreprise) ont réalisé en 1963, plus de _ _ _ _ _ _ % du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales, bien qu'elles ne représentent que _ _ _ _ _ % du nombre des entreprises.
IV. Les 100 premières firmes françaises avaient ensemble un chiffre d'affaires de _ _ _ _ _ _ _ _ _ milliards de francs français. En comparaison, la General Motors, première entreprise américaine au début des années 70, a un chiffre d'affaires de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FRF.
V. À la base de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ économique, sans pour autant être la cause unique, se trouve le p_ _ _ _ _ _ _ _ t_ _ _ _ _ _ _ _ En effet, pour acheter le capital nécessaire à la production moderne, il faut des _ _ _ _ _ _ _ _ de plus en plus considérables. De plus, les équipements modernes sont conçus pour une production en grande quantité, une production de _ _ _ _ _ _ _ _ qui implique de la part des industriels un approvisionnement de _ _ _ _ _ _ _ _ et des ventes en _ _ _ _ _ _ _ _ Pour ces raisons, seule une très grande entreprise sera capable de rassembler les capitaux considérables qui sont nécessaires à l'acquisition d'équipements modernes.
VI. La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ économique peut prendre plusieurs formes : une entreprise peut intégrer plusieurs stades de production. Ainsi, certaines entreprises étendent leurs activités depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la production de produits finis. On parle dans ce cas de concentration _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Par exemple, la firme Unilever réalise une importante partie du commerce mondial des corps gras. Elle possède ses propres plantations d'arachides, ses ports, sa compagnie de transport, de très nombreuses usines de transformations, des sociétés de publicité et de distribution, etc. Citez des productions de trust international :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VII. Une autre forme de concentration économique est réalisée lorsqu'un produit est fabriqué par un très petit nombre d'entreprises et parfois même par une seule. On parle dans ce cas de concentration _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Citez un cas de concentration _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que nous avons déjà rencontré : l'industrie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) absorbent concentration
ii) Peugeot, Citroën, Renault.
iii) 53,4% 0,5%
iv) 350 M FRF 179 M FRF
v) concentration progrès technique (exigeant des capitaux toujours plus importants) capitaux masse masse Importante
vi) concentration verticale
Ikea possède des forets, qu'elle fait exploiter pour avoir le bois qui lui permettra de fabriquer les meubles; $$$$
vii) horizontale horizontale automobile
relais
La concentration économique a profondément transformé la notion d'entreprise industrielle. Certes, la grande entreprise est comme toute entreprise agent économique qui combine du capital et du travail, afin de produire et vendre des biens et des services, mais elle n'a plus l'unité qui caractérisait la petite entreprise.
Une grande entreprise industrielle peut posséder des usines dispersées sur le territoire national ou dans d'autres parties du monde. Lorsque plusieurs usines appartiennent à une même société, chacune d'entre elles constitue un établissement. En outre, une grande entreprise peut posséder d'autres sociétés qui sont ses filiales. Certaines de ces filiales peuvent être communes à plusieurs sociétés. Au sujet de ces structures complexes, on parle souvent de groupes économiques.
La concentration économique ne supprime cependant pas les petites et moyennes entreprises car certaines productions ne peuvent pas être réalisées en série. Souvent, la grande entreprise, lorsqu'elle a besoin de telles productions, s'adresse à ces dernières, que l'on appelle des entreprises sous-traitantes.
test de progression
Définissez les notions suivantes :
entreprise : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
société anonyme : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
groupe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
entreprise familiale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
entreprise artisanale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III.l'exploitation des cousins Dupont
I. Le grand-père de M. Van Vlees était agriculteur. Il exploitait avec ses enfants une ferme de 12 hectares qui lui appartenait. C'était une exploitation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Sur cette exploitation, il cultivait du blé et du seigle qui lui procuraient de la farine et la paille dont il avait besoin à l'étable, des pommes de terre et des betteraves pour ses animaux ; sur les prairies naturelles, il faisait paître ses cinq vaches et ses deux boeufs. Il possédait aussi une trentaine de poulets et un grand jardin potager. Ainsi, à côté de son petit élevage, il pratiquait toutes sortes de cultures. Il se livrait donc à la p_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pour les travaux des champs, il avait recours à son attelage de boeufs. La m_ _ _ _ _ _ _ _ n'avait pas encore fait son apparition ; c'était l'époque de la traction _ _ _ _ _ _ _ _ Pour fertiliser les champs avant les semailles, il répandait le fumier que lui fournissait son bétail. Il utilisait un engrais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. Une grande partie de ce dont il avait besoin pour se nourrir était produite à la ferme. Il pratiquait donc très largement l'a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et n'avait pas besoin de vendre beaucoup de choses sur le marché pour en tirer des revenus. Il vivait donc presque en économie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IV. Une de ses filles épousa Ernest Dupont, le fils d'un fermier du voisinage. Ernest Dupont ne désirait pas exploiter la ferme de son père car celui-ci la louait à un propriétaire qui demandait un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ abusif et risquait de ne pas accepter le renouvellement du _ _ _ _ _ _ _ Le statut qui, maintenant, protège les _ _ _ _ _ _ _ _ _ n'existait pas encore et pour le jeune ménage Dupont, la _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la terre représentait la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ils reprirent la ferme des Van Vlees et payèrent d'ailleurs fort cher cette sécurité, car ils durent racheter leur part aux deux autres enfants du grand-père Van Vlees, qui étaient partis vivre en ville.
V. Lorsqu'ils moururent, il y a une vingtaine d'années, Jean Dupont, celui de leurs quatre enfants qui était resté à la terre avec son père, prit sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et il dut de nouveau racheter leur part à ses frères et sœurs partis à la ville.
Certes, ce fut moins difficile que pour ses parents, car une loi permet aujourd'hui, d'une part de tenir compte du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ effectué sur l'exploitation par un enfant qui est resté à la ferme, et d'autre part, d'échelonner le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur plusieurs années. Le système de l'héritage oblige malgré tout chaque génération à procéder à un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l'exploitation f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ agricole.
VI. Jean Dupont est un agriculteur qui veut aller de l'avant. Il a accentué encore les tendances amorcées par ses parents. Il a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ son exploitation dans l'élevage, une grande partie de ses terres ont été couvertes en prairies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec des plantes sélectionnées. Il a gardé cependant quelques hectares de terre nécessaires à la production de céréales pour son élevage. Il comprit rapidement que la _ _ _ _ _ _ _ _ _ de son exploitation était insuffisante.
Pour avoir un troupeau d'une trentaine de bêtes, il commença par accroître la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de son exploitation, agrandit l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , acheta un _ _ _ _ _ _ _ _ _ et une installation de traite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maintenant, l'exploitation Dupont est _ _ _ _ _ _ _ _ au marché et la terre ne constitue plus le principal _ _ _ _ _ _ _ _ de production ; à côté du capital foncier, le capital _ _ _ _ _ _ _ _ est devenu important.
VII. Cette ouverture au monde extérieur, Jean Dupont l'a réalisée en communauté avec d'autres, comme un grand nombre d'agriculteurs belges. Pour s'approvisionner, il s'est associé avec ses voisins en formant une _ _ _ _ _ _ _ _ qui achète tout ce dont ont besoin ses membres et peut ainsi obtenir de meilleurs prix. Aujourd'hui, 50 % de l'approvisionnement des exploitations agricoles belges est réalisé par l'intermédiaire de _ _ _ _ _ _ _ _ _ d'achat. De même, pour vendre son lait dans les meilleures conditions, il le livre à une _ _ _ _ _ _ _ _ _ laitière créée par tous les agriculteurs de la région.
VIII. L'achat de nouveaux terrains, d'un tracteur ou d'un appareil de traite automatique, la modernisation d'une étable nécessitent l'obtention de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ importants, car il n'est habituellement pas possible de les payer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Malheureusement, les banques prêtent peu à l'agriculture. Les agriculteurs ont réagi contre cet état de fait en se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et ont créé un crédit agricole _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ainsi, progressivement, Jean Dupont, à l'image de la plus grande partie des exploitants belges, s'est appuyé sur une série de services _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à plusieurs exploitations et qui ont généralement un caractère _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou mutualiste. C'est la transposition dans le monde moderne de la traditionnelle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pratiquée autrefois dans les communautés paysannes.
IX. Aujourd'hui, Jean Dupont s'apprête à faire un pas de plus dans l'extension de la solidarité qui le lie à ses voisins. Être éleveur est un métier très astreignant qui ne permet pas de prendre du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, car il faut tous les jours _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ les vaches et les nourrir. Certes, le matériel moderne est très efficace mais il coûte de plus en plus cher. Afin d'offrir à sa famille une vie comparable à celle que mènent les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , tout en garantissant une utilisation maximale du capital rassemblé, il vient de proposer à deux de ses voisins qu'il connaît bien de s' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ À trois, ils créeront ainsi une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ où chacun se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans une tâche et ainsi ils pourront prendre à tour de rôle du repos et des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ De plus, cette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ leur permettra d'acquérir des équipements modernes. Cette organisation pourra, en outre, éviter à leurs épouses de devoir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ leur mari dans les durs travaux de la terre.
i) familiale
ii)· polyculture mécanisation animale naturel
iii) autoconsommation fermée
iv) fermage bail fermiers propriété sécurité
v)· succession travail paiement rachat familiale
vi) spécialisé artificielles surface/superficie surface étable tracteur automatique ouverte facteur technique
vii) coopérative coopératives coopérative
viii) crédits comptant regroupement mutuel utiles / communs solidaire solidarité
ix) repos vacances traire citadins s'associer coopérative, de groupe spécialisera vacances association aider
relais
Jadis, la majorité des exploitations agricoles belges étaient des exploitations familiales, pratiquant la polyculture et vivant presque en économie fermée. L'autoconsommation était à la base de la vie des familles agricoles.
À cette époque, le fermier ne se nourrissait presque que de ce qu'il produisait ; on appelle cela l'autoconsommation, car le fermier est un producteur ; par contre, s'il "réparait" ses outils agricoles, ce serait un consommateur d'engins qui pratique l'autoproduction.
Aujourd'hui, les exploitations agricoles belges tendent progressivement à se spécialiser et sont désormais ouvertes largement au marché. Cette transformation s'accompagne au niveau des exploitations d'un agrandissement de leur superficie (du capital foncier), mais surtout d'un accroissement des équipements nécessaires à l'exploitation (capital d'exploitation ou capital technique). L'exploitation agricole actuelle tend à mieux s'organiser, et crée des coopératives qui s'insèrent dans toute une série de réseaux coopératifs qui lui permettent de se procurer des services et des biens aux meilleurs prix et d'écouler ses produits.
Certaines exploitations vont même actuellement plus loin et envisagent une agriculture de groupe qui leur permette de se spécialiser et d'avoir une vie familiale plus normale. Malheureusement, pour réaliser toutes ces opérations, il faut beaucoup de capitaux. Le crédit agricole mutuel leur en fournit sous forme de prêts. La charge de cet endettement est d'autant plus lourde que les lois sur l'héritage obligent les agriculteurs à racheter leurs exploitations à chaque génération. De plus, certains fermiers travaillent sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires ; ils doivent donc payer une location appelée fermage.
test de progression
Qu'est-ce qu'une coopérative agricole et quelles sont les raisons qui expliquent le développement de ces coopératives ?
Une coopérative agricole est une société groupant des agriculteurs afin de faciliter le développement de leurs exploitations.
L'exploitation agricole doit aujourd'hui s'insérer dans toute une série de réseaux coopératifs qui lui permettent de se procurer aux meilleurs prix les biens nécessaires à son fonctionnement (coopératives d'achat de matériel), de commercialiser sa production (coopératives de vente), et enfin de faciliter directement certains travaux agricoles (coopératives d'utilisation de matériel).
IV.l'évolution de l'agriculture belge
I. L'agriculture s'est donc_ _ _ _ _ _ _ _ _ au marché et s'est progressivement intégrée dans l'économie nationale. Parallèlement, il y a eu une _ _ _ _ _ _ _ _ _ très importante du nombre des agriculteurs.
II. Cette _ _ _ _ _ _ _ _ _ du nombre des agriculteurs va de pair avec un phénomène de _ _ _ _ _ _ _ _ _ des exploitations agricoles.
III. En fait, ce n'est pas le nombre des très g_ _ _ _ _ _ _ _ _ exploitations qui a beaucoup augmenté, mais celui des exploitations de type f_ _ _ _ _ _ _ _ _ Toutefois, depuis quelques années, les très g_ _ _ _ _ _ _ _ _ exploitations connaissent une augmentation assez forte notamment dans les régions peu peuplées du centre et du sud-ouest. Les exploitations agricoles f_ _ _ _ _ _ _ _ _ restent cependant la grande majorité des exploitations belges.
IV. Pensez-vous que toutes ces transformations aient permis à l'agriculture de maintenir ses positions dans l'économie belge ? Oui - Non.
V. Cette évolution est allée de pair avec une _ _ _ _ _ _ _ _ _ relative du revenu des agriculteurs. Le revenu d'un agriculteur qui représentait en moyenne 75% du revenu d'un citadin, ne représente plus aujourd'hui que 50%. La grande cause de cette _ _ _ _ _ _ _ _ _ rapide de la productivité agricole et la relative stagnation de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ des produits agricoles. Cela aboutit dans bien des secteurs de l'agriculture (blé, vin, lait, fruits) à une _ _ _ _ _ _ _ _ _ Certes, les très _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ exploitations, grâce à leur _ _ _ _ _ _ _ _ _ , parviennent à réaliser de larges bénéfices ; mais les petites, surtout lorsqu'elles ne se _ _ _ _ _ _ _ _ _ pas, connaissent de graves difficultés qu'accélère la _ _ _ _ _ _ _ _ _ agricole.
VI. Dans tous les pays du monde, cette situation oblige l'E_ _ _ _ _ à intervenir pour _ _ _ _ _ _ _ _ _ l'agriculture et faciliter les transformations au sein de ce secteur.
i) ouverte diminution
ii) diminution concentration
iii) grandes moyennes grandes familiales
iv) Non
v) diminution accroissement consommation surproduction grandes productivité regroupent surproduction
vi) État aider
relais
Les transformations de l'exploitation agricole ont entraîné un exode rural. Toutefois, la concentration des entreprises agricoles n'a pas abouti jusqu'ici à la disparition des entreprises familiales au profit des entreprises de type capitaliste. Les entreprises familiales moyennes restent dominantes. Ces dernières années, on constate dans les régions peu peuplées une rapide extension des très grandes exploitations.
L'ouverture au marché, la concentration, la modernisation, l'effort de solidarité ne s'accompagnent malheureusement pas toujours d'une amélioration sensible de la situation de l'agriculture. La productivité agricole augmente plus rapidement que la demande de produits agricoles : les besoins alimentaires étant maintenant en grande partie satisfaits, lorsque les revenus augmentent les Belges préfèrent accroître leurs achats de produits manufacturés et de services. Dans bien des secteurs de la production agricole, on aboutit actuellement à une situation de surproduction. De nombreux pays industrialisés connaissent ces problèmes et l'État doit y intervenir pour aider l'agriculture à lutter contre son appauvrissement relatif.
test de progression
Pourquoi peut-il y avoir surproduction de blé ?
La surproduction constatée pour un certain nombre de produits agricoles dont le blé provient d'une distorsion entre l'accroissement rapide de la productivité agricole et la consommation des produits agricoles qui ne s'accroît pas dans les mêmes proportions. Le soutien du prix du blé par l'État ne fait que perpétuer cette situation, car le soutien du prix du blé incite les agriculteurs à maintenir leur culture de blé. Par contre des mesures telles que les quotas agricoles, ou l'encouragement à la mise en jachères des terres ont l'effet inverse et permettent de sauvegarder les prix des produits agricoles... à l'avantage des fermiers.
V. comment une entreprise peut-elle progresser ?
I. Pour progresser, l'entreprise Pacher, comme l'exploitation des cousins Dupont, doit acheter des équipements nouveaux et faire construire des bâtiments neufs. Lorsqu'elle a pris la décision d'acheter ces biens de production et donc d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ son capital technique, elle a pris une décision d'i_ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Pour prendre la décision d'_ _ _ _ _ _ _ _ , il faut se procurer de l'argent. Or, ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de sommes très importantes. Tout âge a ses problèmes d'argent.
Ainsi, Hélène Van Vlees veut s'acheter une poupée qui coûte 500 BEF. Les 100 BEF mensuels que lui donnent ses parents sont donc insuffisants. Elle commence par casser sa tirelire, car chaque mois, sur les 100 BEF qu'elle reçoit, elle n'en a dépensé que 50 ; elle a donc fait des _ _ _ _ _ _ _ _, elle a épargné. Sa tirelire contient 350 BEF. Avec les 50 BEF du mois, elle possède en tout 400 BEF. Sa première source de financement est donc l'utilisation de ses _ _ _ _ _ _ _ _ propres.
Afin d'obtenir l'argent qui lui manque, elle s'adresse à son frère, lui demande de lui faire confiance et de lui prêter 50 BEF : elle fait un e_ _ _ _ _ _ _ _ Pour le remercier, elle lui promet de lui rendre son argent le mois prochain en ajoutant un canif qu'elle a trouvé et que son frère désirait posséder. Ce don sera sa manière de le remercier du service qu'il lui a rendu et de la confiance qu'il lui a faite. On dit d'ailleurs de celui qui prête, qu'il fait _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le canif sera en quelque sorte l'_ _ _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _ _ _ _ consenti par son frère.
Comme il lui manque encore 50 BEF, elle va les demander à son père qui subvient ainsi à son manque d'argent. Elle reçoit ainsi une s_ _ _ _ _ _ _ _ _ de 50 BEF.
III. De la même façon, pour financer des dépenses d'investissement, une entreprise peut employer dans des proportions fort diverses ses _ _ _ _ _ _ _ _ _ propres, des _ _ _ _ _ _ _ _ _ et des _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lorsqu'une entreprise se sert des bénéfices qu'elle a mis en réserve pour financer ses propres investissements, on dit qu'elle s'_ _ _ _ _ _ _ _ _ Avant de rechercher d'autres sources de financement, une entreprise tente toujours d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ un investissement.
IV. Une entreprise peut aussi emprunter à une banque. Lorsque des ménages et des entreprises ne veulent pas garder leur argent dans des placards ou des coffres, ils le _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans des banques. Avec ces _ _ _ _ _ _ _ _ _ , la banque peut faire des _ _ _ _ _ _ _ _ _ aux entreprises. On dit que la banque leur fait _ _ _ _ _ _ _ _ _
V. L'entreprise peut aussi faire directement appel à des ménages ou à des entreprises. Ainsi, pour augmenter son capital, la société Pacher a émis des _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les a vendues d'abord à des parents et amis de Jules Pacher, et par la suite, à la société Nyso. L'entreprise peut aussi n'effectuer qu'un emprunt. Lorsqu'il s'agit d'une société, celle-ci émet des obligations. Le porteur d'une obligation ne fait pas partie de la société, c'est un simple prêteur. Il n'a donc pas le droit de participer aux bénéfices de l'entreprise, mais uniquement de percevoir un _ _ _ _ _ _ _ _ _ Les achats d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ et d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ par les ménages représentent leurs placements. Les banques et les entreprises peuvent également réaliser des placements.
VI. L 'entreprise peut encore faire appel à l'État et lui demander un prêt ou une _ _ _ _ _ _ _ _ _
VII. Effectuons des évaluations ; en 1970, indiquez la part en pourcentage des divers modes de financement dans l'industrie :
Total Fonds publics Actions Obligations Autofinancement
100% 2,1% _ _ _ _ _% 3% _ _ _ _ _%
i) augmenter investissement
ii) investir économies ressources ou fonds emprunt crédit intérêt du prêt subvention
iii) ressources emprunts subventions autofinance autofinancer
iv) déposent dépôts prêts crédit
v) actions intérêt actions obligations
vi) subvention
vii) actions : 8% autofinancement : 73%
relais
Pour progresser, une entreprise a besoin d'investir. Le financement des investissements de l'entreprise peut être assuré : soit par l'épargne des particuliers qui ne consomment pas tout leur revenu et achètent des actions et des obligations et plus généralement déposent leur épargne dans des institutions financières (banques, caisses d'épargne, compte de chèques postaux) qui, à leur tour, font des crédits aux entreprises.
Tous ces flux transitent par les institutions financières ; soit par les propres réserves des entreprises qui leur permettent de réaliser un autofinancement ; soit par des crédits bancaires, fondés sur l'argent que déposent les ménages et les entreprises ; soit par l'aide de l'État, grâce à des subventions ou à des prêts publics qui transitent par les institutions financières ; par ailleurs, des étrangers peuvent aussi financer la création et le développement d'entreprises en Belgique.
Dans tous ces cas, les institutions financières (essentiellement les banques) servent d'intermédiaires.
En effet, grâce aux banques les ménages peuvent souscrire à des actions et à des obligations et c'est par elles que sont transmises les aides de l'État aux entreprises.
test de progression
VI. comment renouveler le capital ?
I. Une machine s'use et parfois elle est rapidement démodée, car une machine plus moderne est créée. M. Van Vlees en sait quelque chose avec sa voiture. Il vient d'acheter une automobile qui vaut neuve 600 000 BEF. Il compte l'utiliser pendant deux ans en faisant 25000 km par an ; après quoi, il la revendra avant qu'elle ne soit trop usée et que son entretien n'exige trop de réparations. Normalement dans deux ans, s'il vendait sa voiture au prix d'occasion actuel, celle-ci vaudrait 450 000 BEF. Or, comme de nouveaux modèles de voitures seront sortis, sa voiture subira une dépréciation plus importante (50 000 BEF) et d'autre part, il devra payer plus cher sa voiture neuve (50 000 BEF de plus). Combien M. Van Vlees doit-il mettre de côté chaque fois qu'il parcourt 1 km pour rassembler en deux ans la somme nécessaire à l'achat d'une voiture neuve (hors frais de carburant, d'assurance, d'entretien et autres) ? _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Quelles sont les fautes que M. Van Vlees pourrait commettre dans l'évaluation de la dépréciation de sa voiture ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. Pour son capital fixe, une entreprise se trouve dans une situation semblable à celle de M. Van Vlees face au renouvellement de sa voiture. Ainsi, l'entreprise où travaille M. Van Vlees a acheté une machine qui permet de fabriquer des circuits imprimés nécessaires au montage des postes de télévision. Elle vaut 10 000 000 BEF et on pense qu'elle servira à la fabrication de 100 000 postes de télévision. Il faut donc que le prix de chaque poste de télévision comprenne _ _ _ _ _ _ BEF pour permettre la constitution d'une réserve qui servira à l'achat d'une nouvelle machine, lorsque la machine actuelle sera usée.
IV. Cette opération de prélèvement d'une certaine somme sur le prix d'un produit afin de constituer une réserve qui servira à remplacer la machine lorsqu'elle sera usée s'appelle l'a_ _ _ _ _ _ _ _ _
V. Comme pour la voiture de M. Van Vlees, cette opération d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ est pour l'entreprise pleine de risques. Quels sont ces risques ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VI. Dans quels cas l'amortissement, au lieu d'aboutir à la simple mise en réserve de ce qui est nécessaire au rachat d'une machine neuve, permet-il de réaliser une accumulation de bénéfices ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) 5 BEF par km parcouru, uniquement pour pouvoir racheter un nouveau véhicule, sans compter les divers frais tels que taxes, assurances, essence, entretiens, réparations, etc... en effet, la voiture neuve qu'il souhaite acquérir coûtera : 600 000 + 50 000, soit 650 000 BEF. il pense revendre l'ancienne : 450 000 - 50 000, soit 400 000 BEF ; il lui faudrait donc rassembler une somme de 250 000 Bef au cours des 50 000 km à parcourir en deux ans, soit 5 BEF par km parcouru.
ii) mauvaise évaluation du prix de revente du véhicule, du nombre de kilomètres parcourus dans l'année, du prix d'achat de la nouvelle voiture...
iii) 100 BEF
iv) l'amortissement
v) amortissement diminution de la vente de téléviseurs, machine rapidement démodée, augmentation du prix de la future machine, apparition sur le marché d'une machine plus performante permettant de réduire les coûts unitaires, ou de produire plus...
vi) si l'on produit plus de pièces que prévus ; si le prix de la future machine est inférieur à celui prévu pour l'acquisition de celle-ci ; si l'on parvient à revendre l'ancienne machine à un prix supérieur à celui initialement prévu.
relais
L'amortissement intègre dans le prix d'un produit une somme qui permettra de renouveler les équipements existants quand ceux-ci seront usés ou démodés.
L'amortissement introduit une notion étroitement liée à celle d'investissement et à celle de risque, car amortir demande du temps.
Certes, l'entreprise s'efforce de prévoir. Ces dernières années, la prévision économique a fait de grands progrès. Toutefois, il est impossible d'avoir une connaissance précise de tous les facteurs qui déterminent un investissement.
Donc, les décisions d'investissement et d'amortissement qui se situent à la base de la croissance de l'entreprise comportent toujours des risques d'erreurs.
test de progression
À travers les paragraphes ci-dessus, lorsque l'entrepreneur prend une décision d'investissement, il encourt des risques. Pouvez-vous en citer ?
Si l'investissement consiste en l'achat d'une machine :
1. risque de voir cette machine dépassée par une autre.
2. risque de mévente de la production prévue.
3. risque de sous‑estimation de l'amortissement de la "nouvelle machine".
VII.suffit-il à une entreprise d'investir pour croître ?
I. On peut améliorer la _ _ _ _ _ _ _ _ _ du travail sans pour autant accroître le capital fixe dont dispose l'entreprise. Quels sont les facteurs d'amélioration de la productivité du travail que nous avons déjà cités et qui ne nécessitent pas un accroissement du capital fixe de l'entreprise ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui dépendent essentiellement de l'entreprise ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. Quels sont alors les facteurs qui ne dépendent pas nécessairement de l'entreprise ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IV. Ce n'est d'ailleurs pas seulement la productivité du travail qui peut être améliorée par des facteurs extérieurs à l'entreprise, c'est toute la prospérité, le développement de celle-ci. Parmi les facteurs extérieurs cités ci-dessous, soulignez ceux qui vous semblent influer sur le développement de l'entreprise :
-- un bon système routier,
-- des banques qui fonctionnent bien
-- un enseignement technique adapté
-- des chemins de fer rapides
-- un vaste réseau de transport d'énergie
-- des rues bien éclairées.
-- l'état sanitaire du pays
-- des piscines bien aménagés
-- le marché
-- des percepteurs faisant correctement rentrer les impôts
-- la qualité du réseau téléphonique
-- de grandes écoles permettant de former des ingénieurs compétents
-- l'efficacité des centres de recherches publics.
V. Parmi les éléments ci-dessus, lequel vous paraît plus important que les autres pour une entreprise ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) productivité meilleure organisation du travail, meilleure formation des travailleurs, qualité du réseau de communications, division du travail, amélioration des conditions du travail, qualité du réseau de distribution de l'énergie
ii) organisation du travail, amélioration des conditions du travail et à un moindre degré une meilleure formation des travailleurs (certaines entreprises se chargent elles‑mêmes de la formation et du perfectionnement de leurs employés et ouvriers).
iii) meilleure formation des travailleurs qualité du réseau de communications qualité du réseau de distribution de l'énergie
iv) toutes, même celles visant à faire payer les infrastructures collectives, ou celles que le secteur public prend en charge et qui ouvrent la voie aux innovations et aux progrès techniques du secteur privé.
v) le marché, sinon, à quoi servirait l'accroissement de la production ?
relais
Pour qu'une entreprise puisse se développer normalement, il lui faut non seulement avoir un marché, investir, améliorer la productivité des ouvriers, il faut encore que dans la nation existent de nombreux équipements (routes, ponts, voies ferrées, aérodromes, hôpitaux, écoles, réseau de distribution de l'énergie, téléphone, télex, ports, etc.). Ces équipements ne produisent pas directement des biens vendus sur le marché, mais ils sont indispensables à la production. On appelle ces équipements des infrastructures. Au sens restreint, le mot "infrastructure" s'applique uniquement aux équipements de transports, aux réseaux d'énergie et de télécommunications. On peut par extension l'appliquer à tous les équipements et activités extérieurs à la production, mais qui sont cependant indispensables à celle-ci.
Ainsi, dans un pays moderne, pour produire plus, il faut non seulement que les entreprises puissent rassembler de l'argent pour acheter des capitaux fixes, mais il faut aussi que l'État puisse financer et exécuter la mise en place des équipements extérieurs aux entreprises, indispensables au développement de celles-ci.
test de progression
Voici une entreprise fabriquant des fardes plastifiées, et s'implantant dans une zone industrielle. Établissez tous les "raccordements" aux infrastructures nécessaires et plus généralement aux équipements et services publics.
$$$$
1. Où installerais-tu les entreprises suivantes ? Explique :
a) un magasin de reproduction de photocopies.
b) un magasin de vêtements.
c) une usine de montage de voitures.
d) un atelier de réparation de machines agricoles.
Réponses :
a) dans un centre ville, un piétonnier, près des centres écoliers ou universitaires. Il faut être proche de la clientèle visée.
b) dans un piétonnier, dans une rue commerçante, dans un centre ville. Le magasin doit avoir une vitrine pour être remarqué et un parking.
c) dans un zoning industriel pour avoir l'espace suffisant, un terrain bon marché. Un réseau de communication doit exister pour faciliter le transport des matières premières et les marchandises.
d) près d'un centre agricole contenant beaucoup de fermes ou dans une zone rurale à accès facile. Ne pas oublier d'être à proximité de la clientèle.
2. Quels sont les autres éléments qui peuvent intervenir dans le choix d'un site d'implantation d'une entreprise ? Distingue trois cas :
a) l'entreprise commerciale.
b) l'entreprise industrielle.
c) l'entreprise agricole.
Réponses : a) l'entreprise commerciale : - facilité de parking.
- proximité de la clientèle.
- étendue de la zone géographique d'influence.
- etc.
b) l'entreprise industrielle : - approvisionnement facile en matières premières.
- bon réseau de communication.
- position centrale par rapport au marché.
- main d'oeuvre qualifiée à proximité.
- existence de terrains industriels à bon marché (zonings).
- règlements communaux (pollution)
- etc.
c) l'entreprise agricole : - sur le lieu de l'exploitation.
3. Outre le type d'entreprise quels sont d'autres critères de choix du type d'implantation ?
Réponses :
- le type de produit fabriqué et/ ou vendu
- le type de clientèle : jeunes, femmes, indépendants, entreprises,...
- la dimension du marché : local, régional, national,...
4. Recherche dans ce texte la justification des implantations de l'entreprise Alfred FLAMME.
En 1927, M. Alfred FLAMME (décédé en 1971) auparavant négociant en textiles, fonde un tissage avec l'aide de son fils, M. Simon FLAMME.
Il s'agit d'un établissement très modeste de 10 métiers à tisser, installés dans un ancien immeuble industriel à BASÈCLES (Hainaut).
On commence par y tisser des produits faciles - toiles, essuie-mains.
Malgré la crise très sévère qui a débuté bientôt après son installation, l'entreprise s'intéresse à des fabrications plus élaborées, (draps de lit avec inscription tissée, linge de table jacquard avec monogamme) destinées à la clientèle des Hôteliers et restaurateurs.
En 1935, on compte 40 métiers au moment où un incendie détruit la totalité de l'usine. Sans perdre de temps, de nouveaux bâtiments sont construits et des métiers sont installés. L'usine est remise en route en 1936.
En 1939, M. Simon FLAMME, officier de réserve d'artillerie est mobilisé. L'usine continue à tourner tant bien que mal, mais au début de 1941, elle est arrêtée par ordre de l'Autorité.
Elle ne reprendra son activité que dans le second semestre de 1945 lorsque M. Simon FLAMME terminant la guerre au 307e Corps anglais, est démobilisé.
Tout le personnel qui avait été formé avant la guerre avait disparu et une décision importante dû être prise. L'entreprise fut transférée à Mouscron dans un immeuble acheté à la firme UTEXBEL. A Mouscron, il y a du personnel disponible.
En 1950, on compte 60 métiers automatiques et un atelier de confection. L'effectif est de 46 personnes.
Après 1950, l'entreprise grandit; elle triple la surface bâtie.
En 1961, a lieu l'achat de FINTEX, l'usine voisine. Le personnel est repris et les locaux sont utilisés pour l'extension du tissage.
En 1970, reprise du fonds de commerce et du matériel au tissage Van De Vijvere à Tielt, entreprise spécialisée dans la fabrication d'étamine pour drapeau.
A cause de l'exiguité du marché intérieur, l'entreprise s'est spécialement intéressée au marché français tout proche et offrant de grandes possibilités. Pour faciliter et même permettre son implantation en France, l'entreprise a fondé sa propre société commerciale : la S.A. Française TAF à Tourcoing.
Enfin, le premier octobre 1981, notre S.A. Française TAF a pris en location-gérance libre, pour une période de 10 années avec faculté d'achat la S.A. Abadie Frères à Le Blanc Mesnil (Paris) qui est compté parmi les plus importantes firmes françaises dans le négoce de textiles pour l'Hôtellerie et la Restauration.
Voici une série d'articles mettant en évidence le choix de certaines entre prise de délocalisation... --Source : "Fiche Dossier emploi n°14", La Province du Jeudi 27 novembre 1997.
N O T I O N S A C Q U I S E S
| actions actionnaires amortissements autoconsommation autofinancement bénéfice capital d'exploitation capital foncier chef d'entreprise concentration économique coopérative crédit économie fermée |
économie ouverte emprunt entreprise artisanale entreprise industrielle établissement fermage filiale groupes économiques infrastructures intérêts investir obligations |
polyculture prêt public productivité réserve ressources propres risques sociétés sociétés anonymes société d'économie mixte sous-traitant subvention surproduction agricole |
I N F O R M A T I O N S
C O M P L É M E N T A I R E S
F O N C T I O N N E M E N T D E S E N T R E P R I S E S
♦ Introduction, objectifs et mots-clefs |
I. Sommaire
Les entreprises combinent travail et capital pour produire des richesses supplémentaires.
L'efficacité de la combinaison productive : productivité, progrès technique, innovation.
Le partage de la valeur ajoutée.
Les différentes formes juridiques
La comptabilité nationale.
II. Introduction
Il existe plusieurs façons d'étudier le fonctionnement des entreprises.
Un ingénieur nous dira par exemple, que pour produire une tonne d'acier, il est nécessaire d'employer des équipements tels que des hauts fourneaux, des matières premières comme le coke et le minerai de fer. II analysera la suite des opérations nécessaires et pourra énumérer les compétences et le nombre des membres du personnel requis pour aboutir au résultat souhaité.
L'économiste, à la différence de l'ingénieur, fait abstraction des détails techniques. Sans s'attarder sur l'aspect concret du produit (à la limite, peu lui importe qu'il s'agisse d'une tonne d'acier, d'un quintal de blé, ou d'un logiciel informatique...), il s'interroge sur sa valeur économique. Plus précisément, voici comment il aborde ce problème. Les hommes produisent des biens et des services au sein d'unités de production très diverses.
Dans cette étape, nous utiliserons comme critère de classification celui de la forme juridique des entreprises. Celui‑ci recoupe en effet bien souvent les principaux autres critères de différenciation tels que la taille, et les types d'activité. Ensuite, nous développerons la théorie de la comptabilité nationale, dont les bases ont été jetées lors de l'étape 1.
III.Mots-clefs
L'entreprise acquiert, sur des marchés particuliers, des facteurs de production : travail et capital (ce dernier comprenant les biens de production). Ces facteurs sont plus ou moins substituables ou complémentaires. Il s'agit donc de choisir la combinaison productive la plus efficace économiquement, c'est‑à‑dire la moins coûteuse.
Cet objectif de rentabilité l'amènera à calculer la production vendue ou chiffre d'affaires de l'entreprise, son prix de revient, sa valeur ajoutée, et son bénéfice qu'il s'agit de rendre maximal.
L'efficacité économique de l'entreprise se mesure non seulement à travers son bénéfice mais aussi par sa productivité (rapport entre la valeur ajoutée [la production] et la quantité des facteurs employés). Celle‑ci augmente notamment sous l'effet du progrès technique et de l'innovation.
Enfin la manière dont s'effectue le partage de la valeur ajoutée intéresse l'économiste. La valeur ajoutée représentant un accroissement de richesses, il paraît légitime qu'elle soit répartie entre tous les agents qui ont contribué à son apparition : ce sont les salariés qui, pour le travail fourni, touchent un salaire ; les actionnaires, qui se partagent une partie du profit en contrepartie du capital qu'ils ont avancé ; l'État, qui prélève un impôt sur le bénéfice. L'entreprise enfin, conserve une partie du profit, pour payer les intérêts des emprunts qu'elle a contractés et pour investir.
Nous définirons les formes juridiques des entreprises et nous dresserons le tableau comparatif des principales d'entre elles. Puis nous examinerons brièvement les entreprises individuelles, sous leur forme traditionnelle ou sous celle, plus récente mais de forme commerciale, des S.P.R.L.U. (entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée).
Nous étudierons ensuite Les différentes formes juridiques des sociétés :
‑ Une première distinction sera opérée entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux.
‑ Parmi ces dernières, nous étudierons la S.P.R.L. (société privée à responsabilité limitée), mais ce sera surtout la S.A. (société anonyme) qui retiendra notre attention. Nous en étudierons les principes de fonctionnement à travers :
· le rôle joué par les différentes instances dirigeantes : l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration, le P.‑D.(G.),
· les modalités de financement des investissements : recours à l'autofinancement et, pour les plus importantes sociétés anonymes, à la Bourse,
· les structures des groupes : sociétés‑mères et filiales, holdings,
· les firmes multinationales.
‑ Nous étudierons enfin les sociétés coopératives qui sont régies par des principes particuliers.
· Nous nous intéresserons également aux facteurs très divers qui sont à l'origine des entreprises publiques et des entreprises mixtes.
· II sera enfin question des administrations qui, par rapport aux entreprises, présentent la particularité de fournir des services non‑marchands.
Les entreprises et sociétés sont à l'origine de l'enrichissement de la Belgique. Comment se mesure ce gâteau de la prospérité ? Quelle en est sa croissance nominale et sa croissance réelle ? "Le P.I.B. de la Belgique a atteint 1507 milliards en 1986, alors que la même année, General Motors avait un C.A. de 5050 milliards de BEF", "Les investissements belges ont diminué cette année 1996 de 2,1 %"...L'information économique amène régulièrement sa moisson de chiffres, mais comment sont-ils calculés ? Comment s'assurer de la cohérence de toutes ces informations relatives aux P.I.B ; P.I.B. par habitant, P.N.B., Revenu National, balance commerciale, épargne brute et autres ?
♦ Les entreprises combinent travail et capital pour produire des richesses supplémentaires |
- La production et ses raisons d'être
- Les facteurs de production, leur combinaison, leurs caractéristiques
- La combinaison des facteurs de production
- La valeur ajoutée, résultat de la combinaison productive
- Une idée méthodologique de Sophie Baix (promotion 98)
- Une leçon préparée de Yves De Boe (promotion 98)
- Une leçon préparée de Sophie Dohy (promotion 98)
I. La production et ses raisons d'être
A. Pourquoi l'entreprise produit-elle ?
1. Exemples
· Monsieur De Haene a soif ; sa soif déclenchera un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; il désire boire un verre de bière.
· Mademoiselle Jacquard a froid ; cette sensation de froid déclenche un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; elle s'achètera un tricot de laine.
· Monsieur É.Tudian a beaucoup travaillé et souhaite se détendre ; ce souhait devient pour lui un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; il allume sa télévision.
· Il est 15h et il n'a pas dîné, M. VdK a faim ; sa faim déclenchera un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; il va manger son pique-nique (tartine).
à Je me promène en forêt, j'ai soif et bois à la source.
à J'ai froid, je commence à courir pour me réchauffer.
à J'ai besoin de me détendre, je me balade dans le bois.
à J'ai faim dans le bois, je mange des myrtilles, mûres ou framboises sauvages.
2. Questions et réponses
Bière, tricot, télévision, tartine sont des _ _ _ _ _
Que doit-on faire pour les obtenir ?
Pourquoi ces individus se sont-ils procuré ces biens ?
Quelle est donc une des raisons de la production ?
Peut-on satisfaire certains besoins sans qu'il n'y ait de production ?
B. Les matières premières ?
1. Exemples
· Pour faire de la bière, il faut utiliser du houblon, de l'eau, des ferments, du sucre, ...
· Pour faire un tricot de laine, il faut de la laine.
· Pour faire une télévision, il faut du plastique, du verre, du cuivre, etc.
· Pour faire une tartine, donc du pain, il faut de la farine, de l'eau, des œufs, de la levure, du sel....
2. Questions et réponses
Les matériaux ou produits qui servent de base à la fabrication d'un produit fini sont des_ _ _ _ _ _ _ _ .
Que vaut (environ) chacun des produits des exemples ci-dessus ?
Que valent (environ) ensemble, les produits qui servent de base à la fabrication de chacun des biens mentionnés dans les exemples ci-dessus , c-à-d les matières premières ?
Quel(s) est (sont) le(s) bien(s) qui vaut (valent) le plus, le produit fini ou l'ensemble de ses matières premières ?
Pour produire, il faut _ _ _ _ _ _ _ _ de la valeur à un ensemble de matières premières.
C. Qu'est-ce que produire ?
Production : activité économique consistant à créer des biens ou des services ou visant à ajouter une valeur à un bien.
Cette définition souffre de faiblesses illustrées par les exemples suivants :
à la mère de famille qui cuisine, fait le ménage, le père de famille qui répare, cultive son potager ;
à le bénévole qui distribue des repas aux S.D.F.
à le fermier qui cultive ses betteraves pour engraisser son bétail
Deux éléments, mutuellement substituables, doivent compléter cette définition :
à Les biens (services) produits doivent s'échanger sur un marché ;
à Les biens (services) produits doivent résulter d'un travail rémunéré
|
Idée méthodologique : Vous pouvez par exemple reprendre les mots d'une définition (dans le désordre) et demander de reconstruire la définition. |
Pour la Comptabilité nationale, la production est l'activité économique socialement organisée consistant à créer des biens ou des services s'échangeant habituellement sur le marché ou obtenus à partir des facteurs de production s'échangeant sur le marché.
D. Que produire : biens de consommation, de production ?
Nous reproduisons ici ce que l'on trouve dans des livres destinés [1] à l'enseignement : le sens critique du lecteur décèlera l'aspect incorrect des définitions qui y sont données :
"L'entreprise HDB à Verviers produit des machines-outils qui serviront à traiter la laine ; grâce à ces machines, HDB permettra à d'autres entreprises de travailler la laine. Ces machines sont des biens de production. Le bien de production est celui qui permet d'obtenir un autre bien. L'entreprise Materne produit de la confiture d'abricots. Cette confiture sera directement consommée et ne subira aucune transformation. La confiture sera un bien de consommation. Le bien de consommation est celui qui peut être utilisé tel quel. (sic!)."
À quelle définition proposée ici (et incorrecte) correspondent les biens suivants :
· l'œuf que j'achète au marché ? (dois-je le gober ?)
· le steak acheté chez mon boucher ? (dois-je le manger cru ?)
· le mazout utilisé par le tracteur du fermier ? (doit-il le transformer ?)
· le maillet du carreleur ? etc.
Nous préférons les définitions suivantes : "Le bien de production est celui qui permet à une entreprise d'obtenir un autre bien pour y ajouter une valeur et le relancer dans le circuit économique. Le bien de consommation (finale) est celui qui permet au ménage, qui peut être utilisé par le ménage pour satisfaire un besoin personnel." Nous préciserons ces notions plus loin dans cette étape (cf. "l'entreprise achète des facteurs de productions sur le marché"). Certains auteurs défendent le point de vue qu'un bien, quel qu'il soit, répond à un besoin personnel, et est donc un bien de consommation ; nous regrettons cette approche, car tous les biens de production deviennent alors des biens de consommation (intermédiaire).
Exemples :
· Sont des biens de production : l'appareil photo pour le journaliste reporter, le four pour le boulanger, la farine utilisée par le boulanger ;
· Ne sont pas des biens de production : le four utilisé par la mère de famille, la farine utilisée en cuisine par celle-ci ;
· Sont des biens de consommation finale : le steak acheté par la ménagère, la farine utilisée par la ménagère pour faire une tarte, l'appareil photo utilisé à l'occasion de fêtes familiales ou de vacances ;
· Ne sont pas des biens de consommation finale : le beurre utilisé dans la cuisine d'un restaurateur, le mazout acheté par le fermier pour faire rouler son tracteur ;
E. Produire, autoconsommer ou autoproduire ?
La culture d'un potager par un enseignant ne conduit pas à une production, puisqu'elle est destinée à une autoconsommation, ce travail est une autoproduction ; de même, la cuisinière qui cuit ses œufs ou qui cuit son pain, effectue un travail non productif, elle autoproduit. Pour l'agent économique dont la principale fonction est de consommer, l' autoproduction est une activité non économique consistant à créer des biens ou des services ne s'échangeant pas sur le marché ou obtenus à partir des facteurs de production ne s'échangeant pas sur le marché.
La culture de betteraves par un fermier afin de nourrir son bétail ne conduit pas à une production, puisqu'elle est destinée à une autoconsommation ; de même, le restaurateur qui mange un plat qu'il a préparé, a effectué un travail non productif, il autoconsomme. Pour l'agent économique dont la principale fonction est de produire, l' autoconsommation est une activité non économique consistant à détruire des biens ou des services ne s'échangeant pas sur le marché ou obtenus à partir des facteurs de production ne s'échangeant pas sur le marché.
Nous déplorons que beaucoup d'ouvrages utilisés dans l'enseignement (et ailleurs) ne fassent pas cette distinction. Selon les définitions apportées, la solution d'un exercice tel que celui-ci donnera des réponses différentes :
Y a-t-il production ou non ?
à Je cueille des raisins que je transforme en vin ; NON, si je ne revends rien
à Je cuis mon pain ; idem
à Je cueille des pommes que je laisse traîner dans la remise ; idem
à Je cueille des pommes pour en faire une tarte ; idem
à Le pâtissier cueille des pommes pour en faire de la tarte ; OUI, s'il la revend
à Je cueille des pommes pour les donner (ou vendre) au pâtissier qui en fera de la tarte.
OUI, si je lui revends ; NON, si je les lui donne
F. Une proposition de Vanessa Caufriez (promotion 1998)
1. Construire un schéma représentant l'acte de production d'un bûcheron.
Réponse :
NATURE MAIN-D'OEUVRE
PRODUIRE
Produits semi-finis Produits finis
(troncs pour la scierie) (bûches pour le feu)
2. Quels sont les facteurs de production utilisés par le boulanger ?
Réponse :
Travail : le boulanger, les vendeuses, les apprentis,...
Capital :
- Biens de production durables : bâtiments, pétrin, batteur, broyeur, four, comptoir, frigo, ...
- Biens de production non durables
matières premières et produits semi-finis : farine, oeufs, lait, levure, eau,...
matières consommables : électricité, mazout, gaz,...
3. Où installerais-tu les entreprises suivantes ? Explique :
a) un magasin de reproduction de photocopies.
b) un magasin de vêtements.
c) une usine de montage de voitures.
d) un atelier de réparation de machines agricoles.
Réponses :
a) dans un centre ville, un piétonnier, près des centres écoliers ou universitaires. Il faut être proche de la clientèle visée.
b) dans un piétonnier, dans une rue commerçante, dans un centre ville. Le magasin doit avoir une vitrine pour être remarqué et un parking.
c) dans un zoning industriel pour avoir l'espace suffisant, un terrain bon marché. Un réseau de communication doit exister pour faciliter le transport des matières premières et les marchandises.
d) près d'un centre agricole contenant beaucoup de fermes ou dans une zone rurale à accès facile. Ne pas oublier d'être à proximité de la clientèle.
4. Quels sont les autres éléments qui peuvent intervenir dans le choix d'un site d'implantation d'une entreprise ? Distingue trois cas :
a) l'entreprise commerciale.
b) l'entreprise industrielle.
c) l'entreprise agricole.
Réponses : a) l'entreprise commerciale : - facilité de parking.
- proximité de la clientèle.
- étendue de la zone géographique d'influence.
- etc.
b) l'entreprise industrielle : - approvisionnement facile en matières première.
- bon réseau de communication.
- position centrale par rapport au marché.
- main d'oeuvre qualifiées à proximité.
- existence de terrains industriels à bon marché (zonings).
- règlements communaux (pollution)
- etc.
c) l'entreprise agricole : - sur le lieu de l'exploitation.
5. Outre le type d'entreprise quels sont d'autres critères de choix du type d'implantation ?
Réponses :
- le type de produit fabriqué et/ ou vendu
- le type de clientèle : jeunes, femmes, indépendants, entreprises,...
- la dimension du marché : local, régional, national,...
6. Recherche dans ce texte la justification des implantations de l'entreprise Alfred FLAMME.
En 1927, M. Alfred FLAMME (décédé en 1971) auparavant négociant en textiles, fonde un tissage avec l'aide de son fils, M. Simon FLAMME.
Il s'agit d'un établissement très modeste de 10 métiers à tisser, installés dans un ancien immeuble industriel à BASECLES (Hainaut).
On commence par y tisser des produits faciles - toiles, essuie-mains.
Malgré la crise très sévères qui a débuté bientôt après son installation, l'entreprise s'intéresse à des fabrications plus élaborées, (draps de lit avec inscription tissée, linge de table jacquard avec monogamme) destinées à la clientèle des Hôteliers et restaurateurs.
En 1935, on compte 40 métiers au moment où un incendie détruit la totalité de l'usine. Sans perdre de temps, de nouveaux bâtiments sont construits et des métiers sont installés. L'usine est remise en route en 1936.
En 1939, M. Simon FLAMME, officier de réserve d'artillerie est mobilisé. L'usine continue à tourner tant bien que mal, mais au début de 1941, elle est arrêtée par ordre de l'Autorité.
Elle ne reprendra son activité que dans le second semestre de 1945 lorsque M. Simon FLAMME terminant la guerre au 307e Corps anglais, est démobilisé.
Tout le personnel qui avait été formé avant la guerre était disparu et une décision importante dû être prise. L'entreprise fut transférée à Mouscron dans un immeuble acheté à la firme UTEXBEL. À Mouscron, il y a du personnel disponible.
En 1950, on compte 60 métiers automatiques et un atelier de confections. L'effectif est de 46 personnes.
Après 1950, l'entreprise grandit ; elle triple la surface bâtie.
En 1961, a lieu l'achat de FINTEX, l'usine voisine. Le personnel est repris et les locaux sont utilisés pour l'extension du tissage.
En 1970, reprise du fonds de commerce et du matériel au tissage Van De Vijvere à Tielt, entreprise spécialisée dans la fabrication d'étamine pour drapeau.
À cause de l'exiguité du marché intérieur, l'entreprise s'est spécialement intéressée au marché français tout proche et offrant de grandes possibilités. Pour faciliter et même permettre son implantation en France, l'entreprise a fondé sa propre société commerciale : la S.A. Française TAF à Tourcoing.
Enfin, le premier octobre 1981, notre S.A. Française TAF a pris en location-gérance libre, pour une période de 10 années avec faculté d'achat la S.A. Abadie Frères à Le Blanc Mesnil (Paris) qui est compté parmi les plus importantes firmes françaises dans le négoce de textiles pour l'Hôtellerie et la Restauration.
G. Les fonctions de l'entreprise
` PRODUIRE * l’entreprise industrielle
Son activité consiste à acheter des marchandises (matières premières) et des services et biens divers (ex : énergie) pour les transformer (au moyen de machines et de main-d'œuvre) en produits finis, afin de les vendre aux ménages consommateurs souvent indirectement.
` DISTRIBUER * l’entreprise commerciale de distribution
Elle a comme activité l’achat de biens et services à des producteurs en vue de les revendre (ou les louer) à des consommateurs moyennant un prix. Elle appartient au secteur tertiaire. Elle revend les marchandises telles quelles, sans les transformer (sauf parfois sous une autre présentation, avec un autre emballage).
L’activité de distribution vise à mettre en contact les producteurs et les consommateurs. Elle sert de trait d’union, d’intermédiaire entre la production et la consommation.
` FINANCER * L’entreprise de financement
Les entreprises et les ménages ne disposent pas toujours de ressources financières suffisantes pour répondre à leurs besoins. Dès lors, ces agents économiques peuvent faire appel à des sociétés de financement telles que : la Société Nationale du Crédit à l’Industrie (SNCI), la Caisse Nationale du Crédit Professionnel (CNCP), la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite (CGER) ou encore l’Institut du Crédit Agricole (INCA).
Ces institutions de crédit jouent un rôle d’intermédiaire. Elles reçoivent des placements des agents capables de financer et elles accordent des crédits aux agents qui ont besoin d’argent.
II. Les facteurs de production, leur combinaison, leurs caractéristiques
A. Qu'est‑ce qu'un facteur de production, une combinaison productive ?
facteurs de production : les éléments qui "entrent" [inputs] dans une unité de production, entreprise ou administration, pour qu'à sa "sortie" [outputs], une richesse supplémentaire apparaisse, sont appelés facteurs de production. [généralement la nature, le travail et le capital]
Entrent dans l'unité de production du travail ( aussi appelé capital humain) apporté par les salariés de tous les niveaux hiérarchiques, du simple manœuvre au cadre dirigeant, et du capital technique ( aussi appelé capital économique) sous la forme d’énergie, machines, bâtiments, etc.
Certains économistes distinguent le capital de la nature, sous forme de matières premières à l’état brut. Ils en parlent comme capital économique et non technique ; ils le justifient en rappelant que la nature est le cadre de l'activité économique et la source essentielle des richesses : le sol fertile donnera le blé qui permettra d'assouvir un besoin de nourriture ; un climat maritime permettra aux agriculteurs de moins arroser leur plantation ; un cours d'eau permettra le transport fluvial.... Si la nature influence l'activité économique, l'inverse est également vrai : le travail de l'homme peut influencer la nature. Par son travail, il peut drainer, irriguer, reboiser ; enrichir le sol par un choix d'engrais et de culture, percer des voies d'eau, sauvegarder et développer la faune et la flore, maîtriser certaines forces naturelles (éoliennes, barrages, plantations...)
Ces facteurs sont combinés dans des proportions diverses selon leur coût, leurs caractéristiques propres et le produit à fabriquer.
Combinaison productive : c'est l'opération qui consiste à utiliser dans l'unité de production une certaine quantité de capital et de travail pour obtenir un produit (bien ou service).
Par exemple, dans une usine d'automobiles, le travail des ouvriers, techniciens et cadres, se combine à des matières premières (acier, matières plastiques, caoutchouc...), pour fabriquer, sur toute une série de machines mues par l'électricité (presses, fours, robots de fraisage, de peinture, etc.), des automobiles.
De même, dans une administration, par exemple dans une Caisse d'assurance-maladie de la Sécurité sociale, le travail des employés sur des ordinateurs permet de produire un service : le traitement des feuilles de maladie des assurés sociaux grâce auquel ils sont remboursés de leurs dépenses de santé.
|
$$$$ ec |
Très schématiquement, comme nous l’avons déjà montré dans le schéma économique de base, le fonctionnement d'une unité de production (=Entreprise) peut donc se représenter ainsi :
B. La complexité des facteurs de production
1. Le facteur travail
|
$$$$ ec |
Travail : le travail est organisé dans des unités de production, entreprises et administrations, où les hommes mobilisent leurs capacités physiques et intellectuelles pour obtenir un produit - bien ou service - répondant à des besoins déterminés.
Travail : le travail est un effort conscient en vue de produire un bien ou un service (ce qui le différencie d'une activité ou d'une occupation).
Ainsi, par son travail, l'homme lutte contre la rareté. Pour que l'entreprise puisse produire, il faut non seulement un capital économique, encore faut-il de la main d'œuvre à laquelle on confiera un travail.
Voir étape 2, "Actifs, inactifs, chômage"
Pour qu'il y ait travail économique, il faut qu'il y ait (1) effort, (2) conscience et (3) productivité [donc production, donc revente, donc rémunération]
La diversité des formes de travail
‑ On oppose généralement le travail manuel[2] et le travail intellectuel [3]. Cependant dans bien des cas, et de plus en plus souvent, la distinction n'est pas aisée. De quelle nature est le travail d'un maçon, éboueur, charpentier, médecin, enseignant, mais aussi celui d'un conducteur de T.G.V., d'un pupitreur d'ordinateur, d’une secrétaire, d’un ouvrier sur machines à commandes numériques... manuelle ou intellectuelle, physique ou non ?
‑ Qu'il soit intellectuel ou manuel, le travail peut être plus ou moins qualifié. Le temps de formation est le critère principal de la qualification : un fraiseur, qui doit passer plusieurs années à apprendre son métier, sera dit qualifié alors qu'un O.S. (ouvrier spécialisé) ne le sera pas, car quelques jours ou quelques semaines suffisent à son apprentissage. À côté du temps de formation figurent aussi d'autres critères de qualification tels que la nature du poste de travail occupé et l'expérience du travailleur. Ainsi le régent reçoit une meilleure formation méthodologique que le licencié.
‑ D'autres distinctions sont opérées : l’échelle de Maslow fait une différence entre le travail de direction, le travail de recherche, le travail d'organisation, le travail d'exécution, etc. Attention de ne pas confondre cette échelle de Maslow avec celle du même auteur, mais relative à la hiérarchisation des besoins (cf. étape 1).
‑ Ces différentes sortes de travail peuvent elles‑mêmes s'effectuer sous forme de travail salarié ou non‑salarié encore appelé travail indépendant.
Lorsqu'on parle du "facteur travail", il importe de se rappeler qu'on simplifie considérablement une réalité complexe. Ceci pose un problème pratique : comment mesurer le travail effectué ?
La mesure du travail
Plusieurs procédés sont employés.
‑ On peut additionner le nombre de travailleurs qui participent à une certaine production .
On dira, par exemple , que tel produit est le résultat du travail de quatre personnes. Mais la mesure n'est pas précise, la quantité totale de travail effectué dépend en effet de la durée du travail de chacun.
n II faut alors mesurer le temps de travail.
n
Par exemple : 10 ouvriers ayant travaillé pendant 8 heures et 10 autres ayant travaillé pendant 6 heures ont effectué au total :
(10 x 8) + (10 x 6) = 140 heures de travail.
‑ Mais comment additionner des travaux s’ils sont de nature différente de travail ?
Peut‑on, par exemple, dire qu'une heure de travail d'un manœuvre plus une heure de travail d'un ouvrier qualifié représentent la même quantité de travail qu'une heure de travail d'un technicien plus une heure de travail d'un ingénieur (soit deux heures dans l'un et l'autre cas) ? Cela semble contestable car les travaux en question sont très différents, ce que traduit d'ailleurs en partie l'inégalité des rémunérations.
La solution qui est alors adoptée consiste à mesurer la quantité de travail par les salaires versés.
Si, dans l'entreprise, le manœuvre est payé 300 BEF de l'heure, l'ouvrier qualifié 450 BEF, le technicien 600 BEF et l'ingénieur 900 BEF, on considérera que le travail effectué par le technicien et l'ingénieur représente le double de celui qui est effectué dans le même temps par l'ouvrier et le manœuvre (respectivement 1500 BEF et 750 BEF).
2. Le capital
Le terme "capital" peut avoir aussi bien des sens différents :
‑ Il peut être synonyme de fortune ou de patrimoine (cf. étape 6 ).
‑ Le capital, nous venons de le voir, a aussi un sens juridique et comptable : c'est la somme d'argent que les actionnaires ont mis à la disposition de l'entreprise pour lui permettre de démarrer puis de se développer.
Dans ce qui suit, nous prendrons le mot "capital" dans un sens essentiellement technique.
Capital technique : le capital technique [4] est l'ensemble des moyens matériels non naturels (bâtiments, machines, certaines matières premières, énergie...) et immatériels (brevets, logiciels,...) qui permettent à l'entreprise de fonctionner.
Capital économique : l'ensemble des biens naturels ou techniques, matériels (terrains, bâtiments, machines, toutes les matières premières, énergie...) et immatériels (brevets, logiciels,...) mis à la disposition de l'entreprise.
Moyens matériels : les biens de production (comptes PCMN 23 à 27, 30 à 37 )
‑ Les terrains et bâtiments sur et dans lesquels l'entreprise fonctionne.
‑ Les biens d'équipements : comptes PCMN classe 2 : machines, ordinateurs, etc., qui permettent à l'entreprise de produire et d'être gérée.
‑ Les biens intermédiaires : comptes PCMN classe 3 au bilan, classe 6 pour les achats : matières premières, énergie, "demi‑produits" achetés par l'entreprise pour entrer dans la composition du produit qu'elle fabrique (par exemple, les freins, les phares, etc., d'une automobile).
Moyens immatériels (comptes PCMN 21 )
‑ Pour produire, l'entreprise utilise aussi des brevets, des procédés de fabrication, qui sont propriété de l'entreprise ou pour l'usage desquels elle paie des droits.
‑ Avec le développement de l'informatique et des procédés automatiques de fabrication et de gestion, elle utilise aussi des informations sous forme de logiciels plus ou moins perfectionnés et coûteux (comptes PCMN 26 pour ceux qui sont "matérialisables" ).
Les différentes formes de capital peuvent aussi se distinguer les unes des autres par leur durée d'utilisation. Deux modalités s'opposent : le capital technique peut être fixe, ou circulant.
Capital fixe : il sert plusieurs fois et doit rester dans l'entreprise pour que celle-ci puisse continuer à produire, comptablement parlant on le retrouve dans les immobilisés amortissables (pour la plupart), c'est le cas des machines par exemple.
Capital circulant : il disparaît dès sa première utilisation dans la production et fait l'objet d'une consommation intermédiaire ; comptablement, ces dépenses se notent dans les comptes de charge (cf. la distinction entre consommation finale et consommation intermédiaire), c'est le cas de l'énergie, des matières premières.
RETENONS
|
|
matériel |
immatériel |
|
capital fixe |
· biens d’équipement (outils, machines) · terrains · bâtiments |
· brevets, goodwill · savoir-faire (know-how) · logiciels |
|
capital circulant |
· matières premières, · consommables · énergie |
· services intermédiaires |
III. La combinaison des facteurs de production
A. L'entreprise achète les facteurs de production sur les marchés
Le travail est obtenu sur le marché du travail par l'embauche de travailleurs moyennant le versement de salaires. Le capital (sens comptable du mot) est obtenu sur le marché des capitaux par l'engagement des actionnaires / des épargnants moyennant le versement de dividendes / intérêts.
Le capital fixe fait l'objet d'un investissement, c'est‑à‑dire une dépense engagée pour plusieurs années, le temps que durera la machine, que le brevet sera utilisé, etc. Il est obtenu sur le marché des biens (de production) d'équipement.
Le capital circulant est en principe consommé dans l'année même de son achat (mais il peut aussi être stocké pour une durée plus longue). Il est obtenu sur le marché des biens (de production) intermédiaires.
Les facteurs de production peuvent être à la fois substituables et complémentaires.
1. Des facteurs substituables
Supposons que l'on puisse cultiver une même surface de terre en combinant de deux façons le travail et le capital :
Combinaison 1 : On utilise 2 machines et 3 travailleurs.
Combinaison 2 : On utilise 3 machines et 1 seul travailleur.
On dira que le travail et le capital sont substituables. En passant de la combinaison 1 à la combinaison 2, on substitue du capital à du travail (la machine remplace l'homme) ; en passant de la combinaison 2 à la combinaison 1, c'est l'inverse : c'est le travail qui se substitue au capital.
2. Des facteurs complémentaires
Dans la combinaison 2, on ne peut pas se passer du travailleur restant, car même dans les usines les plus automatisées subsistent quelques travailleurs pour surveiller, régler et entretenir les machines. La substituabilité des facteurs n'est donc pas totale.
Inversement, même dans les procédés de production les plus simples, un minimum de capital est nécessaire : le chasseur‑cueilleur du paléolithique disposait de quelques outils de pierre. Les facteurs de production sont donc également complémentaires.
Enfin, si la combinaison productive impose d'utiliser les facteurs dans une proportion fixe ou très peu variable, elle sera qualifiée de rigide. Inversement, si l'on peut substituer les facteurs de production dans des proportions importantes, la combinaison productive sera réputée souple ou flexible.
Substituabilité des facteurs : les facteurs de production sont dits substituables lorsque, dans la combinaison productive, le travail (des hommes) peut être remplacé par du capital (des machines), ou inversement.
Complémentarité des facteurs : les facteurs de production sont dits complémentaires, lorsqu'ils doivent être combinés dans un rapport fixe, ou peu variable.
Flexibilité de la combinaison productive : à des facteurs largement substituables correspond une combinaison productive dite souple, ou flexible.
Rigidité de la combinaison productive : une étroite complémentarité des facteurs de production implique une combinaison rigide.
B. Les facteurs de production coûtent : prix de revient et de vente
1. Le prix de revient
Avant de pouvoir calculer sa valeur ajoutée, l'entrepreneur doit connaître le(s) coût(s) de son produit. Ainsi, si "PizzaBraine" décide de confectionner des TriChoc, spécialité locale, elle devra tenir compte :
· du prix d'achat des matières premières (cf. comptabilité 60x)
· de la consommation en gaz, électricité, eau,...publicité, transports, emballages,... (cf. comptabilité 61x)
· du salaire du personnel (cf. comptabilité 62x)
· des amortissements du matériel (=usure du matériel nécessaire pour fabriquer et vendre le produit) (cf. comptabilité 63x)
Le prix de revient est le total des dépenses nécessaires pour la production d'un bien (ou service).
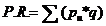
Pour 20 TriChoc, il nous faut :
|
200 gr 125 gr 75 gr 50 gr 100 gr 10 cl |
Petit Beurre beurre miel vrai cacao chocolat fondant crème fraîche |
300 BEF / kg 104 BEF / kg 160 BEF / kg 520 BEF / kg 280 BEF / kg 1000 BEF / kg |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
TOTAL |
MATIÈRES PREMIÈRES |
= |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
5 Kwh forfait 0,75 h |
énergie électrique amortissement main d'œuvre |
5 BEF / Kwh 5 BEF pour mémoire |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
TOTAL |
AUTRES COÛTS |
= |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
PRIX DE REVIENT |
= |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Rappelons que sauf dans le cas des non assujettis à la TVA, ces montants doivent être calculés hors TVA
Calculez le prix de revient de vos 20 "Trichoc".
PizzaBraine décide de faire des quiches lorraines ; pour cela, il lui faut : 1 paquet de pâte brisée, 100 g de lard fumé, 150 g de gruyère râpé, 3 œufs, 0,5 l de lait entier, poivre et sel, gaz et électricité, usure du matériel. Évaluez un prix de revient. Voir solutions page $$$$
Du point de vue comptable, rappelons que le prix de revient est repris dans les charges d'exploitation et que sont notés dans les comptes de charges 60 à 64, les montants des achats (hors T.V.A.) effectués pour rendre possible l'activité de l'entreprise, spécifiée dans ses statuts.
2. Le prix de vente
Un épicier revend des boîtes de petits pois au détail, sans transformation. Il leur donne une utilité plus grande car les consommateurs ne sauraient que faire d'une caisse de boîtes de petits pois (ou même une palette de caisses de...). Il ajoute donc une "marge bénéficiaire" au produit qu'il vend pour le service rendu aux consommateurs. De même, PizzaBraine qui transforme, revendra plus cher que son prix de revient.
Le prix de vente est la valeur d'origine d'un bien (ou d'un service) offert à la vente.
Du point de vue comptable, rappelons que la vente est un produit et que sont notés dans les comptes "Chiffres d'affaires" les montants des ventes (hors T.V.A.).
3. Bénéfice = valeur ajoutée ?
La valeur ajoutée est la différence entre le prix de vente des produits et leur prix de revient.
Cette valeur ajoutée peut se mesurée en valeur absolue (en BEF) ou en valeur relative (en pourcentage du prix de revient).
Du point de vue comptable, rappelons que le bénéfice d'exploitation est la différence entre tous les produits d'exploitation (60 à 64) et toutes les charges d'exploitation (70 à 74), et que seront notés dans les comptes d'affectation du résultat 69 (ou 79) la différence des produits (ventes) et des charges (achats hors T.V.A.), à laquelle on ajoute les bénéfices financiers et exceptionnels, et auxquels on retire la charge d'impôts.
Si vous voulez revendre vos Trichoc avec une marge bénéficiaire de 30 %, quel sera votre prix de vente unitaire ?
Si PizzaBraine veut revendre ses quiches à 264 BEF pièce, quelle serait sa marge bénéficiaire ?
Voir solution page $$$$
C. Comment les entreprises choisissent‑elles leurs combinaisons productives ?
Plusieurs éléments interviennent dans le choix d'une combinaison productive.
1. Les considérations techniques
II arrive que l'entreprise n'ait pas le choix parce que, techniquement, il y a un rapport fixe entre les quantités de facteurs ; la combinaison est donc totalement rigide. Par exemple, dans une entreprise de transports, il faut nécessairement un chauffeur par camion en circulation.
Cependant, même dans ce cas, la combinaison productive est plus souple qu'il n'y paraît à première vue. L'entrepreneur peut estimer judicieux d'avoir plus de camions que de chauffeurs pour remplacer les camions en panne. À moins qu'à l'inverse, il juge préférable d'avoir plus de chauffeurs que de camions pour que les chauffeurs se relaient sur de longs trajets ou pour remplacer sans difficulté les absents, les malades, ceux qui sont partis en congé, etc. De la sorte, le capital (le parc de camions) sera pleinement utilisé.
Ce sont alors des considérations économiques qui gouvernent les choix de l'entrepreneur.
2. Les considérations économiques
II s'agit essentiellement d'un problème de coûts de production.
Coûts de production, prix de revient : les coûts de production d'un produit sont constitués de toutes les dépenses en travail (salaires, cotisations sociales de l'employeur, etc.) et en capital (achat de machines, de matières premières et autres) supportées par l'entreprise ; on les appelle aussi prix de revient.
Ce qui intéresse avant tout une entreprise, c'est de faire le maximum de bénéfices, c'est‑à‑dire de rendre aussi grande que possible la différence entre ses ventes (ou chiffre d'affaires) et ses coûts de production.
Chiffre d'affaires, ventes : le chiffre d'affaires (ou les ventes) d'une entreprise, pour un produit donné, correspond au prix de vente du produit (p) multiplié par les quantités vendues (q)
Bénéfice = chiffre d'affaires ‑ coûts de production
Si, pour simplifier, nous supposons que l'entreprise ne peut pas augmenter le prix de vente de son produit (elle risque de perdre ses clients au profit de ses concurrents), elle n'a plus alors d'autre choix, pour augmenter son bénéfice, que de rendre ses coûts de production minimaux. II lui faut donc choisir la combinaison productive la meilleure : celle qui est la moins coûteuse, et pas forcément la plus perfectionnée techniquement.
Donc, dans les limites permises par les techniques disponibles, si le travail devient plus cher (les salaires s'élèvent) alors que le capital est meilleur marché (le prix des machines est stable ou baisse), l'entrepreneur substituera du capital au travail.
Inversement, on constate que, dans les pays où les salaires sont bas, les entreprises utilisent moins de machines et plus de travailleurs, la tendance est à la substitution du travail au capital.
Combinaison productive optimale : pour chaque niveau de salaire et de prix du capital, on peut déterminer une combinaison productive dont le coût est minimum et qui procure donc le bénéfice maximum. C'est pour l'entreprise, une combinaison dite optimale (la meilleure possible).
3. L'influence de l'échelle de production : les rendements d'échelle
Échelle de production : quantité produite par l'unité de production.
La question qui se pose est de savoir comment évoluent les coûts quand l'échelle de production augmente.
Prenons l'exemple d'une activité, celle du moulage de pièces en aluminium pour l'automobile. Considérons trois entreprises, les sociétés Héraklès, Vulcain et Prométhée, à l'équipement identique : des fours et des moules dont l'utilisation occasionne une dépense mensuelle de 1 000 000 BEF. (C'est, par exemple, le montant de la mensualité de remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat de ces équipements.). Que se passe‑t-il si l'échelle de production passe de 5 000 à 7 500 ou à 10 000 pièces par mois ?
Premier cas, l'exemple de l'entreprise Héraklès : la production augmente plus vite que les facteurs de production.
Chez Héraklès, entreprise très performante, la production de chaque pièce occasionne une dépense en énergie, matières premières et travail de 80 francs (ces coûts sont proportionnels aux quantités produites). Connaissant le coût mensuel d'utilisation des équipements (1 000 000 francs), nous pouvons calculer le prix de revient d'une pièce pour chaque échelle de production :
|
|
Dépenses par unité (en BEF) |
||
|
Production (en nombre de pièces) |
En matières premières, énergie, travail |
En capital fixe |
TOTAL |
|
5000 |
80 |
200 |
280 |
|
7500 |
80 |
133,3 |
213,3 |
|
10000 |
80 |
100 |
180 |
On constate que le coût de production d'une pièce diminue quand la quantité produite augmente.
Cette baisse du prix de revient est due, dans ce cas, à la diminution des dépenses unitaires en capital fixe : le quotient (dépenses en capital fixe/quantité produite) diminue puisque le numérateur est constant alors que le dénominateur augmente.
L'entreprise Héraklès est dans la meilleure des situations : elle connaît des rendements d'échelle croissants encore appelés économies d'échelle.
Deuxième cas, l'entreprise Vulcain : la production augmente au même rythme que les facteurs de production.
La fonderie Vulcain est moins bien organisée qu'Héraklès. On n'y réussit pas à maintenir constantes les dépenses par unité produite en énergie, matières premières et travail (quand l'échelle de la production augmente, on doit acheter les matières premières plus cher, il faut embaucher des spécialistes au prix fort, payer des heures supplémentaires à des taux majorés, etc.). On obtient alors le tableau suivant :
|
|
Dépenses par unité (en BEF) |
||
|
Production (en nombre de pièces) |
En matières premières, énergie, travail |
En capital fixe |
TOTAL |
|
5000 |
80 |
200 |
280 |
|
7500 |
146,7 |
133,3 |
280 |
|
10000 |
180 |
100 |
280 |
L'entreprise Vulcain doit se contenter d'obtenir des rendements d'échelle constants lorsque la production passe de 5 000 à 10 000 pièces.
Troisième cas, l'entreprise Prométhée : la production augmente moins vite que les quantités de facteurs utilisées.
La société Prométhée, quant à elle, éprouve des difficultés sérieuses pour augmenter la production : la planification des achats de matières premières n'est pas maîtrisée, les contrats d'approvisionnement en énergie ont été mal négociés, le personnel est mal géré, etc. Cette situation se reflète dans son tableau des coûts :
|
|
Dépenses par unité (en BEF) |
||
|
Production (en nombre de pièces) |
En matières premières, énergie, travail |
En capital fixe |
TOTAL |
|
5000 |
80 |
200 |
280 |
|
7500 |
160 |
133,3 |
293,3 |
|
10000 |
200 |
100 |
300 |
La société Prométhée connaît des rendements d'échelle décroissants, encore appelés déséconomies d'échelle.
|
Quand une entreprise accroît son échelle de production, 3 cas peuvent se produire :
1. Sa production augmente plus vite que les facteurs de production utilisés. Elle connaît des rendements d'échelle croissants ou des économies d'échelle. 2. Sa production augmente au même rythme que les facteurs utilisés. Elle connaît des rendements d'échelle constants. 3. Sa production augmente moins vite que les facteurs de production. L'entreprise subit des rendements d'échelle décroissants ou des déséconomies d'échelle. |
L'entreprise doit donc s'efforcer d'éviter les déséconomies d'échelle, et d'obtenir des rendements d'échelle constants ou mieux, croissants. En effet. les économies d échelle, en abaissant le prix de revient de chaque article, permettent à l'entreprise soit d'augmenter son bénéfice pour un prix de vente donné, soit d'abaisser son prix de vente, et d'élargir ainsi ses parts de marché aux dépens de ses concurrentes tout en satisfaisant davantage ses clients.
IV.La valeur ajoutée, résultat de la combinaison productive
A. Comment mesurer la production de l'entreprise ?
1. En volume ou en valeur ?
Si l'entreprise A vend cent mille stylos à vingt francs l'unité, son chiffre d'affaires est tout simplement : 100 000 x 20 = 2 000 000 francs. Sa production en volume est de 100 000 stylos ; sa production en valeur serait de 2 millions de francs.
La production en volume désigne une production désirée par des unités physiques. Si l'entreprise produit d'autres biens, il sera impossible de poursuivre la mesure de sa production en volume. Il faudra alors trouver une unité de mesure commune pour additionner des productions différentes.
La production en valeur permet de mesurer (en francs) le prix des différentes productions.
Si la production en valeur de notre entreprise de stylos augmente de 20 %, elle passerait donc de 2 à 2,4 M BEF, cela signifie-t-il que la production en volume a augmenté de 20 % également ? Ce serait le cas si le prix moyen d'un stylo restait le même. Par contre, si le prix moyen d'un stylo passe de 20 à 24 francs, la production en volume serait restée constante. On peut même rencontrer des situations où une augmentation de la production en volume va de paire avec une diminution de la production en valeur (Imaginez dès lors la baisse du prix moyen.).
Pour certains auteurs, la distinction production en valeur/production en volume correspond à la distinction production menée en valeur à des prix courants/ à des prix constants (et non en quantité physique).
2. Par le chiffre d'affaires
Comme nous l'avons vu, le chiffre d'affaires est le total des ventes de l'entreprise. Si l'entreprise A vend cent mille stylos à vingt francs l'unité, son chiffre d'affaires est tout simplement : 100 000 x 20 = 2 000 000 francs.
Cependant, le C.A. ne représente que la production qui est vendue. En effet, les ventes peuvent être très différente de la "fabrication" : existence d'invendus, formation de stocks dans l'entreprise, etc. Si le C.A. est un indicateur, il ne correspond pas forcément à la contribution économique de l'entreprise à la production nationale.
Mais ce chiffre d'affaires ne représente pas seulement la production de l'entreprise. En effet, pour produire ces stylos, l'entreprise a dû acheter à d'autres entreprises des matières premières, de l'énergie, des services divers, etc., en somme des consommations intermédiaires dont le prix est inclus dans le chiffre d'affaires. II convient donc, pour connaître la véritable contribution de l'entreprise A à sa propre production, de déduire les consommations intermédiaires du chiffre d'affaires, et de calculer sa valeur ajoutée.
3. Par la valeur ajoutée brute
La valeur ajoutée brute est égale à la production [5] moins les consommations intermédiaires :
V.A.B. = C.A. ‑ C.I
Supposons que l'entreprise de stylos ait acheté pour 600 000 francs de matières premières, d'électricité, de services divers. Sa valeur ajoutée est alors de :
2 000 000 ‑ 600 000 = 1 400 000 francs,
qui représentent l'activité propre de cette entreprise. Elle a transformé des matières plastiques, de l'acier, de l'électricité, etc., en stylos. En somme, elle a "ajouté" à ces 600 000 francs de consommations intermédiaires (qu'elle se procure auprès d'autres entreprises) une valeur de 1 400 000 francs.
La valeur ajoutée présente l'avantage d'éviter les doubles emplois, quand on additionne la production de plusieurs entreprises. L'exemple de la fabrique de stylos montre que si l'on additionnait son chiffre d'affaires avec ceux de l'usine de matières plastiques, de l'aciérie et de l'usine électrique, on compterait deux fois les matières plastiques, l'acier et l'électricité : une fois dans le chiffre d'affaires de la fabrique de stylos et une autre fois dans le chiffre d'affaires de chacun de ses fournisseurs de consommations intermédiaires. On dit que les valeurs ajoutées sont "agrégeables" (additionnables) alors que les chiffres d'affaires ne le sont pas. C'est ce qui permet de calculer le Produit Intérieur Brut (ou P.I.B.).
Produit Intérieur Brut (P.I.B.) : somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les unités de production présentes sur le territoire national, pendant une période fixée (généralement de un an).
La valeur ajoutée est généralement "brute", c'est‑à‑dire qu'elle inclut la valeur du capital fixe qui, par usure et incorporation dans le produit, a disparu au cours de la production. II est cependant possible de calculer la valeur ajoutée "nette", en déduisant l'amortissement du capital.
B. La notion d'amortissement
Supposons que les machines utilisées dans la production aient été achetées en début d'année 5 000 000 francs et que leur durée de vie soit estimée à 5 ans. On peut dire qu'en une année d'utilisation, elles perdent en moyenne 1/5e de leur valeur initiale, soit 1 000 000 francs. Cette somme représente l'amortissement annuel des machines. Plus précisément, il s'agit d'un amortissement "linéaire", c'est‑à‑dire identique à lui‑même d'année en année.
Pour remplacer les machines qui seront inutilisables au bout de cinq ans, l'entreprise doit constituer des provisions pour amortissements d'un montant de 1 M francs par an. Cette prise en charge de la perte de valeur annuelle est considérée comme "charge", "dotation aux amortissements.
Le tableau d'amortissement linéaire est le suivant :
|
Année |
Annuité d'amortissement |
Valeur résiduelle |
|
1 |
1 M |
4 M |
|
2 |
1 M |
3 M |
|
3 |
1 M |
2 M |
|
4 |
1 M |
1 M |
|
5 |
1 M |
0 |
|
Total amorti |
5 M |
|
Dans l'exemple que nous avons pris la valeur ajoutée nette de l'année considérée serait donc de : 1 400 000 ‑ 1 000 000 = 300 000 francs
Ce calcul paraît plus réaliste que le calcul de la valeur ajoutée brute, pourtant sa signification économique est, au niveau d'une entreprise, assez réduite.
En effet, les modes de calcul de l'amortissement sont très divers et assez arbitraires pour plusieurs raisons :
‑ la durée de vie des équipements est assez mal connue, surtout à l'avance : l'usure se constate après coup, elle se prévoit difficilement ;
‑ pour des raisons fiscales (l'amortissement n'est pas imposé), pour cette raison le calcul de l'amortissement est réglementé par l'État.
‑ En outre, à l'usure s'ajoute l'obsolescence du capital fixe, c'est‑à‑dire le fait que la machine soit dépassée par le progrès technique. Dans la mesure où les équipements plus avancés techniquement permettent aussi d'abaisser les coûts de production, les entreprises sont amenées à changer les équipements anciens avant même qu'ils ne soient usés.
Obsolescence, obsolète, obsolescent : un bien d'équipement est obsolète (ou obsolescent) s'il est concurrencé par des biens du même type plus avancés techniquement. L'obsolescence de son matériel oblige souvent l'entreprise à le renouveler avant même qu'il ne soit usé.
En supposant que la durée de vie des équipements soit parfaitement connue, on peut calculer l'amortissement de différentes manières : en reprenant notre exemple, on peut amortir le matériel sur cinq ans de manière non linéaire, soit en "accélérant" cet amortissement, soit en le rendant "progressif" (cf. cours de Comptabilité).
V. Une idée méthodologique de Sophie Baix (promotion 98)
|
Idée méthodologique : Pour commencer, je vais vous donner deux mises en situation sur la production. Par après, j’introduirai de plusieurs manières et je commencerai une partie d’une leçon sur la création d’une entreprise.
1° La production
♦ Je commencerai mon cours en passant une cassette vidéo que je créerai moi-même. Avant de passer la cassette, je leur demande : «Observez et comparez sur une feuille de brouillon ce que font les différentes personnes de la cassette». Je note au T.N. cette question. La cassette sera divisée en deux et montrera notamment :
Dans la 1ère partie - - une personne qui mange une tartine à la confiture car elle a faim ; - une personne qui part en voiture pour se rendre à un magasin à Charleroi ; - une personne qui a froid et pour cette raison, elle va chercher un pull en laine dans sa chambre ; - une personne qui allume la télévision pour se distraire. Dans la 2ème partie - une personne qui mange une pomme qu’il a pris de son pommier car il avait un peu faim ; - une personne qui va dehors au soleil pour bronzer car elle est tellement pâle qu’elle en devient complexée ; …
|
|
Idée méthodologique (suite) : (J’ai pensé à ces exemples grâce au livre Socio-Economie « La production » (page 2), F. Boulanger, De Boeck Wesmael, Bruxelles, 1994)
Cette séquence durera environ 5 minutes.
Après avoir visionné la 1ère partie de la cassette, je leur poserai oralement la question du T.N. Réponses attendues : A. Les différences Les personnes font toutes quelque chose de différent : l’une mange, l’une part en voiture, l’une regarde la télévision et une autre met un gros pull. B. Les points communs Toutes ces personnes font quelque chose car elles éprouvent une envie désagréable, un besoin. En effet, une a faim, une doit partir, une a froid, une veut se distraire. (Une personne a besoin de se distraire, …).
Donc, de manière générale, pour quelle raison ont-ils décidé de manger, partir, … ? Pour satisfaire leur besoin.
|
|
Idée méthodologique (suite) : Comment pourrions-nous appeler les choses telles qu’une tartine, une voiture, un pull, une télévision, … qui satisfont nos besoins ? Des biens, des produits
Nous allons à présent visionner la 2ème partie. Pour celle-ci, j’aimerais que vous preniez notes sur une feuille de brouillon pour répondre à la question suivante : Comparez les biens que les personnes utilisent dans la 1ère partie (pull, tartine, télévision et voiture) avec ceux de la 2ème partie.
Réponses attendues : Dans la 1ère partie, ce sont des produits fabriqués, que l’on ne trouve pas dans la nature. Dans la 2ème partie, ce sont des biens que l’on trouve dans la nature.
Bref, les biens fabriqués sont appelés des biens de production et les biens naturels sont les biens de non production.
Après les avoir définis, je leur donnerai un exercice. Je leur donnerais une feuille remplie de dessins. Ceux-ci représenteraient des biens de production et des biens de non production. Objectif principal : distinguer les biens de production et les biens de non production.
|
|
Idée méthodologique (suite) : Pour continuer les différentes sortes de biens (durables, …), nous reprendrons les exemples de la cassette.
Ceci termine la mise en situation et le début de la théorie. Cette cassette peut également être utilisée pour l’introduction d’une leçon sur le besoin.
♦ Pour introduire la production, je pourrais venir au cours avec un presse fruit et des oranges, des citrons. Je demanderai : Dans quels buts utiliserai-je un presse fruit ? Réponses attendues : pour se faire un jus d’orange, un jus de citron ; pour se faire de l’argent (le vendre) par exemple dans un café. Points communs : dans les deux cas, je satisfais un besoin. Les différences : dans le 1er cas, je vais gratuitement boire un jus d’orange ou l’offrir à quelqu’un ; dans le 2ème cas, je vend le jus d’orange à un client, ce qui signifie que le jus a pris de la valeur.
Bref, le jus que l’on boit gratuitement est un bien de non production mais le jus que l’on vend dans un café, restaurant, … est un bien de production.
En effet, un bien de production est un bien auquel on ajoute de la valeur et qui satisfait un besoin.
|
|
Idée méthodologique (suite) : 2° La création d’une entreprise
v Je me sers des pages 3 à 12 de la B.D. « Boule et Bill », édité par l’institut de l’entreprise asbl, 1985. Je ferai un montage de manière à ne plus avoir de définitions sur les feuilles.
Je diviserai l’histoire en trois parties. Chaque partie sera agrandie sur une grande feuille que je collerai au T.N. (une à la fois), de façon à ce que tous les élèves sachent lire mentalement et surtout regarder les dessins, ou alors j’utiliserai le rétroprojecteur. Chaque partie sera également photocopiée pour chaque lecteur. Un lecteur correspond à un personnage de la B.D. (car il est plus facile de lire une feuille que l’on a juste devant soi qu’un transparent ou une grande feuille mise assez loin de l’élève).
Après que les lecteurs aient lu oralement la B.D., je demande à quelqu’un : 1° de résumer (de nommer les étapes importantes) la situation (l’histoire des deux premières pages et « il nous reste plus qu’à trouver de l’argent » de la page 6).
Réponse attendue : Boule a besoin d’argent et donc, crée une entreprise de nichoirs avec ses copains. Ils ont besoin d’argent pour acheter le bâtiment, les matériaux, …
2° s’il a une idée pour résoudre le problème de Boule.
Solution du problème par la lecture de la 2ème partie.
Ensuite, je leur laisse 5 minutes pour prendre note des mots qui leur semblent importants ou qui leur sont inconnus. Je leur donne des explications (la théorie) que l’on cherche ensemble grâce à la B.D. Ils prennent note sur une feuille ou je leur prépare des textes lacunaires qu’ils devront compléter.
|
|
Idée méthodologique : Je laisse quelques minutes aux élèves, qui se placent par groupe de deux, pour noter les grandes étapes de l’histoire. Bref, pour répondre à la question suivante : « Comment créer une entreprise ? Après avoir corrigé ces étapes en interrogeant oralement les élèves et en notant au T.N. les réponses, nous revenons à l’histoire de Boule et Bill. Que doivent-ils (Boule et ses copains) faire à présent ? Nous lisons la fin de l’histoire (pages 9 à 11) pour vérifier la réponse (fabriquer des nichoirs et décider du prix de vente).
Nous complétons les étapes par ces deux éléments.
Enfin, nous reprenons chaque étape pour les expliquer et noter la théorie sur leur feuille.
v Pour introduire tout ce qui est administratif, Yves, Valérie C et moi, avons créé une cassette vidéo en faisant un montage d’entreprises filmées principalement à Nivelles et d’enregistrements de RTBF. Donc, je pourrai passer la cassette en demandant aux élèves de répondre à quelques questions données avant la cassette.
v Pour commencer une leçon sur les entreprises, les élèves et moi pourrions aller visiter une entreprise (Côte d’or, Volkswagen, …)
|
VI.Une leçon préparée de Yves De Boe (promotion 98)
Annoncée dans l'étape 1,
Leçon dont le sujet est la production.
Cette leçon aborde les points suivants :
· les besoins
· les biens durables et biens non durables
· les biens de consommation et biens de production
· les facteurs de production
· les échanges : troc et monnaie
· les agents économiques
· les flux réels et monétaires
· le schéma économique
Bibliographie :
Source : « Les ménages et les entreprise, A. Lafolla et L. Vanderpoorten, De Boeck - Wesmael, Bruxelles,1995.
La production, module 006 Socio-économie, collection Wauthy/Bruard...pour quelques idées.
La production, F.Boulanger,De Boeck-Wesmael, Bruxelles,1994.
Diverses B.D des Héros comme Boule et Bill ; Quick et Flupke.
Référence au programme : D/1992/0279/081.
![]() _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
1) Mise en situation.
La famille Bande Dessinée....
Commente toutes les situations auxquelles sont confrontés les héros de tes bandes dessinées préférées :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qu’éprouvent tous ces héros ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Comment pourraient-ils y répondre ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rencontrons-nous tous ces biens dans la nature ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Que faut-il donc faire pour les obtenir ? (certains)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Produire.
Þ Qu’est-ce que produire ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reprenons les exemples cités lors de la mise en situation et classons-les !
|
|
|
|
-
|
- |
|
-
|
- |
|
-
|
- |
|
-
|
- |
Définitions :
· Bien de _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· Bien de _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Remarque : il convient de préciser que certains de ces biens sont des biens durables c-à-d qui peuvent être utilisés plusieurs fois et d’autres sont des biens non-durables, c-à-d qui sont détruits par le premier usage que l’on en fait.
Exercice :
Classe les biens suivants en biens de production ou biens de consommation :
· un roman policier
· une camionnette de boulanger
· une télévision
· l’ordinateur du comptable
· un disque compact
· un téléphone
|
Biens de consommation |
Biens de production |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
3) Les facteurs de production.
L’eau consommée à la source ne nécessite pas de transformation avant d’être consommée mais l’eau de bouteille, nécessite une transformation avant d’être consommée.
Que nécessite cette transformation afin d’obtenir l’eau en bouteille ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Þ Toute opération de production nécessite :
· du _ _ _ _ _ _ _ , fourni par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , fournies par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· des _ _ _ _ _ _ _ , c’est-à-dire du matériel, et de _ _ _ _ _ _ _ qui sont le résultat d’une _ _ _ _ _ _ antérieure.
n Le facteur travail :
Le travail existe dès que l’homme parvient à produire des biens et des services grâce à la nature et à l’outil.
Le travail est le premier des facteurs de production ; en effet, le fait que nous disposons de machines, d’outils, d’équipements, ... indique un travail préalable, source de leur production. Même l’obtention des matières premières n’est possible que si un travail a été fourni pour les extraire.
n Le capital
Le capital économique comprend tous les biens qui ont été produits par l’homme dans le but de produire d’autres biens.
Le capital économique comprend :
· le capital fixe : il est composé par l’ensemble des biens d’équipement, c-à-d des bâtiments, des machines, ... qui sont utilisés plusieurs fois avant d’être dépréciés.
· le capital circulant : il disparaît dans le processus de fabrication. Il est transformé et incorporé dans le bien produit.
Il s’agit :
· des matières premières
· des produits semi-finis,...
Þ Produire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Exercice :
Le début de la bande dessinée ci-dessous s’est effacé ! !
Complète le début en marquant dans chaque case les étapes de la matière première au produit fini qui est ici : le nichoir.
· 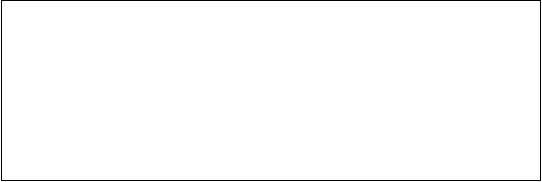 Comment pourrait-on définir la production ?
Comment pourrait-on définir la production ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4) Un petit tour du côté des archives.
Les échanges vers 1900.
Les femmes se répandaient dans les villages pour y acheter la pitance ; elles frappaient aussi à notre porte et troquaient contre les œufs de nos poules, nos pommes de terre ou l’eau de notre puits, les marchandises transportées : du gros vin du Midi, du bois de chauffage, des poteries venant de la Puisaye, du sable de Saône ou du charbon ; car il était admis que l’équipe vivait sur la cargaison, comme de la marine.
Que pratiquaient ces femmes ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pratique-t-on encore cela de nos jours ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les hommes ont instauré un autre instrument d’échange, quel est-il ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
À quoi sert-elle ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le père de Boule envoie Boule faire des courses chez l’épicier....
Avec quel argent Boule va-t-il payer ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D’ou provient (vraisemblablement) l’argent que lui donne son père ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5) Les agents économiques.
L’agent économique est celui (individu, organisme, institution, ...) qui, pour atteindre des objectifs déterminés, effectue certaines opérations économiques spécifiques.
n types
- Les ménages : ils sont constitués d’une ou de plusieurs personnes qui
partagent la même résidence principale ; ils constituent l’élément représentatif
de la consommation.
- Les entreprises : elles sont chargées de la production des biens et services
marchands *
- L’État : il se comporte en agent producteur et consommateur ; il produit des
biens et services collectifs ou non-marchands*
- Le Reste du monde : il participe à l’activité économique par les importations et exportations.
*bien marchand : bien ou service acquis à titre onéreux par celui qui en fait
la consommation.
*bien non-marchand : bien ou service pour lequel le consommateur ne paie
pas (l’entièreté) du bien. Ex : école, éclairage public
6) Le circuit économique.
Quels sont les deux principaux agents économiques rencontrés jusqu'à présent ?
· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n Considérons les deux premiers agents : _ _ _ _ _ _ _ _ et_ _ _ _ _ _ _ _ , ainsi que le marché de biens de consommation.
Quelles sont leurs relations ? Comment faire apparaître leur interdépendance ?
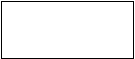 |
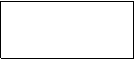 |
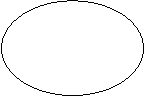 |
· Les ménages apportent leur _ _ _ _ _ _ _ _ aux _ _ _ _ _ _ _
· Les entreprises apportent _ _ _ _ _ _ _ _ _ leur _ _ _ _ _ _ _
· Le marché apporte _ _ _ _ _ _ _ les _ _ _ _ _ et les_ _ _ _ _ _ nécessaires à la consommation.
n Représentons (sur le même schéma) de la même façon, la double circulation des biens et de la monnaie.
· au travail correspond les _ _ _ _ _ _ des ménages.
· à la production correspond les _ _ _ _ _ des entreprises.
· à la consommation correspond les .................. des ménages
n Si l’entreprise décide d’améliorer sa production en achetant des nouvelles machines, elle se rendra donc sur le marché des biens de _ _ _ _ _ _ _ _
Construisons le schéma en y intégrant le marché des biens de _ _ _ _ _
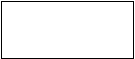 |
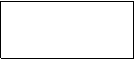 |
||||
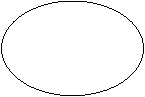 |
|||||
n Intégrons maintenant les administrations.
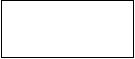 |
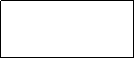 |
|||||
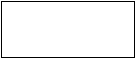 |
||||||
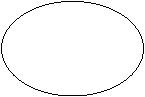 |
||||||
· Elles prélèvent des ménages et des entreprises : _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _
· Elles redistribuent cet argent sous forme de : .................. et _ _ _ _ _ _ _ _
n En reliant aux marché les importations des produits en provenance du Reste du monde, ainsi que les exportations que lui vend l’économie nationale, on peut construire le schéma détaillé.
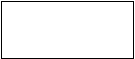 |
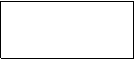 |
||||
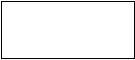 |
|||||
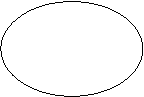 |
|||
La production.
Prérequis :
1) Expliciter, au moyen d’exemples concrets, que la satisfaction d’un besoin suppose l’existence d’un bien et d’un service.
2) Restituer les définitions de biens et services nécessaires à l’introduction du besoin.
3) Distinguer les biens durables et non durables lors de la comparaison des différents biens.
4) Restituer la définition d’un besoin lors de la mise en situation.
Compétences exercées :
1) Citer les biens ou les services susceptibles de répondre aux besoins.
2) Expliquer que la production de biens et services, se réalise toujours au sein d’une unité de production : l’entreprise.
3) Classer les différents biens en biens de consommation et en biens de production lors des exercices.
4) Restituer les définitions de biens de consommation et biens de production après avoir résolu les exercices.
5) Montrer, à l’aide d’exemples, que pour produire un bien ou un service, il faut réunir différents facteurs de production.
6) Citer et expliquer les facteurs de production tout au long du cours.
7) Préciser, à partir d’exemples concrets, ce qu’on entend par capital économique.
8) Dégager qu’à tous les stades de la production, l’homme est au centre de la production avec ses outils modernes lors de l’étude des facteurs de production.
9) Montrer que l’argent sur le circuit provient du travail humain.
10) Situer la place de la monnaie dans l’échange lors de la construction du schéma économique.
11) Définir les agents économiques avant l’élaboration d’un premier schéma économique.
12) Construire le schéma économique simplifié.
13) Compléter le schéma économique en y faisant apparaître le marché des biens de production, l’État et le Reste du Monde.
14) Construire les liens qui peuvent subsister entre ces agents économiques.
et celles que veut mettre en place Sophie Dohy (promo 98), dans une leçon comparable :
15) . trouver comment répondre à un besoin donné.
16) . définir les termes suivants : produire, production, biens de consommation, biens de production, capital fixe, capital circulant, prix de revient, prix de vente.
17) . classer des exemples de biens donnés dans les biens de consommation ou dans les biens de production et justifier sa réponse.
18) . différencier un bien durable d’un bien non - durable.
19) . énoncer ce que nécessite une opération de production.
20) . citer et expliquer avec ses propres mots, les facteurs de production.
21) . imaginer le trajet ou une partie du trajet d’un produit, en passant de la matière première au produit fini.
22) . calculer le prix de revient et le prix de vente d’un produit.
23) . énoncer les éléments dont on doit tenir compte pour calculer le prix de revient et le prix de vente.
24) . commenter des situations données sous forme d’images de bandes dessinées et répondre à des questions s’y rapportant.
25) . généraliser une situation concrète (bande dessinée).
|
P. |
C. |
Déroulement de la séquence. |
Timing |
|
|
|
n 1. Mise en situation. Chaque élève a devant lui les différentes séances tirées des B.D. . Les élèves sont invités à les lire dans un premier temps silencieusement, puis de façon orale avec le professeur. Ils devront commenter chacune de ces situations en y indiquant pour chacune d’elles le besoin ressenti par le héros de la B.D. concernée. Le prof note pour chaque héros le besoin éprouvé et demande aux élèves de trouver une solution afin que ces héros puissent répondre à leur besoin.
Le prof attire l’attention des élèves en montrant que tous ces biens nécessaires à la satisfaction des besoins n’existent pas à l’état pur et devront par conséquent être produits.
n 2. Produire. De cette mise en situation, on déduit une première approche de ce que produire veut dire : produire c’est ajouter de la valeur aux biens pour satisfaire un besoin. Le prof renvoie les élèves à la mise en situation et demande d’observer le genre de biens qui permet de satisfaire les besoins de ces héros. De cette observation, le prof en arrive à la notion de biens de consommation et biens de production. Une classification est réalisée grâce à un tableau qui permet de bien différencier ces deux types de biens et qui permet également de construire les définitions de ces deux biens.
Ces deux étapes se font de façon collective en demandant une participation active de la part des élèves. Le prof élargit ces deux notions en y intégrant les biens dits durables et non-durables. Les élèves notent des exemples sur le verso de la première feuille. Afin de vérifier la compréhension des élèves, le prof demande aux élèves de résoudre l’exercice se situant sur la page 3. La correction de cet exercice se fera comme suit : chaque élève désigné répondra et justifiera la raison de son choix.
n 3. Les facteurs de production. En faisant à nouveau référence à la mise en situation et en occurrence aux différentes B .D., le prof débute ce point en faisant un parallèle entre l’eau de source et l’eau de bouteille. De ce parallèle on pourra en arriver à la notion de travail, qui est nécessaire à l’obtention de cette bouteille, et au capital, qu’il soit fixe(les machines) ou circulant.
Ces deux nouvelles notions, toutes deux expliquées en détails sur la feuille de l’élève, sont lues par un élève désigné. Elles permettent également d’élargir la définition de « produire » : produire c’est combiner des facteurs de production. Cette nouvelle composante de définition est notée au T.N. par le prof et notée par les élèves sur leur feuille.
Un contrôle de compréhension est réalisé après ces différentes notions de matière. Cet exercice oblige l’élève à réfléchir) ce qui intervient avant, pendant et après la production. Il est réalisé en classe de façon individuelle et corrigé par le prof afin que celui-ci puisse se rendre compte si l’élève a bien compris.
Le prof fera part des meilleures solutions à toute la classe et réexpliquera si nécessaire l’une ou l’autre notion restée incomprise.
Le prof construit avec les élèves une version finale de ce que la production veut dire. Cette définition est notée au T.N. .
n 4. Un petit tour du côté des archives. Point « parenthèse » de cette matière, qui intègre la notion du troc ainsi que son fonctionnement ; et ce jusqu'à la nouvelle méthode d’échange instaurée depuis plusieurs années : la monnaie - l’argent. D’où provient l’argent avec lequel on peut satisfaire nos besoins ? Illustrée par une séance de B.D., elle permet à l’élève de se mettre dans une situation qui peut être déjà rencontrée de son vivant. Cette notion semble être peu importante dans le cours, mais elle permet de construire sans trop de peine le circuit ou schéma économique.
n 5. Les agents économiques. Le prof pose diverses questions afin de découvrir les différents agents économiques, il renvoie les élèves dans un contexte qui leur est propre, il sensibilise les élèves en posant des questions qui les touchent en abordant la famille, ce que font leurs parents, que paient-ils, grâce à quoi peuvent-ils payer cela ? etc. ... Suite à la découverte de ces agents économiques, il définit avec eux, chacun de ces agents. Les élèves copient ces dernières dans leur cahier en même temps que le prof les écrit sur le T.N.
n 6. Le circuit économique. Le prof demande, aux élèves, de parcourir leur cours afin de pouvoir construire petit à petit un schéma économique initial. De ces deux premiers agents découverts, le prof construit avec l’aide des élèves, les liens qui existent entre ceux-ci en ne faisant aucune différence entre les flux réels et les flux monétaires.
Une interprétation de ce schéma sera réalisée ; celle-ci consiste à remplir les espaces vides et semble être une synthèse du schéma. À chaque étape, le prof intègre un agent supplémentaire qui incite les élèves à se mettre davantage en question en faisant référence, par exemple, à leur vie familiale quotidienne.
De la même façon que pour le premier schéma, cette étape sera suivie d’une interprétation orale et visuelle. Après la construction de ces différents schémas, le prof avec les élèves construit la définition propre à chaque agent économique intervenant dans les schémas.
La façon, quant à la création des liens entre ces différents agents, sera réalisée à partir de transparent sur lequel on fera apparaître petit à petit les liens qui peuvent subsister entre ces agents. Un maximum de couleurs est utilisé de façon à attirer davantage l’attention des élèves.
Les élèves, quant à eux complètent leur schéma en fonction, en suivant la cadence du rabat des transparents projetés par le rétroprojecteur.
|
|
ou
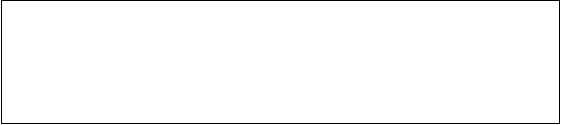 Nom : _ _ _ _ _ _ _ Date :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ Date :
Prénom : _ _ _ _ _ Évaluation : ...... /15.
Socio-économie : la production.
Classe : _ _ _ _ _ _
1) Situation :
Les machines de l’entreprise de bonbons de monsieur Albert vieillissent ...
Il décide d’investir en achetant de nouvelles machines ; grâce à ces dernières, il a de plus en plus de demandes de la part des pays étrangers pour ses succulents bonbons.
1) Représente cette situation dans le schéma économique.
2) Quels sont les agents économiques qui interviennent dans le schéma économique.
3) Vrai ou Faux. Justifie
a Lorsque l’entreprise possède un véhicule, celui-ci est intégré dans le capital fixe.
b Le travail n’est pas un facteur de production.
c Le four du boulanger est un bien de production.
d De nos jours, le troc prend de plus en plus d’ampleur dans les échanges.
4) Que nécessite toute opération de production ?
5) Définis :
· Bien de consommation.
· La production.
· Bien non durable.
Il convient de préciser un point essentiel quant à la manière d’aborder le schéma économique.
Il convient mieux de distinguer les liens qui peuvent subsister entre les différents agents économiques en parlant de flux réel et flux monétaire.
Ce point doit être abordé juste avant le schéma économique ; ainsi on définira :
le flux réel comme étant une représentation des mouvements de biens et services entre les agents économiques ou encore comme étant la mesure de la quantité de biens et services échangée entre des agents économiques d’une opération et pendant une période déterminée.
Le flux monétaire sera défini comme étant la représentation des mouvements de monnaie entre les différents agents économiques, ou encore comme étant la mesure de la quantité de monnaie échangée entre des agents à l’occasion d’une opération et pendant une période déterminée.
(*)Afin d’assimiler au mieux cette nouvelle notion, il convient d’aborder le schéma économique, en utilisant des exemples concrets et en faisant apparaître petit à petit d’autres agents intervenant dans le circuit économique(tout comme fait dans la leçon).
En ce qui concerne la méthodologie de ce nouveau point, il est préférable de poser un maximum de questions aux élèves afin de distinguer au mieux flux réel et flux monétaire.(*)
Toutefois, il n’est parfois pas évident pour des élèves du premier degré, voire même du second degré de parler directement de flux réel et flux monétaire ... il convient alors d’utiliser différentes couleurs en respectant une homogénéité quant à l’utilisation de ces couleurs.
VOIR AUSSI : la préparation de Sophie Dohy (promotion 98) sur le même sujet, avec quelques variantes
VII.Une leçon préparée de Sophie Dohy (promotion 98)
Annoncée dans l'étape 1,
Leçon dont le sujet est la production.
Référence au programme : D/1994/0279/016, pages 47 et 50.
Compétences exercées :
l’élève sera capable de :
· 1. trouver comment répondre à un besoin donné.
· 2. définir les termes suivants : produire, production, biens de consommation, biens de production, capital fixe, capital circulant, prix de revient, prix de vente.
· 3. classer des exemples de biens donnés dans les biens de consommation ou dans les biens de production et justifier sa réponse.
· 4. différencier un bien durable d’un bien non - durable.
· 5. énoncer ce que nécessite une opération de production.
· 6. citer et expliquer avec ses propres mots, les facteurs de production.
· 7. imaginer le trajet ou une partie du trajet d’un produit, en passant de la matière première au produit fini.
· 8. calculer le prix de revient et le prix de vente d’un produit.
· 9. énoncer les éléments dont on doit tenir compte pour calculer le prix de revient et le prix de vente.
· 10. commenter des situations données sous forme d’images de bandes dessinées et répondre à des questions s’y rapportant.
· 11. généraliser une situation concrète (bande dessinée).
Bibliographie :
n Bandes dessinées de Boule et Bill sur l’entreprise et l’Europe, Editions ROBA, 1991.
n Cours de Yves Deboe, « la production », 1997.
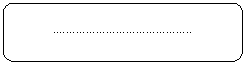
1. Mise en situation :
Consignes : Observe attentivement les cinq situations auxquelles sont confrontés les héros de
tes bandes dessinées préférées, puis commente - les sur les pointillés situés
en - dessous de chaque image.
|
1.
|
2. |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
3.
|
4. |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
|
Quelques questions à propos des 5 situations choisies :
1) Que ressentent tous ces héros ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Pour chaque situation, note comment les personnages pourraient répondre à cela.
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) Rencontrons - nous tous ces biens tels quels dans la nature ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4) Dans la plupart des cas, que faut - il faire pour obtenir ces biens ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Qu’est - ce - que produire ?
a) Réponds à la question posée dans ce titre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Reprenons quelques exemples cités lors de la mise en situation et classons - les !
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
c) Faisons le point !
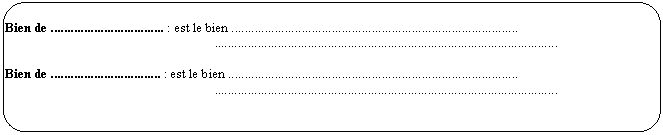 |
Rem. : Il convient de préciser que certains de ces biens sont des biens durables,
c’est - à - dire qui peuvent être utilisés plusieurs fois et d’autres sont des biens
non - durables, c’est - à - dire qui sont détruits par le premier usage que l’on en fait.
d) Exercices :
Classe les biens suivants dans les biens de production ou dans les biens de consommation et justifie ta réponse oralement( car un bien pourrait se trouver dans les deux colonnes) :
· un roman policier
· une camionnette de boulanger
· une télévision
· l’ordinateur d’un comptable
· un disque compact
· un téléphone
|
Biens de consommation |
Biens de production |
|
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
3. Les facteurs de production :
L’eau consommée à la source ne nécessite pas de transformation avant d’être consommée, mais l’eau de bouteille a bien été transformée avant d’être consommée.
De quoi a - t - on besoin pour obtenir l’eau en bouteille ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Faisons le point !
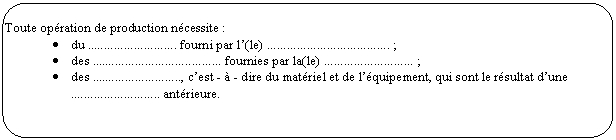 |
Quels sont les facteurs de production ?
a) Le travail :
Le travail existe dès que l’homme parvient à produire des biens et des services grâce à la nature et à l’outil.
Le travail est le premier des facteurs de production ; en effet, le fait que nous disposons de machines, d’outils et d’équipements, indique un travail préalable, source de leur production. Même l’obtention des matières premières n’est possible que si un travail a été fourni pour l’extraire.
b) Le capital :
Le capital économique comprend tous les biens qui ont été produits par l’homme dans le but de produire d’autres biens.
Le capital économique comprend :
· le capital fixe : il est composé par l’ensemble des biens d’équipement, c’est - à- dire des bâtiments, des machines, ..., qui sont utilisés plusieurs fois avant d’être dépréciés.
· le capital circulant : il disparaît dans le processus de fabrication. Il est transformé et incorporé dans le bien produit. Il s’agit : - des matières premières
- des produits semi - finis
- ...
Exercices :
Le début de la bande dessinée ci - dessous s’est effacé ! !
Complète le début en marquant dans chaque case les étapes de la matière première au produit fini qui est le nichoir (tu peux réaliser un dessin).
|
1.
|
3. |
5. |
|
|
2.
|
4. |
6. |
|
|
7.
|
8.
|
||
|
9.
|
10.
|
||
Faisons le point !
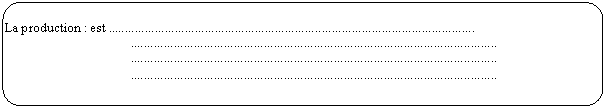 |
4. Le prix de revient :
Afin d’acheter un vélo, Boule décide de rassembler ses amis et de vendre de délicieux petits gâteaux au chocolat faits maison. Ils ont utilisé comme ingrédients :
200 gr petits beurres 64 BEF
125 gr beurre 50 BEF
75 dl lait 26 BEF
50 gr « vrai cacao » 35 BEF
100 gr chocolat fondant 50 BEF
10 cl de crème fraîche 25 BEF
Coût des matières premières ....... BEF
Ils ont utilisé aussi du gaz pour le four, de l’électricité pour le malaxeur et pour le frigo, ...
Estimons l’énergie à 50 BEF.
Enfin, ils ont employé et donc usé la cuisinière, le four, le frigo, le batteur, le chauffe - eau, ..., cet amortissement est évalué à 100 BEF.
Quel est le prix de revient total ?
![]() Matières premières : _ _ _ _ _ BEF
Matières premières : _ _ _ _ _ BEF
Énergie _ _ _ _ _ BEF
Amortissement _ _ _ _ _ BEF
Prix de revient _ _ _ _ _ BEF pour 20 gâteaux ou .............. BEF pour 1 gâteau.
Faisons le point !
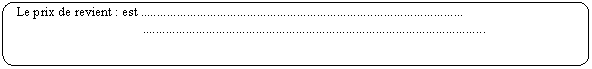 |
Rem. : Avant de calculer la marge bénéficiaire que le commerçant désire obtenir sur un produit déterminé, il doit connaître le coût de son produit.
Il va donc tenir compte : - du prix d’achat des matières premières
- de la consommation d’électricité, gaz, eau, ...
- du salaire du personnel
- de l’amortissement du matériel.
5. Le prix de vente :
Les gâteaux au chocolat étaient revenus à 400 BEF pour l’ensemble ou à 20 BEF le gâteau. Ils ont décidé de les vendre en prenant une marge bénéficiaire de 30 % .
Quel sera le prix de vente de l’ensemble ?
Quel sera le prix de vente d’un gâteau ?
Faisons le point !
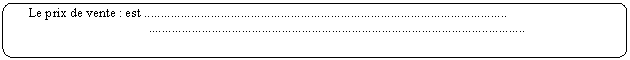 |
Rem. : Boule et ses amis vendent les gâteaux au chocolat qu’ils ont fabriqué. Ils donnent donc une utilité (une valeur) plus grande à un produit car de nombreux clients ne sauraient pas faire eux - mêmes des gâteaux, n’ont pas le temps de faire des gâteaux ou n’ont pas besoin d’un gâteau entier. Boule et ses amis ont donc ajouté une marge bénéficiaire au produit qu’ils vendent pour le service qu’ils rendent aux clients.
Nom : Le ...............
Prénom :
Classe : /10
Interrogation : la production
1) Voici une image de bande dessinée, colorie tout ce qui est relatif au capital.
2) Complète les propositions suivantes et justifie ta réponse en utilisant les définitions vues au cours.
|
a. |
la tondeuse du pâtissier |
bien de _ _ _ _ _ _ |
car _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
b. |
le couteau du boucher |
bien de _ _ _ _ _ _ |
car _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
c. |
la chemise de papa |
bien de _ _ _ _ _ _ |
car _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
d. |
le tracteur du fermier |
bien de _ _ _ _ _ _ |
car_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
3) La classe décide de vendre des plantes, qu’ils ont cultivées afin de partir en voyage en Italie. En sachant qu’elles sont revenus à 800 BEF pour l’ensemble et à 25 BEF la plante, la classe a décidé de les vendre en prenant une marge bénéficiaire de 20 %.
Quel sera le prix de vente de l’ensemble des plantes (note tes calculs) ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quel sera le prix de vente d’une plante (note tes calculs) ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
n° de compétence |
Déroulement de la séquence |
Temps |
|
10 1
2
3
2, 11
4
3
10, 11
5
6
2, 11
7
2, 11
8
2, 11
9
8
2, 11
9
|
1. Mise en situation : Distribution de la première feuille et de la deuxième feuille. Le professeur lit les consignes écrites sur cette feuille et précise que le temps laissé afin de réaliser cette activité est de 10 minutes. La correction s’effectue au rétro - projecteur, les élèves donnent leur réponse. Rem. : les élèves ne vont peut - être pas dire directement le mot « besoin », le prof pourra faire remarquer que si tous les personnages présentés ont « quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque pour être bien », cela signifie qu’ils ont tous des besoins.
Les élèves complètent la première feuille et les réponses aux questions.
2. Qu’est - ce - que produire ? a) Le professeur pose la question ci - dessus et laisse 5’ aux élèves pour réfléchir à une réponse. La correction se fait oralement et le prof corrige les propositions faites par les élèves. Le professeur note la réponse au tableau noir.
b) Le professeur demande aux élèves de classer les différentes situations proposées précédemment en deux parties. Les élèves ont comme consignes : travailler par groupe de deux, au crayon ordinaire et pendant 10’. Un groupe d’élèves choisi par le professeur note sa réponse au tableau noir (TN) et les autres groupes expose oralement leur classification, si elle s’avère différente de celle présentée au TN. Le professeur fait découvrir les titres des deux colonnes en faisant ressortir tout au long de l’exercice, les mots suivants : consommer et produire. Les élèves recopient le point a) et b).
c) Les élèves essayent avec le professeur de définir avec leurs propres mots le bien de consommation et le bien de production. Distribution de la troisième feuille. Le professeur note les définitions dites précédemment oralement grâce à l’aide des élèves qui les lui dicte.
Le professeur fait remarquer la différence entre un bien durable et non - durable et en fait chercher quelques exemples de chaque. Les élèves copient les définitions sur leur feuille.
d) Les élèves travaillent individuellement et au crayon ordinaire, ils ont 5’ pour réaliser l’exercice. La correction s’effectue par un élève au TN, les autres l’aide à justifier sa réponse.. Les élèves corrigent leur réponse et recopient au propre sur leur feuille.
3. Les facteurs de production : Lecture de la BD par un élève à haute voix, le prof lit l’énoncé et la question, les élèves ont 5’ pour y réfléchir. Correction oralement ensemble. Les élèves recopient la réponse.
Distribution de la quatrième feuille. Les élèves ont 5’ pour « faire le point ! », et trouver les réponses pour compléter les pointillés. La correction s’effectue oralement par toute la classe. Les élèves recopient au propre les réponses.
Quels sont les facteurs de production ? Lecture ensemble du a) et du b).
Découverte de la nouvelle définition du mot produire. Les élèves copient la réponse.
Les élèves font l’exercice au crayon, par groupe de deux, ils ont 10’ Correction sur transparent par un élève. Les élèves recopient les réponses.
Distribution de la cinquième feuille. Découverte de la définition du mot production. Les élèves dictent la définition qu’ils viennent de construire au professeur, qui la note au TN. Les élèves recopient la définition sur leur feuille.
4. Le prix de revient : Les élèves lisent individuellement la situation et essayent de répondre aux questions au crayon ordinaire. Correction au rétro - projecteur par un élève. Les élèves recopient les réponses sur leur feuille.
Construction ensemble de la définition du prix de revient. Le professeur la note au TN. Les élèves recopient sur leur feuille.
Distribution de la sixième feuille. Lecture par le professeur de la remarque.
5. Le prix de vente : Les élèves travaillent au crayon ordinaire et individuellement sur l’exercice proposé. La correction est faite par un élève au rétro - projecteur. Les élèves recopient les réponses.
Construction ensemble de la définition du prix de vente. Le professeur la note au TN. Les élèves recopient sur leur feuille.
Lecture de la remarque par le professeur.
|
5’ 10’
15’
10’
5’
10’
10’
10’
10’
5’
5’ 5’
10’
5’
5’ 10’ 5’
5’ 5’ 5’
5’ 5’
5’
5’ 5’ 5’
10’ 5’ 5’
5’ 5’ 5’ 5’
10’ 5’ 5’
10’
5’ 5’
5’ 5’ 5’
10’
5’ |
♦ L'efficacité de la combinaison productive : productivité, progrès technique, innovation |
- La productivité et sa mesure
- Origines et significations des gains de productivité
- Progrès technique, innovation et productivité
I. La productivité et sa mesure
A. La productivité
Nous avons déjà rencontré la notion de productivité à propos de la population active, il s'agissait de la productivité du travail. Rappelons cette définition en la généralisant.
Productivité : de façon générale, la productivité est un rapport entre ce qui entre dans l'entreprise : les facteurs de production (en anglais les "inputs") et ce qui en sort : la production (en anglais l'"output").
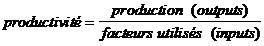
Comme nous l'avons vu, les facteurs de production sont le travail et le capital. On peut donc calculer trois types principaux de productivité :
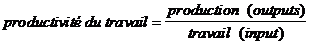
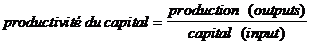
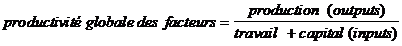
B. Les mesures de la productivité
Nous avons vu ci‑dessus comment se mesurait la production : généralement par la valeur ajoutée brute. Cependant, quand la production est homogène, on peut la mesurer en unités physiques : tant de tonnes de charbon, de blé, d'automobiles...
Mais ce qui pose le plus de problèmes, c'est la mesure du dénominateur. Distinguons les trois types de productivité.
1. La productivité du travail
Le plus souvent, le dénominateur est calculé en unités physiques : nombre de travailleurs ou nombre d'heures de travail. On obtient :
a) La productivité par tête
Si P est la production physique, C.A. le chiffre d'affaires, V.A.B. la valeur ajoutée brute, N le nombre de personnes employées, la productivité par tête peut s'exprimer de trois manières différentes :
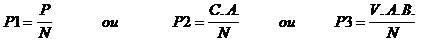
· P1 s'exprimera en unités physiques (tant de voitures, de quintaux de blé, etc.) par travailleur.
· P2 et P3 s'expriment en unités monétaires (francs, dollars, etc.) par travailleur. II est préférable, quand c'est possible, d'utiliser la valeur ajoutée plutôt que le chiffre d'affaires.
Ainsi, d'après les chiffres de 1997, extraits de "Le Soir", 7/3/97 (n'oublions pas que depuis, Renault a fermé ses portes en Belgique pour s'installer en Europe de l'Est), on aurait :
|
Marque Où ? Emplois dir Nombre véh
Productivité véhic/homme |
Volvo Gand 6000 144 300
24,05 |
Opel Anvers 7775 295 000
37,94 |
Renault Vilvorde 3100 143 000
46,13 |
VW Forest 5850 196 000
33,50 |
Ford Genk 13100 450 000
34,35 |
b) La productivité horaire
Soit H le nombre d'heures de travail nécessaires pour la production, avec les mêmes notations, la productivité horaire est :
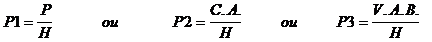
Si t est le temps de travail moyen dans l'activité considérée, nous avons H = t * N,
P1, P2, P3 peuvent donc encore s'écrire :
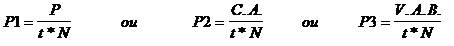
Ainsi, pour une même production, la moisson d'un are de blé, il faut (a fallu) ... en utilisant...
|
1800 1850 1900 1920 1945 1980 |
1 heure = 3600 sec 15 min = 900 sec 2 min = 120 sec 40 sec 35 sec 25 sec |
faucille faux faucheuse lieuse faucheuse lieuse tract mécanique moissonneuse batteuse moissonneuse batteuse |
Le même travail est donc fait 3575 fois plus rapidement en 1980 qu'en 1800 : le dénominateur a diminué de autant (mieux : été divisé par…), la productivité a donc été multiplié par 3575.
Comme pour la productivité par tête, P1 s'exprime en unités physiques (par heure de travail) et P2 et P3 en unités monétaires (par heure de travail).
Le dénominateur peut également être constitué par les salaires. La productivité du travail représente alors x francs de V.A.B. (par exemple) pour 1 franc de salaire versé.
2. La productivité du capital
La productivité du capital est le rapport entre la production [mesurée selon les cas en unités physiques (P) ou par le chiffre d'affaires (C.A.) ou par la valeur ajoutée brute (V.A.B.)] et le capital fixe et/ou circulant utilisé.
En supposant que l'amortissement A représente convenablement le capital fixe qui, par usure ou obsolescence, a été absorbé par la production au cours de la période, la productivité du capital fixe est :
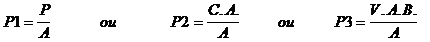
Si l'on veut calculer la productivité du capital fixe et circulant, il faut ajouter au dénominateur les consommations intermédiaires C.I. ; nous obtenons donc :
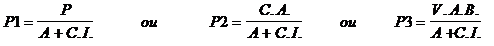
Étant donné l'hétérogénéité des éléments correspondant au dénominateur (des machines diverses, de l'électricité, des matières premières, etc.), celui‑ci est exprimé en valeurs monétaires. La productivité du capital s'exprimera donc en unités physiques produites, ou en francs produits pour un franc de capital (fixe et/ou circulant) engagé dans la production.
3. La productivité globale des facteurs
Quand on mesure la productivité globale des facteurs, l'hétérogénéité du dénominateur s'accroît : il faut additionner du travail, des équipements, des matières premières, etc. La conversion en valeur monétaire de chaque élément physique entrant dans la composition du dénominateur s'impose[6].
La productivité globale des facteurs sera donc, si S est le montant des salaires, A l'amortissement du capital fixe et C.I. la valeur des consommations intermédiaires :
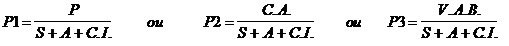
La productivité globale des facteurs s'exprime en unités physiques ou en francs produits, pour 1 franc engagé dans la production au titre des salaires et des dépenses en capital.
Elle mesure l'efficacité économique d'ensemble de la combinaison productive.
4. La productivité moyenne ou marginale
$$$$$voir parabole faible
II. Origines et significations des gains de productivité
A. Les origines multiples des gains de productivité
Supposons qu'un facteur soit fixe. II s'agit par exemple du travail dont la quantité (mesurée par le nombre de personnes employées ou par leur temps de travail) ne varie pas alors que la production augmente. II y a donc également augmentation de la productivité du travail. Ce gain de productivité peut être la conséquence de plusieurs situations :
· le climat social et psychologique de l'entreprise s'est amélioré de telle sorte que chacun travaille plus vite : l'intensité du travail s'est accrue spontanément, sans dépense supplémentaire pour l'entreprise,
· ou bien une organisation nouvelle du travail évite les temps morts (division du travail et parcellisation des tâches, standardisation ; cf. étape 2, "organisation du travail", Taylorisme et Fordisme),
· ou bien des machines plus perfectionnées ont été introduites (cf. ci-après, "progrès technique").
La productivité du travail peut donc avoir augmenté pour au moins trois raisons (non exclusives les unes des autres).
De même, si la productivité du capital augmente, cela peut être dû :
· à des équipements plus perfectionnés (les machines "tournent" plus vite, ont une capacité plus grande, etc.),
· à des machines aux performances inchangées mais moins coûteuses (cas des ordinateurs qui, à capacité de traitement égale ou même plus élevée, coûtent de moins en moins cher),
· au fait que les équipements sont utilisés plus longtemps, de telle sorte que, pour une même dépense en capital fixe, la production augmente.
L'augmentation de la productivité d'un facteur peut être due au seul facteur considéré, ou à l'action des autres facteurs de production, ou à des circonstances extérieures aux facteurs eux-mêmes (durée d'utilisation des équipements, meilleure organisation du travail, etc.).
C'est pourquoi, on qualifie parfois la productivité d'un facteur isolé de "productivité apparente".
B. Les significations des gains de productivité
Reprenons le cas où la productivité du travail augmente grâce à l'utilisation de machines plus perfectionnées.
Ce gain de productivité du travail a sans doute été obtenu par des investissements coûteux qui, en accroissant les dépenses en capital fixe, ont réduit la productivité du facteur capital. II s'agit alors de savoir si cette baisse éventuelle de la productivité du capital n'a pas annihilé les effets positifs de la hausse de la productivité du travail. La productivité globale des facteurs doit permettre de répondre à cette question.
L'augmentation de la productivité d'un facteur isolé, travail ou capital, n'est pas toujours synonyme d'une meilleure efficacité économique de l'entreprise.
Ce qui importe au niveau d'une entreprise, c'est avant tout d'obtenir le plus bas prix de revient possible afin de réaliser, pour un prix de vente donné, le bénéfice maximum.
Seule la productivité globale est donc vraiment significative.
Mais principalement à cause des ambiguïtés de l'amortissement du capital fixe, la productivité globale des facteurs est difficile à mesurer. C'est la raison pour laquelle on se contente souvent de calculer les variations de la productivité du travail.
Cette pratique a d'ailleurs un écho dans le vocabulaire : quand on parle de "la productivité" sans plus de précision, implicitement, c'est de la productivité du travail qu'il s'agit.
Nous avons plusieurs fois rencontré l'idée que l'amélioration des équipements était une cause importante des gains de productivité. Même si le progrès technique ne se réduit pas à l'amélioration des équipements, il en est un élément important.
III.Progrès technique, innovation et productivité
Depuis plus de deux siècles, les pays industrialisés sont entrés dans une ère nouvelle marquée par un progrès technique incessant, dont nous allons sommairement étudier la nature et certaines conséquences économiques et sociales.
A. Qu'est‑ce que le progrès technique ?
Chacun a rencontré dans ses livres d'histoire ces découvertes qui se sont concrétisées par des inventions et des innovations et qui ont bouleversé l'économie et la société.
Découverte : elle permet de faire connaître un fait préexistant mais jusque là ignoré.
Par exemple, le physicien Henri Becquerel découvrit la radioactivité en 1896.
Invention : l'application pratique d'une découverte, sous la forme d'un produit ou d'un procédé nouveau.
Ainsi, la découverte de Becquerel permit d'inventer des appareils de radiographie aux rayons X.
Mais une invention n'a de réelle portée que si elle se traduit concrètement par des produits ou des procédés nouveaux qui se diffusent dans l'économie et dans la société. L'invention devient alors une innovation.
Innovation : une invention devient une innovation quand elle trouve une application industrielle et commerciale.
L'invention de la radiographie donna naissance à une série d'innovations dans le domaine de la médecine (radiographie pulmonaire, par exemple), la métallurgie (étude aux rayons X de la structure des métaux).
Découvertes, inventions, innovations sont donc liées les unes aux autres de la manière suivante :
Découverte ------------------à Invention --------------------à Innovation
entraîne permet
B. Les différents types d'innovations
On distingue deux types principaux d'innovations : des innovations de produits et des innovations de procédés.
Les innovations de produits font apparaître des produits (biens ou services) nouveaux.
Les innovations de procédés consistent à produire des produits existants avec des procédés nouveaux.
Par exemple, la cassette audionumérique est une innovation de produit, car elle n'a aucun équivalent véritable dans un produit existant. En revanche, la fabrication de médicaments par génie génétique (ex : production d'insuline humaine sans devoir tuer d'individu) est une innovation de procédés : la plupart de ces médicaments existaient auparavant, mais étaient fabriqués selon d'autres méthodes (en tuant des cochons depuis 1922).
En réalité, innovations de produits et de procédés sont souvent intimement mêlées et concourent ensemble à augmenter la productivité des facteurs.
Il est difficile de séparer concrètement ces deux types d'innovations. Pourtant, il est nécessaire de les distinguer pour analyser leurs effets sur l'économie.
C. Les conséquences économiques et sociales des innovations
1. Les innovations de produits
Il faut distinguer deux cas :
a) Le produit nouveau s'ajoute aux produits existants, sans s'y substituer.
C'est alors un marché nouveau qui s'ouvre. Des entreprises sont fondées ou développent un nouveau secteur pour fabriquer le produit : une nouvelle branche d'activité apparaît.
Comme toutes les branches sont plus ou moins interdépendantes, l'innovation n'a pas que des effets directs, elle stimule aussi la production des branches liées à la branche nouvelle. Des emplois supplémentaires sont créés dans celle‑ci, et par contagion, dans les autres. Tout un processus de croissance est ainsi enclenché.
Par exemple, au XIXe siècle, les chemins de fer ont joué ce rôle moteur, en stimulant la production charbonnière, la sidérurgie et la métallurgie, le génie civil et le bâtiment, etc.
Au XXe siècle, l'industrie automobile a joué un rôle analogue. On a ainsi pu estimer qu'en Belgique en 1985, un emploi sur dix dépendait directement (production automobile) ou indirectement (commerce, réparation, assurances, etc.) de cette branche automobile.
b) Le produit nouveau remplace un produit existant.
Par exemple, l'éclairage électrique a remplacé les anciens modes d'éclairage.
II s'en est suivi une série de conséquences pour les entreprises. Certaines activités ont connu le déclin (fabrication de bougies, de lampes à pétrole, etc.), d'autres sont nées (toutes les activités liées à l'électricité). D'où, simultanément, des fermetures d'entreprises fabriquant les produits devenus obsolètes et le développement des entreprises innovantes.
Par contrecoup, l'emploi a été lui aussi atteint. Au total, l'électricité a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit, car ses applications se sont révélées beaucoup plus étendues que celles des produits qu'elle a remplacés.
En même temps, les produits nouveaux changent souvent Le mode de vie. Par exemple, le développement du chemin de fer ou de l'automobile permit des déplacements plus rapides et moins coûteux ; certaines régions se désenclavèrent, leurs habitants subirent des influences qui jusqu'alors ne pénétraient pas jusqu'à eux ; l'exode rural et l'urbanisation en furent accélérés.
À peu près toutes les innovations importantes de produits eurent de tels effets sociaux. Ils suscitèrent, selon les cas, craintes ou espérances et, de fait, leurs conséquences sont parfois ambiguës.
2. Les innovations de procédés
Elles sont destinées à augmenter la productivité. Elles ont des effets contradictoires, dont nous allons préciser certains mécanismes.
Les effets directs sur l'emploi dans l'entreprise :
· D'une part, si la production reste inchangée, l'augmentation de la productivité du travail a un effet déprimant sur l'emploi dans l'entreprise : on y produit autant avec moins de travail, il risque d'y avoir des licenciements.
· Mais, d'autre part, la baisse des prix rendue possible par la hausse de la productivité peut limiter ces effets néfastes ou les annuler ; si le marché s'élargit suffisamment, il faudra même embaucher.
De toute façon , en économie de marché où règne la concurrence, l'augmentation de la productivité est souvent une condition de la survie de l'entreprise.
Les effets indirects sur l'emploi
En dehors de l'entreprise où a lieu l'innovation, se produisent aussi des phénomènes devant contrebalancer les conséquences éventuellement négatives de la hausse de la productivité.
· Effet de compensation
La hausse de la productivité n'a souvent été possible que par l'utilisation d'équipements plus modernes et performants, produits dans d'autres branches (branches de biens d équipements). Celles‑ci sont donc stimulées par la modernisation des entreprises, ‑ elles accroissent leur production, embauchent, etc.
· Effet de déversement
Les gains de productivité dans certaines branches permettent souvent des hausses de rémunération. Cette hausse des revenus, d'abord localisée dans la branche en modernisation, se déverse dans le reste de l'économie. En effet, les agents dont le revenu a augmenté achètent davantage de produits de consommation, ce qui stimule la production et l'emploi des branches correspondantes.
Les effets sur le niveau de vie et le mode/genre de vie
L'augmentation éventuelle de la productivité globale, qui résulte des innovations de procédés, est éminemment favorable à l'entreprise, car elle produit désormais autant ou davantage avec moins de facteurs et son prix de revient diminue. Elle peut alors répercuter ses gains de productivité à quatre niveaux :
· en augmentant la rémunération de ses employés ;
· en produisant plus, l'entreprise peut choisir de diminuer le temps de travail de ses employés sans nuire à sa production ni à l'emploi ;
· en réduisant ses prix de vente ;
· en augmentant ses bénéfices et sa rentabilité.
Mais tout n'est bien entendu pas possible en même temps. La répartition des gains de productivité suppose d'établir des compromis entre différentes priorités, parfois contradictoires.
Les entreprises en concurrence sont progressivement obligées de se moderniser et les effets favorables que nous venons d'énumérer se diffusent alors dans l'ensemble de l'économie et de la société. L'évolution historique des sociétés industrielles permet de le vérifier :
· l'augmentation des revenus réels a bénéficié à la grande majorité des ménages : grâce aux gains de productivité, les revenus ont augmenté plus vite que les prix nominaux. D'où l'augmentation du niveau de vie et l'entrée des pays industriels dans la consommation de masse (cf. ) ;
· la baisse générale de la durée du travail a permis d'améliorer les conditions de vie (cf. ) ;
· enfin, l'emploi étant un élément essentiel du niveau de vie et du mode de vie, il est bon de souligner que, sur la longue période, les gains de productivité n'ont pas nui, bien au contraire, à l'emploi. En France, par exemple, la population active occupée a doublé au cours de ces deux derniers siècles caractérisés pourtant par des progrès soutenus de la productivité. Pourquoi ? Grâce justement aux gains de productivité. En effet, comme nous venons de le voir, l'augmentation du niveau de vie a élargi les débouchés des entreprises qui ont dû d'autant plus embaucher que la durée du travail diminuait.
Le lecteur s'efforcera ici de dresser un schéma de raisonnement économique liant les divers éléments de ce raisonnement : gains de productivité, baisse de la durée de travail, hausse des salaires, baisse des prix, hausse des profits, hausse de la demande, investissements, hausse de la production, et si la demande augmente plus/moins vite que la productivité... et les conséquences sur l'emploi.
D. Progrès technique et environnement
1. La pollution
$$$$ Boulanger "production", p 21
a) Constat
b) Interventions et objectifs
c)
2. Le recyclage
$$$$ Boulanger, "production, p 26
♦ Le partage de la valeur ajoutée |
- Les principes de la répartition de la valeur ajoutée
- Le partage de la valeur ajoutée est un enjeu social majeur
- Test sur le Net : production, valeur ajoutée
Le supplément de richesses constitué par la valeur ajoutée de l'entreprise doit être partagé entre tous ceux qui ont contribué à son apparition. On peut distinguer quatre "parties prenantes" dans ce partage : les salariés, les actionnaires, l'entreprise elle‑même, et l'État. Examinons les droits que les uns et les autres ont dans ce partage.
I. Les principes de la répartition de la valeur ajoutée
A. Les salaires
Ils constituent la rémunération des personnes qui ont apporté leur force de travail à l'entreprise. Rappelons qu'elle comprend non seulement le salaire directement perçu par le travailleur, mais aussi le salaire indirect constitué des cotisations salariales et patronales (cf. ) .
Notons également que, dans la majorité des cas, les employés d'une entreprise reçoivent leur salaire avant même que les marchandises qu'ils ont fabriquées soient vendues. Ce décalage explique parfois les difficultés des entreprises qui n'ont pas assez de trésorerie pour faire face à leurs échéances.
Par ailleurs, plusieurs conceptions peuvent régir le salaire :
a. II peut être variable :
· en fonction de la durée du travail
· ou parce qu'il est lié à la quantité de marchandises produites (salaire aux pièces) ou vendues (au salaire de base s'ajoutent des primes en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices réalisés).
b. II peut être fixe, pour un temps de travail forfaitaire
B. La répartition du bénéfice brut
Bénéfice brut = production ‑ Consommations intermédiaires ‑ Salaires
Le bénéfice brut comprend quatre parts, dont deux échoient à l'entreprise elle‑même, une aux actionnaires et la dernière à l'État, conformément au schéma suivant :
|
Bénéfice brut |
|||
|
Bénéfice imposable |
Amortissement |
||
|
Impôts |
Dividende |
Réserves + Provisions + Report |
Amortissement |
|
ÉTAT |
ACTIONNAIRE |
ENTREPRISE |
|
L'amortissement, comme nous l'avons vu ci‑dessus dépend de règles comptables et fiscales codifiées.
Le bénéfice brut moins l'amortissement détermine le bénéfice imposable ou bénéfice net après amortissement.
L'impôt sur les bénéfices représente en Belgique en 1993, 40 ou 34 % du bénéfice net après amortissement. II a beaucoup diminué depuis le milieu des années quatre‑vingts, où il atteignait le taux de 50 %. En novembre 2006, ce taux de base était de 33 % (tranches de 24,25 % à 34,5 %)
En déduisant du bénéfice brut l'amortissement et l'impôt, on obtient le bénéfice net d'amortissement et d'impôt.
Généralement, l'entreprise en garde une fraction (c'est le bénéfice non distribué) qui, ajoutée aux provisions d'amortissement, permettra l'autofinancement d'une partie au moins des investissements.
L'autre partie est distribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.
La répartition du bénéfice net d'amortissement et d'impôt entre dividendes et bénéfice non distribué dépend, dans une société par actions, de la décision de l'Assemblée Générale des actionnaires A.G.). Ceux‑ci ont en effet plusieurs possibilités :
· ou bien ils privilégient leurs revenus immédiats, et décident une importante distribution de dividendes, ou rémunération du capital ;
· ou bien, ils privilégient le développement futur de l'entreprise en autorisant la constitution de réserves importantes, ou bénéfice reporté.
Mais le profit pose d'autres problèmes, de nature théorique, qui opposent les économistes depuis près de deux siècles. Deux conceptions principales s'affrontent : celle des "libéraux", héritiers des classiques et surtout des néoclassiques, et celle des marxistes.
‑ L'analyse libérale du profit :
Pour les économistes libéraux, le profit n'est autre que la rémunération du facteur de production capital tout comme le salaire est la rémunération du travail.
Le profit est fondamentalement sain car il récompense le sacrifice des agents économiques qui s'abstiennent de consommer pour épargner et investir en prenant ainsi un risque : celui de perdre de l'argent.
‑ L'analyse marxiste :
Pour les économistes marxistes, la valeur d'une marchandise ne peut provenir que du travail qui y est inclus. Or la valeur de la marchandise vendue ne revient pas intégralement aux travailleurs, l'entrepreneur (le capitaliste) en garde une fraction : c'est le profit.
Le profit résulte donc de l'exploitation des travailleurs par les capitalistes qui, en détenant les moyens de production (les entreprises), forment une classe dominante.
II. Le partage de la valeur ajoutée est un enjeu social majeur
Le partage de la valeur ajoutée brute (V.A.B.) ne va pas sans conflit puisque, à un moment donné et pour un montant donné de la V.A.B., si la part d'une catégorie augmente, celle des autres diminue d'autant.
De période en période, pour que chacun reçoive plus sans nuire aux autres, il faut donc logiquement que le "gâteau" augmente : c'est la croissance de la V.A.B. qui, en principe, met tout le monde d'accord. Mais en principe seulement, car la croissance est l'occasion pour chaque partie d'essayer de changer la clé de répartition de la V.A.B.
Évidemment, quand la croissance se ralentit ou devient négative, la question devient plus cruciale : une partie ne peut plus alors maintenir son revenu qu'en diminuant la part d'une ou de plusieurs autres.
Imaginons par exemple une économie où la répartition est la suivante : 70 % de la V.A.B. est destinée aux salariés, 30 % aux profits. L'année suivante, la V.A.B. passe de 100 à 120 : si le partage reste le même, suite à cette augmentation de 20 % de la V.A.B., les salariés obtiennent 84, les profits de l'entreprise sont donc de 36.
Mais ce partage peut être modifié : si les salariés obtiennent 80 la deuxième année, ils ont vu leurs rémunérations augmenter alors que le partage de la valeur ajoutée s'est modifié à leur détriment.
L'évolution du partage de la valeur ajoutée en Belgique avant et après la crise des années septante est à cet égard assez révélatrice.
La tendance pendant les "Trente Glorieuses" ou "Golden Sixties" (années de prospérité 1945‑1975) était à la hausse des salaires réels et de leur part dans la valeur ajoutée. En effet, des mécanismes (comme le MINIMEX) les empêchaient de diminuer et d'autres comme les conventions collectives (cf. ) prévoyaient des augmentations régulières liées aux prix et aux gains de productivité. Les salaires ont ainsi progressivement représenté pour l'entreprise une charge plus ou moins incompressible, indépendante, à court terme, de la marche des affaires. Cette évolution pesait sur les profits mais était rendue supportable par la croissance élevée : environ 5 % de valeur ajoutée supplémentaire chaque année. On pouvait alors augmenter un peu les salaires, les dividendes, les investissements et les impôts rentraient dans les caisses de l'État.
La crise a réduit la croissance de moitié et remis en cause ce partage.
Les entreprises, surtout à partir du second "choc pétrolier" de 1979 ont tenté d'alléger la contrainte des salaires en les rendant plus "flexibles", ou en rendant l'emploi lui‑même plus flexible (travail temporaire, contrat de travail à durée déterminée, etc.) et en allégeant leurs effectifs grâce à des investissements de productivité. De fait la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé et celle des profits a augmenté (voir graphique ci‑dessous).
Le partage de la valeur ajoutée est donc au cœur des relations sociales.
|
Quatre agents sont concernés par la répartition de la valeur ajoutée : les salariés, l'entreprise, les actionnaires, l'État.
Le partage de la valeur ajoutée est délicat lorsque la croissance de celle‑ci ralentit ou devient négative.
Depuis le milieu des années 70, Le partage de la valeur ajoutée évolue de façon défavorable aux salaires en Belgique.
|
III.Test sur le Net : production, valeur ajoutée
Exercice / Seconde
(De la part de Danielle Dehoux et Évelyne Oudart)
1. La production:
Voici une liste de biens : une grue, le poste de télévision de monsieur Martin, un tracteur, des pommes de terre achetées par l'entreprise Vico, une moissonneuse batteuse, du pétrole, une machine à coudre destinée à une entreprise d'habillement, le réfrigérateur de monsieur Martin, des composants utilisés pour la fabrication d'ordinateurs, l'électricité utilisée par monsieur Martin, l'électricité utilisée par Renault.
Rappelez la définition du bien de consommation finale :
...celle du bien de consommation intermédiaire :
Les biens de consommation intermédiaire peuvent aussi être appelés :
Qu'est-ce qu'in bien de production :
Remplissez le tableau ci-dessous.
|
Biens de consommation finale |
Biens de consommation intermédiaire |
Biens de production |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
2. Soulignez les termes qui désignent des services
Une coupe de cheveux, un vélo, un cours de français au lycée, la visite à domicile d'un médecin, un ordinateur, un conseil en informatique, la consommation d'un verre de bière dans un café, la projection d'un film dans une salle de cinéma, un prêt accordé par une banque, un magnétoscope, une ronde de nuit effectuée par un car de police, la vente d'un livre, un jugement rendu par un magistrat.
3. Après avoir rappelé la définition d'un service marchand et d'un service non marchand, vous distinguerez les services marchands et non marchands dans la liste qui précède.
*Service marchand :
Définition :
Liste :
*Service non marchand :
Définition :
Liste :
4. Calcul d'un pourcentage de répartition :
En 1990, la valeur totale des biens et des services créés sur le territoire français, le PIB, était égale à 6484 milliards de francs. Sur ces 6484 milliards de francs, 4020 milliards sont des services marchands et non marchands et 2464 milliards des biens.
On souhaite connaître l'importance respective des biens et des services dans le produit intérieur brut en calculant leur part dans le PIB.
Indiquez vos calculs.
5. A l'occasion de la production sont distribués des revenus
Il exploitait cent arpents de vignes qui, dans les années plantureuses, lui donnaient sept à huit cents poinçons de vin. Il possédait treize métairies, une vieille abbaye où, par économie, il avait muré les croisées, ogives, les vitraux, ce qui les conserva ; et cent vingt-sept arpents de prairies où croissaient et grossissaient trois mille peupliers plantés en 1793 ; enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Ainsi établissait-on la fortune visible. Quant à ses capitaux, deux seules personnes pouvaient en présumer vaguement l'importance : l'un était monsieur Cruchot, notaire, chargé des placements usuraires de monsieur Grandet ; l'autre, monsieur des Grassin, le plus riche banquier de Saumur, aux bénéfices duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement.
En 1816, les plus habiles calculateurs de Saumur estimaient les biens territoriaux du bonhomme à près de quatre millions ; mais, comme terme moyen, il avait du tirer par an, depuis 1793 jusqu'en 1817, cent mille francs de ses propriétés ; il était donc présumable qu'il possédait en argent une somme presque égale à celle de ses biens-fonds.
Monsieur Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait , en sus du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le son et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle même tous les samedi le pain de la maison. Monsieur Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il en récoltait une telle quantité qu'il en faisait vendre une partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses haies et ses fermiers le lui charroyaient en ville tout débité, le rangeaient par complaisance dans son bûcher, et recevaient ses remerciements. Ses dépenses connues étaient le pain bénit, la toilette de sa femme, celle de sa fille, et le paiement de leur chaise à l'église ; la lumière et les gages de la grande Nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions, les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations. Il avait six cents arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin, auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, il mangeait du gibier.
Honoré de Balzac, Eugènie Grandet.
Questions :
1. Les efforts de Grandet concourent tous au même but, lequel ?
2. Recensez les diverses sources qui permettent à Grandet d'obtenir ses revenus et dégagez les deux grandes catégories de revenu dont le père Grandet dispose.
3. Le père Grandet peut-il vivre totalement en autarcie ? Justifiez.
4. Les grandes catégories de revenus perçus par Grandet subsistent-elles dans une économie moderne ? Pouvez-vous préciser leur importance respective ?
Dans l'économie contemporaine, rappelez les autres types de revenu que vous connaissez . La justification en est-elle toujours la contrepartie de la production.
Exercice / Seconde
(De la part de Anne Berger)
THÈME : La valeur ajoutée
|
NOM : |
PRÉNOM : |
NOTE : |
/ 20 |
EXERCICE 1:
Vous êtes chargé(e) par le secrétariat d'État à la consommation de surveiller la production des rillettes de porc. Voici les données nécessaires à votre étude.
1. La filière "rillettes" est composée de trois entreprises :
- "Grosgoret", une exploitation agricole élevant des cochons;
- "Porcland" une entreprise agro-alimentaire produisant des rillettes;
- "Jean Bal", une entreprise d'emballages spécialisée dans la production de boîtes en plastique.
2. Les consommations intermédiaires de Grosgoret représentent 30 % de sa production.
3. Porcland a acheté il y a 5 ans des machines dont la durée de vie garantie par le constructeur était estimée à 15 ans (à partir de la date d'achat). Prix du matériel : 1 500 000 F.
4. Jean Bal a acquis l'année dernière du matériel qui devrait fonctionner pendant encore six ans. Prix du matériel : 35000 F.
5. Les cochons de Grosgoret mangent 300 000 F par an de nourriture pour animaux.
6. Un supermarché local achète à Porcland les 500 000 boîtes de rillettes que cette entreprise produit chaque année au prix unitaire de 10 F.
7. Grosgoret n'utilise pas de machines.
8. Porcland n'a pas d'autres matières premières que les cochons achetés à Grosgoret et les boîtes achetées à Jean Bal. Ces deux entreprises ne réalisent pas de stock et vendent à Porcland la totalité de leur production.
9. Prix de la boîte de rillettes vide : 1F.
10. les consommations intermédiaires de Jean Bal représentent 35 % de la valeur de sa production.
Questions :
1) Définissez : consommation intermédiaire, valeur ajoutée et amortissement.
2) Quels problèmes pose la mesure de l'amortissement ?
3) Complétez le tableau ci-dessous :
|
|
Production |
Consommations intermédiaires |
Valeur ajoutée brute |
Amortissement |
Valeur ajoutée nette |
|
GROSGORET |
... |
... |
... |
... |
... |
|
JEAN BAL |
... |
... |
... |
... |
... |
|
PORCLAND |
... |
... |
... |
... |
... |
4) Quelle est la richesse totale créée par ces trois entreprises ?
EXERCICE 2 : Remplir les "trous" .
Un salarié voit son salaire passer de 7500 F à 7800 F entre 1991 et 1994 . Si dans le même temps les prix avaient augmenté de _______ % (calcul 1 à justifier dans le cadre ci-dessous), notre salarié contrairement aux apparences ne se serait pas enrichi .
Le __________________________ de son salaire n'aurait pas augmenté .
Mais l'indice des prix (base 100 en 1980) est passé de 188,3 en 1991 à 200,2 en 1994, l'augmentation des prix a donc été de _____% de 1991 à 1994 (calcul 2). Le pouvoir d'achat de son salaire a donc
______________ de ______ % (calcul 3) entre ces deux dates.
Calcul 1 :
Calcul 2 :
Calcul 3 :
♦ Les différentes formes juridiques |
- LES ENTREPRISES PRIVÉES : INDIVIDUELLES ou SOCIÉTAIRES
- LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
- LES ENTREPRISES SOCIÉTAIRES
- ENTREPRISES PUBLIQUES ET ENTREPRISES MIXTES
- LES ADMINISTRATIONS
Forme juridique : ensemble des règles de droit qui s'appliquent aux entreprises (on parle aussi de statut).
L'évolution de la forme juridique des entreprises correspond souvent à des stades différents du développement économique. En fait, sur le plan juridique, les entreprises se distinguent par la façon dont elles répondent aux questions suivantes :
· Quel est le nombre de leurs propriétaires ?
· Quel est le capital minimum apporté ?
· Ce capital est‑il privé ou public ?
· Les propriétaires sont‑ils responsables des dettes de l'entreprise sur leurs biens personnels ?
· Peuvent‑ils revendre leurs parts librement ?
· Qui, en droit, détient le pouvoir dans l'entreprise ?
· Le profit est‑il le but primordial de l'entreprise ?
Le tableau ci‑dessous nous donne (ou rappelle, cfr. étape 1) ainsi les principales formes d'entreprises :
|
|
Entreprises privées |
Entreprises publiques |
Entreprises mixtes |
|||||
|
|
Entr. individuelles |
Entr. sociétaires |
|
|
||||
|
|
Entr. individuelles |
SPRLU |
de personnes (nom collectif) |
SPRL (capitaux ou mixtes) |
SA (capitaux) |
Coopératives |
|
|
|
Nombre de propriétaires |
1 |
1 |
2 ou + |
2 à 50 |
7 ou + |
variable |
1 (État) |
variable (dont État) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital minimum |
|
750 000 |
|
750 000 |
2,5 M |
variable |
|
|
|
Capital privé/public |
privé |
privé |
privé |
privé |
privé |
privé |
public |
public et privé |
|
Propriétaires responsables sur leurs biens |
oui |
non |
oui |
non |
non |
non |
non |
non |
|
Revente libre des actions ou parts |
|
|
non |
non |
oui (si entièrement libérées) |
non |
non |
oui/non |
|
Pouvoir de décision |
chef d'entreprise |
chef d'entreprise |
gérants et/ou associés |
gérants et/ou associés |
actionnaires principaux et administrateurs |
associés |
ministres et administrateur délégué |
ministres et administrateur délégué |
|
Profit = but principal ? |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
non |
oui/non |
oui/non |
Les entreprises individuelles représentent plus de la moitié (56 %) des entreprises alors qu'elles n'emploient que 9,3 % des salariés. Ce sont donc généralement de petites entreprises (en moyenne moins d'un salarié par entreprise).
Les sociétés sont plus grandes (5 salariés en moyenne). Mais cette moyenne recouvre des inégalités importantes. Les sociétés civiles (qui associent des membres de professions libérales, médecins, avocats, etc.) ont moins d'un salarié en moyenne, alors que les S.A. comptent 52 salariés en moyenne. Les S.A. sont elles‑mêmes hétérogènes : certaines emploient de très nombreux effectifs, 205 000 salariés chez Alcatel Alsthom, 159 000 chez Peugeot‑S.A., par exemple. Le record mondial appartient au constructeur américain d'automobiles, General Motors, qui compte 761 000 salariés.
I. LES ENTREPRISES PRIVÉES : INDIVIDUELLES ou SOCIÉTAIRES
|
Les entreprises individuelles |
Les entreprises sociétaires |
|
Caractères |
|
|
Elle sont créées et gérées par une seule personne physique (entrepreneur). Des salariés sont parfois employés mais en nombre réduit. |
La société est un contrat par lequel (sauf SPRLU) deux ou plusieurs personnes décident de mettre leurs apports en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. |
|
Exemples |
|
|
l'indépendant la SPRLU |
les S.A. ; S.P.R.L. S.C. ; S.C.R.L. |
|
Avantages |
|
|
Le patron décide seul. Il recueille le bénéfice. Le coût et les formalités sont limités. |
Les capitaux sont importants, d’où l’entreprise a de meilleures conditions d’achat. La responsabilité est souvent limitée aux apports. Elle obtient facilement des crédits. |
|
Inconvénients |
|
|
Il manque de capitaux car il est seul. Il effectue seul son travail. En cas de perte, il est seul à la supporter. Il engage toute sa fortune personnelle (le patrimoine de l’entreprise se confond avec celui du chef d’entreprise). |
Le bénéfice doit être partagé. Les décisions sont lentes à prendre. Les frais de constitutions sont importants.
|
II. LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
A. Introduction
C'est la forme la plus fréquente, la plus simple, et la plus ancienne.
Entreprise individuelle : entreprise qui appartient à un seul individu (ou à plusieurs) qui en apporte(nt) le capital et qui en est (sont) la (les) seule(s) responsable de tous ses avoirs et ses dettes.
Un seul propriétaire en est entièrement responsable et la gère, tout en y travaillant personnellement.
La plupart des entreprises agricoles, des entreprises artisanales, des petits commerces et des cabinets médicaux ont cette forme. Le plus souvent, lors de sa création, une entreprise adopte ce statut juridique, quitte à en changer ensuite quand elle devient plus importante. L'entrepreneur est libre et indépendant, il consacre un maximum d'initiatives et tous ses soins à son entreprise. Le bénéfice reste entièrement entre les mains de l'entrepreneur individuel. Il n'est pas impossible qu'un entrepreneur individuel ait du personnel rémunéré.
Ces entreprises individuelles font partie des P.M.E. (petites et moyennes entreprises) qui comportent moins de 500 salariés, et jouent un rôle important dans nos économies. Elles sont en effet créatrices d'emplois (celui du chef d'entreprise et ceux des salariés éventuels) et le font de manière décentralisée, sur tout le territoire, dans les grandes agglomérations, dans les petites villes, dans les campagnes.
Le propriétaire est entièrement responsable des dettes, y compris sur ses biens personnels. Sa capacité financière est généralement limitée et le recours au crédit difficile.
Récemment, est apparu une nouvelle forme d'entreprise individuelle qui a une forme sociétaire : la S.P.R.L.U. dans laquelle le propriétaire (unique) de l'entreprise n'est plus responsable des dettes de son entreprise sur ses biens personnels.
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Que faut-il faire pour devenir indépendant ?
Une question importante à se poser :
- Disposez-vous de la formation requise ?
En effet, il faut savoir que 46 professions indépendantes sont actuellement soumises à une réglementation (voir tableau) tant au niveau du métier lui-même que la gestion d'une telle activité. Cette capacité est analysée par la Chambre des métiers et négoces (une par province) qui évalue votre formation (diplômes) et/ou votre expérience avant de vous décerner cet accès à la profession.
Démarches à accomplir :
- Registre de commerce : En dehors des professions libérales (médecin, avocats, notaires...), toute personne voulant s'établir à son compte doit être inscrite au registre de commerce ou de l'artisanat (pour les artisans). Cette démarche est obligatoire pour pouvoir obtenir par la suite un numéro de T.V.A. Elle doit se faire auprès des bureaux de registres de commerce installés dans chaque région.
- Immatriculation à la T.V.A. : Tout producteur, commerçant ou prestataire de services doit également disposer d'un numéro d'immatriculation à la T.V.A. Il facturera la TVA à ses clients et fera en suite la balance avec la TVA facturée par ses fournisseurs. Tous les mois (ou tous les trois mois), il devra rédiger une déclaration reprenant le montant de toutes les opérations commerciales effectuées. Pour ce faire, il devra tenir un facturier d'entrées et un autre de sorties ainsi qu'un journal de recettes.
- Affiliation à une caisse d'assurances sociales : Comme l'indépendant n'est pas couvert socialement par un patron, il faut qu'il s'affilie à une caisse d'assurances sociales à laquelle il consacrera une partie de ses revenus. Il sera ainsi couvert en matière d'allocations familiales, de pension et de soins de santé (gros risques). Cette affiliation doit s'effectuer dans les 90 jours à partir du début de l'activité.
- Ouverture d'un compte bancaire : Pour éviter de mélanger compte privé et compte professionnel, vous devrez demander l'ouverture d'un compte supplémentaire.
Problèmes...
Toutes ses démarches demandent du temps, des déplacements et certains frais.
Pour certaines professions, il faut également disposer d'autorisations particulières (locaux, hygiène, protections, assurances...).
De même si vous n'êtes pas ressortissant de la Communauté Européenne, il vous faudra obtenir une carte professionnelle avant d'exercer un métier. Si vous êtes chômeurs, vous devrez vous renseigner auprès de l'ONEM afin de ne pas perdre tous vos droits en vous lançant dans l'aventure indépendante. De même, si vous êtes pré-pensionné ou pensionné.
Quarante-six professions sont réglementées en Belgique.
Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. La plupart des professions indépendantes de Belgique sont réglementées et l'autorisation d'exercer est octroyée par les chambres des métiers et négoce sur base de diplôme et/ou d'années d'expérience. En voici la liste :
Loi de 1970 pour les professions dites manuelles :
1. Entrepreneur menuisier-charpentier 22. Garagiste-réparateur
2. Installateur en chauffage central 23. Négociant en véhicules d'occasion
3. Entrepreneur plafonneur-cimentier 24. Carrossier-réparateur
4. Entrepreneur de peinture 25. Entrepreneur tailleur de pierres
5. Tapissier-poseur de revêtements de murs et 26. Entrepreneur marbier
du sol 27. Négociant-détaillant en combustibles
6. Entrepreneur de maçonnerie et de béton solides
7. Entrepreneur de carrelage 28. Négociant-détaillant en combustibles
8. Installateur électricien liquides
9. Entrepreneur de vitrage 29. Coiffeur
10. Installateur sanitaire et de plomberie 31. Opticien
11. Installateur de chauffage au gaz par 32. Photographe
appareils individuels 33. Horloger-réparateur
12. Entrepreneur de zinguerie et de couvertures 34. Technicien en prothèses dentaires
métalliques de construction 35. Installateur-frigoriste
13. Entrepreneur de couvertures non-métalliques 36. Dégraisseur-teinturier
de construction 37. Blanchisseur
14. Entrepreneur d'étanchéité de construction 38. Entrepreneur de pompes funèbres
15. Entrepreneur de travaux de construction 39. Fabricant-installateur d'enseignes
16. Meunier lumineuses
17. Négociant en grains indigènes 40. Restaurateur ou traiteur-organisateur
18. Négociant en fourrage et pailles de banquets
19. Mécanicien de cycles 41. Boulanger-pâtissier
20. Mécanicien de cyclomoteurs 42. Esthéticienne
43. Commerçant de détail
Loi de 1976 pour les professions dites intellectuelles :
44. Comptable
45. Agent immobilier
46. Géomètre expert juré
III.LES ENTREPRISES SOCIÉTAIRES
Certains auteurs définissent l'entreprise sociétaire comme étant celle qui appartient à plusieurs associés. En Belgique, il nous paraît utile d'ajouter qu'il faut avoir un but de lucre (par opposition aux associations et à l'exclusion des entreprises publiques) et prendre une des formes commerciales reconnues par la loi. On y distingue les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives.
A. Les sociétés de personnes
Elles se constituent entre deux ou plusieurs personnes qui se connaissent bien : des parents, un groupe d’amis qui s’associent pour collaborer. Ces associés sont donc des propriétaires de l’entreprise et vont :
· jusqu’à offrir tous leurs biens propres en garantie de la solvabilité de la société : c’est ce qu’on appelle "la responsabilité indéfinie" (illimitée) ;
· jusqu’à s’engager l’un pour l’autre vis-à-vis des tiers, les engagements pris par l’un obligent les autres vis-à-vis des tiers : c’est ce qu’on appelle "la responsabilité solidaire".
Dans ce type de société, l’élément fondamental est la prise en considération de la personnalité des associés. Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, c’est à dire que toute leur fortune est engagée et qu’ils sont liés par les actes de gestion posés par leurs partenaires. La société prend fin à la mort du gérant.
Exemples : SNC (= société en nom collectif), SCS (société en commandite simple), SCRIS (société coopérative à responsabilité illimité et solidaire).
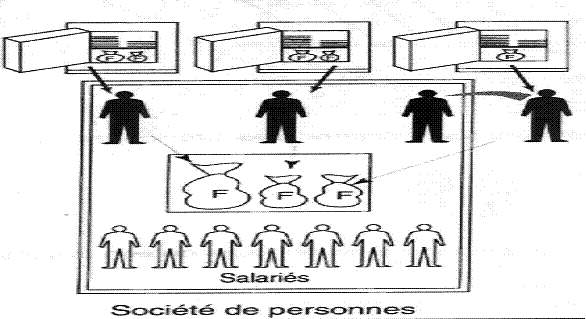
|
|
|
|
Elles se sont développées à partir du moment où les besoins de capitaux financiers sont devenus plus importants.
La fortune d'une seule personne ne suffisant pas pour fonder ou développer une entreprise, on s'associe ; mais chacun reste responsable des dettes de l'entreprise sur tous ses biens, y compris personnels.
Cette disposition implique une cohésion sans faille entre les associés. Aussi l'association s'effectue‑t‑elle le plus souvent avec des parents ou amis. D'où la nécessité d'avoir l'accord des associés pour pouvoir vendre ses parts.
1. La S.N.C.
La société en nom collectif est celle que contractent deux ou un plus grand nombre de personnes et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Cette dernière peut être formée de plusieurs façons :
- le nom de tous les associés s’ils sont peu nombreux ;
- le nom de deux ou trois associés suivis des mots & C° ;
- le nom d’un seul associé suivi des mots & C°.
La loi impose cette prescription parce que la S.N.C. est composée d’associés tenus solidairement, le nom de la société est donc aussi le leur ; la loi a voulu empêcher que les tiers ne soient induits en erreur par suite de l’existence dans la raison sociale de noms de personnes étrangères à la société, et que ces tiers ne soient amenés à donner à celle - ci plus de crédit qu’elle n’en mérite réellement.
Les associés sont responsables :
· solidairement : les associés répondent solidairement, chacun pour tous, vis à vis des tiers de tous les engagements de la société, même lorsque ces engagements n’ont été pris que par l’un des associés, à condition que ce soit la raison sociale. Les créanciers peuvent contraindre n’importe lequel des associés pour la totalité des dettes de la société.
· indéfiniment : tous les associés s’engagent non seulement jusqu'à concurrence de leur apport mais aussi pour tout leur avoir personnel en dehors de la société.
2. La S.C.S.
La société en commandite simple est celle qui comprend deux groupes d’associés :
· les commandités indéfiniment et solidairement responsables (les commerçants).
· les commanditaires qui ne sont responsables qu’à concurrence de leur apport.
La société existe sous une raison sociale qui ne peut comprendre que le nom des commandités. L’associé commanditaire ne peut poser aucun acte de gestion, même en vertu d’une procuration.
L’acte de constitution peut être authentique ou sous seing privé.
B. Les sociétés de capitaux
La société à responsabilité limitée (SPRL, nouvelle formule, que nous préférons classer dans les sociétés mixtes) et la société anonyme sont les formes de sociétés de capitaux les plus répandues. L’élément fondamental est l’apport des associés. Les associés n’engagent qu’une mise déterminée.
Exemple : SA.
1. La S.P.R.L.
Bien que rangée parmi les sociétés de capitaux, c'est en fait une forme intermédiaire, très répandue, entre la société de personnes (son ancien nom était "société de personnes à responsabilité limitée") et la société de capitaux.
En effet, comme dans les sociétés de personnes, l'accord des associés est nécessaire pour pouvoir céder ses parts ; en revanche, comme dans les sociétés de capitaux, les propriétaires n'engagent pas leurs biens personnels pour payer les dettes de la société en faillite.
Nous y reviendrons dans "les sociétés mixtes".
2. La S.A.
C'est la forme la plus récente et la plus achevée de la société de capitaux, celle qu'adoptent généralement les grandes entreprises. La S.A. est celle dans laquelle au moins deux associés n’engagent qu’une mise déterminée.
Elle n’existe pas sous une raison sociale, elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés, elle est qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise.
a) Son origine
Elle s'est développée plus tardivement au XIXe siècle) et au XXe siècle, avec l'essor de la grande industrie qui exigeait d'énormes quantités de capitaux.
En émettant des actions dans le public, la S.A. draine des sommes considérables pour constituer son capital. Ainsi le capital de la société anonyme est-il le montant global des actions émises, évaluées à leur valeur nominale (à leur valeur d'émission).
b) Sa création
Le capital doit être entièrement souscrit et ne peut être inférieur à 2 500 000 BEF. Le capital souscrit doit être libéré à concurrence d’au moins un quart sans que la libération puisse être inférieure à 2 500 000 BEF. Les actions correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de 5 ans.
La société doit être constituée par un acte authentique. Les apports en nature doivent faire l’objet d’un apport du réviseur désigné préalablement à la constitution par le fondateurs.
Les fonds sont préalablement à la constitution versés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
Les fondateurs doivent remettre au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer.
L’acte de la société indique :
n la forme et la dénomination de la société ;
n la désignation précise de l’objet social ;
n la désignation précise du siège social ;
n la durée de la société, lorsqu’elle n’est pas illimitée ;
n le montant du capital social souscrit ainsi que le montant de la partie libérée (éventuellement le montant du capital autorisé) ;
n le nombre et le mode de désignation des représentants des organes de gestion ;
n le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions représentatives du capital social ;
n le nombre et le droit des parts bénéficiaires ;
n l’identité des fondateurs (au moins deux représentants, au moins un tiers du capital social, ils sont responsables en cas de faillite dans les trois ans de la constitution si le capital était manifestement insuffisant).
La S.A. peut également être constituée sous forme de souscription. Elle est administrée par un conseil d’administration, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Le capital se divise en actions, avec ou sans mention de valeur. Elles peuvent être nominatives ou non.
La modification des statuts est décidée par l’assemblée générale à majorité des ¾ des voix et si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social (majorité spéciale des 4/5, si la modification porte sur l’objet social).
c) Situation et rôle de l’actionnaire
L'actionnaire est propriétaire d'une part de l'entreprise.
À ce titre, il peut participer aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires, selon le principe : une action égale une voix.
L'assemblée générale approuve les comptes de la société, les grandes orientations de sa gestion, et désigne le Conseil d'administration.
L'actionnaire peut vendre librement ses actions.
Pour les sociétés les plus importantes, cette vente s'effectue à la Bourse des valeurs, marché où s'établit le cours (c'est‑à‑dire le prix) des actions échangées. Selon que ce cours est supérieur ou inférieur au prix auquel l'actionnaire a acheté ses actions, il réalisera soit une plus‑value, soit une moins‑value.
L'actionnaire reçoit une part des bénéfices distribués par l'entreprise, le dividende, proportionnelle au nombre d'actions possédées.
Dividende : part distribuée des bénéfices de l'entreprise.
Return : ce que rapporte une action, non seulement en dividende reçu, mais aussi en variation de sa valeur comptable et/ou boursière (que l'on pourrait percevoir en cas de revente de l'action).
d) Le financement des S.A.
Pour qu'il y ait dividende, il faut non seulement que l'entreprise fasse des bénéfices mais aussi que l'assemblée générale accepte la distribution de tout ou partie du bénéfice réalisé. Cette décision dépend des résultats de sa gestion : il faut généralement que l'entreprise garde une partie du bénéfice pour investir, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement.
Autofinancement : somme que l'entreprise consacre à ses investissements à partir de ses propres bénéfices.
Mais deux autres options s'offrent aussi à l'entreprise qui souhaite se procurer de nouveaux capitaux : l'émission d'actions nouvelles, opération qui lui permet de se financer sans s'endetter mais en augmentant son capital. L'entreprise peut aussi recourir au crédit bancaire ou à l'emprunt auprès du public. Dans ce dernier cas, pour que l'emprunt soit accessible aux épargnants (les sommes empruntées sont souvent considérables), il est divisé en un grand nombre de titres : les obligations. Les épargnants qui prêtent leur argent à l'entreprise, reçoivent ces titres en échange, ce qui leur donne droit au paiement annuel d'un intérêt fixe ou variable, en attendant le remboursement, à une date convenue, de la somme prêtée.
|
Bénéfices de l'entreprise |
|
Financement de l'entreprise |
||
|
Bénéfices non distribués |
à à |
AUTOFINANCEMENT |
||
|
Bénéfices distribués |
à dividendes à |
ACTIONNAIRES |
à émission d'actions nouvelles à |
AUGMENTATION DE CAPITAL |
|
|
|
PUBLIC |
àobligationsà |
EMPRUNT |
e) La différence entre obligataire et actionnaire
L'obligataire n'est nullement responsable de l'usage qui est fait de ses capitaux. II n'a donc aucun droit de regard sur le fonctionnement de l'entreprise ; ses seuls droits sont le paiement régulier des intérêts et le remboursement de la somme prêtée (il n'y a donc pas de return pour les obligations, car [en principe] pas de variation du montant facial du titre. En cas de faillite de l'entreprise, l'obligataire a la priorité sur l'actionnaire pour récupérer l'argent qu'elle lui doit. En réalité, le pouvoir de décision échappe généralement aux petits actionnaires. En effet, individuellement, en fonction du principe "une action égale une voix", ils n'ont aucune influence à l'assemblée générale. D'ailleurs, conscients de cette impuissance, ils ne participent que très peu à ces assemblées.
Le pouvoir appartient donc aux actionnaires les plus importants : souvent des sociétés d'assurances, caisses de retraite, banques et autres sociétés.
L'actionnaire, en revanche, est porteur d'un titre de propriété : l'action. De ce fait, il n'a pas droit à un quelconque remboursement tant que la société existe. Éventuellement, si la société est dissoute, il pourra recevoir, au prorata de ses actions, une part de la valeur de la société après paiement de toutes ses dettes. En cas de faillite, il est fréquent qu'il ne reçoive rien. En résumé, en tant que copropriétaire de l'entreprise, l'actionnaire bénéficie éventuellement de ses bons résultats en percevant des dividendes mais il en supporte également les risques, limités il est vrai, dans les sociétés de capitaux, au montant de ses actions.
f) La notion de groupe : définition, participations et filiales
Groupe d'entreprises : réunion des sociétés qui dépendent d'un même centre de décision.
Le centre de décision est une entreprise dite "société‑mère" qui prend souvent la forme d'une société de portefeuille appelée plus communément société holding (de l'anglais to hold : détenir). Le holding a pour seule tâche de gérer l'ensemble des participations (actions possédées) par les sociétés du groupe.
Dans l'organigramme ci-dessous, le holding H possède la majorité absolue des actions (respectivement 75 % et 51 %), donc la majorité absolue des voix, dans les sociétés A et C. On dit que ces sociétés sont ses filiales. On dit encore que H exerce un contrôle majoritaire sur A et C. Par contre, il possède une participation minoritaire dans B.
Mais une société n'a pas besoin de posséder directement la majorité des actions d'une autre pour la contrôler.
Pour le comprendre, calculons tout d'abord la part du capital que H possède dans D. Nous trouvons : (51/100) x 51 = 26,01 % des actions de D : le montant de ses actions ne permet pas à H d'avoir la majorité dans D. Pourtant aucune décision à la majorité absolue ne peut être prise dans D sans le consentement de H. En effet, C possède 51 % du capital de D (D est donc une filiale de C), et comme C est une filiale de H, on dira que D est une sous-filiale de H. Autrement dit, puisque H contrôle majoritairement C et que C contrôle majoritairement D, H contrôle indirectement D : aucune décision de D ne pourra être prise contre la volonté de H.
Ajoutons que si le holding H ne possède, à travers C, que 26,01 % des actions de D, il possède une autre fraction du capital de D à travers sa participation minoritaire dans B qui a elle‑même une participation minoritaire dans D. Au total, H possède donc 26,01 + (31/100)x 20 = 32,21 % du capital de D. À ce titre, H percevra 32,21 % des dividendes éventuels de D.
|
Dans leur volonté d'expansion, les groupes débordent les frontières nationales, fondent des filiales à l'étranger et deviennent ainsi des firmes multinationales. La plupart des grandes entreprises françaises sont dans ce cas et la France compte sur son sol de nombreuses filiales de groupes multinationaux étrangers. Ainsi, les entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers Exxon et Mobil sont américaines, Shell est d'origine anglo‑hollandaise, British Petroleum est anglaise et Seca est belge (Vilvorde). Inversement, l'entreprise française Total a des filiales à l'étranger. Ainsi se tissent au travers des frontières des échanges croisés de capitaux.
C. Les sociétés mixtes
1. La S.P.RL.
Bien que rangée parmi les sociétés de capitaux, c'est en fait une forme intermédiaire, très répandue, entre la société de personnes (son ancien nom était "société de personnes à responsabilité limitée") et la société de capitaux.
En effet, comme dans les sociétés de personnes, l'accord des associés est nécessaire pour pouvoir céder ses parts ; en revanche, comme dans les sociétés de capitaux, les propriétaires n'engagent pas leurs biens personnels pour payer les dettes de la société en faillite.
La S.P.R.L. est celle constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent que leur apport et où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions.
La société peut compter comme associés des personnes physiques ou des personnes morales. S’il s’agit d’une société unipersonnelle constituée par une personne physique, cette personne bénéficie de la séparation des patrimoines.
Le capital doit être d’un montant minimum de 750.000 BEF, intégralement souscrit, la libération doit atteindre au moins 250.000 BEF.
Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Chaque part doit être libérée d’un cinquième au moins, mais les parts représentatives d’apports doivent être libérées intégralement.
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à 1.000 BEF. On ne peut pas créer des parts privilégiées ou des parts bénéficiaires non représentatives du capital.
Les comparants à l’acte constitutifs sont considérés comme fondateurs. Leur responsabilité est analogue à celle des fondateurs de S.A.
Il est tenu au siège de la société un registre des associés qui mentionne :
- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;
- l’indication des versements effectués ;
- les transferts et transmissions de parts.
D. Les sociétés coopératives
1. La présentation des coopératives
La S.C. est celle qui se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables. Le nombre des associés et par conséquent le capital est variable ; les parts sociales sont, en principe, incessibles à des tiers ; la société n’existe pas sous une raison sociale, elle est qualifiée par une dénomination particulière.
La S.C. peut revêtir deux formes :
- la S.C.R.L., la S.C. à responsabilité limitée (cfr. conditions pour les S.P.R.L.)
- la S.C.R.I.S., la S.C. à responsabilité illimitée et solidaire.
2. Les fondements des coopératives
Ils font partie de ce que l'on appelle l'économie sociale, dans le sens où :
· la recherche du profit n'est pas le mobile le plus important de ces entreprises,
· les propriétaires de la coopérative sont des associés, soit parce qu'ils y travaillent soit parce qu'ils en sont les utilisateurs ou les clients,
· les décisions sont prises (à la différence des autres sociétés où une action égale une voix) selon le principe : un homme égale une voix.
"le but de la coopération, c'est de travailler pour soi sans doute, mais aussi pour les autres. J'estime que c'est rabaisser le rôle de la coopération que de la faire servir à des fins individualistes et que son véritable rôle est de servir à des fins collectives. Ce que la coopération doit poursuivre, ce n'est pas une œuvre de salut individuel, mais une œuvre de transformation sociale" écrivait Charles Gide (1847‑1932), professeur de droit et théoricien de la société coopérative.
3. La diversité des coopératives
Vous connaissez certainement des exemples de coopératives de consommateurs qui ont pour objectif de fournir à leurs adhérents, au meilleur prix, des biens et des services de la meilleure qualité : coopératives scolaires, magasins COOP, FNAC, CAMIF... Les bénéfices réalisés sont réinvestis pour une part et pour le reste distribués aux coopérateurs, au prorata de leurs achats, sous forme de rabais.
Dans les SCOP (Coopératives ouvrières de production), l'objectif des coopérateurs est de mettre leur travail en commun dans une entreprise dont ils partagent le capital, donc la propriété, et la gestion. De très nombreuses SCOP existent dans le bâtiment, l'imprimerie, etc. Certaines SCOP (la Verrerie ouvrière d'Albi, par exemple) ont d'ailleurs atteint une taille industrielle respectable.
La coopération s'est aussi beaucoup développée dans l'agriculture, et les industries agro‑alimentaires : coopératives d'achat de fournitures, de vente et de transformation (coopératives laitières, vinicoles), les CUMA (coopératives d'utilisation du matériel agricole)...
On trouve aussi des coopératives dans le domaine de la banque : DEXIA Banque en Belgique, Crédit Agricole, Banques Populaires.
IV.ENTREPRISES PUBLIQUES ET ENTREPRISES MIXTES
En économie de marché, les entreprises privées, coexistent souvent avec un secteur public étendu ; c'est notamment le cas en Belgique. En ce sens l'économie est parfois qualifiée d'économie mixte.
A. Caractéristiques générales
Ces entreprises sont, en totalité ou en grande partie, la propriété de la collectivité nationale représentée par l'État. Elles prennent des formes juridiques très diverses qui vont de la société anonyme à la quasi‑administration. D'où un degré d'autonomie par rapport à l'État lui aussi très variable. Ces entreprises ont pour but principal et originel de rendre un service à un maximum de public.
Entreprise de services publics : entreprise qui appartient totalement ou essentiellement à un pouvoir public et dont la recherche de gain est limitée par des considérations sociales.
B. Pourquoi des entreprises publiques ?
L'origine de l'entreprise publique en France est fort ancienne : les Manufactures Royales des Gobelins, d'Aubusson ou de Sèvres ont été fondées au XVIIe s. Mais c'est surtout à l'époque contemporaine que cette forme d'entreprise s'est développée. La France a ainsi connu trois grandes vagues de nationalisations : en 1936-37, en 1945‑1946 et 1981‑1982. À l'inverse, une vague de privatisations a eu lieu en 1986‑1987. L'actuel gouvernement Jospin parle d'ouverture du capital au public, mais refuse l'idée de privatisation (on est socialiste ou pas...)
Les nationalisations obéissent à des stratégies économiques précises
· redresser le pays en 1945‑1946 par la nationalisation de l'énergie (E.D.F., G.D.F., Charbonnages de France), et des principales banques de dépôt,
· ou, en 1981‑1982, utiliser de puissantes entreprises publiques et le système de crédit nationalisé pour lutter contre la crise.
II peut s'agir d'un moyen de contrôler et d'orienter un monopole vers la satisfaction de l'intérêt collectif : quand E.D.F. en 1945 obtient, de fait, le monopole de la distribution de l'électricité en France, cela permet de rationaliser la production mais le risque est grand de voir l'entreprise utiliser son monopole dans un secteur vital pour imposer ses propres objectifs au détriment peut‑être de l'intérêt général. La nationalisation du monopole ( l'ancienne Régie des Téléphones et Télégraphes, devenue Belgacom) permettait son contrôle par l'État.
Les motifs peuvent être stratégiques au sens militaire du terme : les arsenaux sont des entreprises publiques depuis l'Ancien Régime, le groupe Dassault nationalisé en 1981, une partie des industries d'armement a été nationalisée en 1983.
II peut s'agir de sauver de la ruine des entreprises en difficulté mais nécessaires à la collectivité : la S.N.C.F. en 1937, la sidérurgie en 1981.
Les motifs peuvent être fiscaux : faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ainsi la production de tabacs et d'allumettes devint‑elle monopole d'État sous le Consulat.
Il peut aussi s'agir de pallier l'insuffisance de l'entreprise privée. Ce fut le cas des Manufactures Royales.
D'autres motifs peuvent également apparaître. Ainsi les usines Renault ont-elles été nationalisées pour fait de collaboration avec l'occupant allemand pendant la dernière guerre. En 1990, Renault a changé de statut : c'est désormais une société anonyme contrôlée à 75 % par l'État, qui semble oublier son rôle d'actionnaire principal dans les événements de fermeture de l'usine de Vilvorde en 1997.
De toute façon, il importe de remarquer que dans les pays capitalistes même si le secteur public est très étendu, il n'en reste pas moins fortement influencé par l'économie de marché. Par exemple dans le secteur concurrentiel (les entreprises industrielles ou de service soumises à la concurrence nationale et internationales), les entreprises publiques fonctionnent souvent comme les entreprises privées du même secteur. Ainsi Renault est en concurrence avec Peugeot ; si le groupe Air‑France semble avoir un quasi‑monopole en France, il n'est pas moins durement concurrencé par les compagnies aériennes étrangères, si le groupe Belgacom a encore un quasi‑monopole en Belgique (jusque fin 1998), il n'est pas moins durement concurrencé par les compagnies de télécommunications étrangères. Donc, ces entreprises doivent elles aussi abaisser leurs coûts et sinon faire systématiquement un bénéfice maximum, du moins rechercher le moins de pertes possibles.
C. Les sociétés d'économie mixte
Elles diffèrent des entreprises publiques par le fait qu'une part seulement de leur capital est propriété publique, le plus souvent 51 %, ce qui permet à la collectivité d'en conserver le contrôle, tout en bénéficiant de l'apport de capitaux privés. Elles ont ainsi plus de souplesse dans leur fonctionnement financier ; par exemple une augmentation de capital ne fera pas nécessairement appel au budget de l'État, il sera possible de recourir à l'épargne des particuliers. En France, la Compagnie française de pétroles ou encore Air France sont des sociétés d'économie mixte. En Belgique, la SABENA et Belgacom en sont.
V. LES ADMINISTRATIONS
Le terme d'administration doit être ici compris au sens que lui accorde la Comptabilité nationale. II s'agit d'unités de production qui produisent des services gratuits, ou quasi‑gratuits. Le but des administrations n'est donc pas la recherche du profit, mais plutôt de "rendre service" à leurs utilisateurs.
On distingue généralement les administrations publiques et les administrations privées.
Les administrations publiques produisent des services non‑marchands, ou se chargent d'opérations de redistribution. Ainsi, l'éducation communautaire est une administration ; son coût réel n'est pas assumé par ses utilisateurs mais par un financement indirect, qui a pour source les prélèvements obligatoires.
Au sens large, les administrations publiques comprennent, non seulement les administrations centrales dépendant de l'État (c'est‑à‑dire les différents ministères) et les administrations dépendant des collectivités locales (communes, provinces, communautés, régions), mais aussi la Sécurité sociale, financée par les cotisations sociales. Les salariés des administrations sont appelés fonctionnaires.
Les administrations privées proposent des services marchands à but non lucratif ou des services non‑marchands destinés aux ménages (associations, syndicats, partis politiques, églises, etc.).
♦ Objectifs et principes de la comptabilité nationale |
I. Les objectifs
Le système élargi de comptabilité nationale (SECN) a été adopté en 1976 pour harmoniser la comptabilité nationale belge avec celles des autres pays.
Rappelons que l’activité économique est constituée de l’ensemble des opérations qui, au départ de la production de biens et services, aboutissent à la satisfaction des besoins des individus.
Pour atteindre cet objectif, divers facteurs de production sont mis en oeuvre par l’entreprise et fournissent, de la sorte, des revenus aux détenteurs de ces facteurs sous forme de salaire, intérêt, profit, ...
La comptabilité nationale est une technique d’évaluation quantitative - exprimée en valeur monétaire - de l’activité économique (les flux) exercée par une nation pendant une période déterminée (en principe : l’année civile).
La comptabilité nationale est "la présentation dans un cadre comptable rigoureux de l'ensemble des informations chiffrées relatives à l'activité économique. Elle décrit les phénomènes fondamentaux de la production, de la distribution, de la répartition et de l'accumulation des richesses" (E. Malinvaud, Initiation à la comptabilité nationale, PUF, 1964).
On peut comparer la comptabilité nationale à un modèle réduit ou à une maquette de l'économie d'un pays : en partant de la multitude d'opérations effectuées pendant une année par l'ensemble des agents économiques, elle effectue des regroupements :
· des acteurs au sein des six secteurs institutionnels (v. étape l) ;
· des relations entre les acteurs par catégories d'opérations : sur biens et services, de répartition, financières ;
· de l'ensemble des opérations au niveau national ou macro-économique : ce sont les agrégats ; produit intérieur brut (PIB), revenu national brut, etc. (v. infra, 3).
La publication régulière des comptes de la nation par l'INS (en France) ou l'INSEE (en Belgique) permet d'observer et d'analyser l'évolution des principaux indicateurs du tableau de bord de l'économie. À partir de la maquette que lui fournit la comptabilité nationale, l'INS réalise, à la demande des pouvoirs publics, des prévisions et des simulations : lors de la préparation du budget de l'État, le ministère du Budget doit disposer d'une analyse de la situation économique, et de son évolution prévisible, avant de projeter les grandes masses de dépenses et de prélèvements de l'État pour l'année à venir (v. chap. 10, 2, A).
Ses objectifs sont divers. Elle permet, notamment de :
· identifier et analyser les relations entre agent économique ;
· évaluer et analyser la structure et l’évolution des principales grandeurs macro-économiques nationales (les revenus, la consommation, l’épargne, l’investissement, etc ...) ;
· situer, dans le temps et dans l’espace, l’économie nationale par des analyses comparatives ;
· élaborer, de manière prévisionnelle, des stratégies d’organisation et de gestion de l’économie nationale.
II. Les principes
La méthode présentée ci-dessous se limite à l'élaboration du cadre central de la comptabilité nationale : les comptes des secteurs institutionnels, le tableau des entrées-sorties (TES) et le tableau économique d'ensemble (TEE), à l'exclusion du tableau des opérations financières et des comptes de patrimoine. En dehors de ce cadre central, la comptabilité nationale publie des comptes satellites (comptes de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, du patrimoine naturel...).
- La présentation des comptes : ressources et emplois
- Le principe de partie double
- Les comptes et soldes intermédiaires
- Les approches de la compta nationale
- Équilibre financier des secteurs institutionnels : besoin de financement
- Égalité Emplois = Ressources en économie fermée
- Tableau économique d'ensemble
A. La présentation des comptes : ressources et emplois
Les comptes des différents secteurs institutionnels enregistrent dans la partie droite les ressources dont le secteur a bénéficié pendant l'année, et dans la partie gauche les emplois, c'est-à-dire la façon dont il a utilisé ses ressources.
Ressources, emplois : chaque opération (non financière) effectuée par un secteur institutionnel (agent) est enregistrée en :
· ressources, à droite, si l'opération correspond à une entrée de monnaie ;
· emplois, à gauche, si l'opération correspond à une utilisation de monnaie.
· Solde d'un compte = total des ressources - total des emplois.
Le solde (positif ou négatif) est porté à gauche, en bas de la partie "emplois".
Pour illustrer ces définitions, la Sylvadie, pays d'Europe centrale issu de l'imagination du père belge de Tintin, Hergé (Le Sceptre d'Ottokar), nous servira d'exemple. Sa monnaie est le khôr (Kh). On suppose provisoirement que la Sylvadie n'entretient pas de relations avec le Reste du monde, et que son économie est constituée de trois secteurs institutionnels (SI) seulement : ménages, entreprises et administrations.
Pendant l'année N, les ménages syldaves ont effectué les opérations suivantes : ils ont reçu 85 Mds Kh de revenus d'activité et de la propriété versés par le SI des entreprises, et 6 Mds Kh de prestations sociales versées par les administrations ; ces ressources ont été employées en achats de biens de consommation (75 Mds Kh) et au paiement des impôts (5 Mds Kh).
Le compte suivant retrace l'ensemble des opérations des ménages :
|
Compte général des ménages syldaves (en milliards de khôrs) |
|
|
Emplois |
Ressources |
|
Consommation finale 75 Impôts 5
Total des emplois 80 Solde +11
|
Revenus de l'activité et de la propriété 85 Prestations sociales 6
Total des ressources 91
|
|
total 91 |
total 91 |
La dernière ligne "total" est inscrite par commodité comptable : elle permet de vérifier la justesse du calcul du solde. Ce solde positif de + 11 Mds Kh signifie que les ménages n'ont pas employé la totalité de leurs ressources. Il correspond à leur épargne brute, et si les ménages n'effectuent pas d'investissements, à leur capacité de financement.
Rappelons-nous la phrase introduite dans le cours de comptabilité générale : "Grâce à ...une ressource, les ménages peuvent...en faire tel emploi"...
B. Le principe de partie double
Principe de la partie double : Toute opération est comptabilisée deux fois :
· en ressources pour un agent ;
· en emplois pour un autre agent.
En prolongeant l'exemple précédent, décrivons les opérations de deux autres secteurs institutionnels de l'économie syldave :
· Les entreprises syldaves ont produit 200 Mds Kh ; cette production a été vendue aux ménages (75 Mds Kh), aux administrations (5 Mds Kh) et aux entreprises elles-mêmes, sous forme de biens d'équipement (20 Mds Kh) et de consommations intermédiaires (100 Mds Kh). Elles ont versé 85 Mds Kh de revenus aux ménages, et 5 Mds Kh d'impôts et de cotisations sociales.
· Les administrations syldaves ont pour ressources les sommes prélevées sur les ménages (5 Mds Kh) et sur les entreprises (5 Mds Kh) ; en emplois elles inscrivent les prestations sociales versées aux ménages (6 Mds Kh) et les achats de biens nécessaires à leur fonctionnement (5 Mds Kh).
|
00Compte général des entreprises syldaves (en milliards de khôrs) |
|
|
Emplois |
Ressources |
|
Consommation intermédiaire 100 Revenus versés aux ménages 85 Impôts et cotis.soc. 5 Investissement (achat biens d'équip) 20
Total des emplois 210 Solde - 10 |
Vente de la production (biens de cons.finale, intermédiaire et d'équipement) 200
Total des ressources 200
|
|
total 200 |
total 200 |
|
11Compte général des entreprises syldaves (en milliards de khôrs) |
|
|
Emplois |
Ressources |
|
Consommation intermédiaire 100 Revenus versés aux ménages 85 Impôts et cotis.soc. 5 Investissement (achat biens d'équip) 20
Total des emplois 210 Solde - 10 |
Vente de la production (biens de cons.finale, intermédiaire et d'équipement) 200
Total des ressources 200
|
|
total 200 |
total 200 |
|
00Compte général des administrations syldaves (en milliards de khôrs) |
|
|
Emplois |
Ressources |
|
Achats de biens 5 Prestations versés aux ménages 6
Total des emplois 11 Solde - 1 |
Prélèvements (impôts & cotisations sociales) versées par entreprises 5 Prélèvements versés par ménages 5
Total des ressources 10 |
|
total 10 |
total 10 |
|
11Compte général des administrations syldaves (en milliards de khôrs) |
|
|
Emplois |
Ressources |
|
Achats de biens 5 Prestations versés aux ménages 6 Total des emplois 11 Solde - 1 |
Prélèvements (impôts & cotisations sociales) versées par entreprises 5 Prélèvements versés par ménages 5 Total des ressources 10 |
|
total 10 |
total 10 |
Si l'on juxtapose les comptes des trois agents, on peut vérifier que chaque opération a bien été comptée deux fois : ainsi les impôts et cotisations sociales versés par les entreprises (5) aux administrations sont inscrits en ressources pour ces dernières, et en emplois pour les entreprises.
De même, on vérifie que la production en ressources du compte des entreprises (200) se retrouve en emplois : consommation des ménages (75), achats des administrations (5), consommation intermédiaire des entreprises (100), et investissements (20) des entreprises.
C. Les comptes et soldes intermédiaires
Les opérations des secteurs institutionnels sont classées et regroupées à l'intérieur d'une chaîne de comptes interdépendants. Chaque compte dégage, à la dernière ligne de la colonne des emplois, un solde qui est replacé à la première ligne de la colonne ressources du compte suivant.
Le lecteur attentif contestera cette observation, non conforme à la représentation graphique de la page suivante ; n'oublions cependant pas que le besoin de financement est une capacité de financement négative (et donc difficile à représenter).
Le tableau ci-après décrit la succession des comptes des sociétés, à l'exclusion du compte financier. II doit être lu de droite à gauche, le premier compte récapitulant l'ensemble des autres comptes, dans l'ordre : compte de production, d'exploitation, de revenu et de capital.
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consom- mations inter- médiaires |
|
|
Consommations intermédiaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
salaires, cotisat. soc., impôts liés à la production |
valeur ajoutée |
← |
valeur ajoutée |
Production |
|
salaires, cotisat. soc., impôts liés à la production |
Production |
|
|
|
|
intérêts, dividendes, transferts courants |
excédent brut d'exploitation |
← |
excédent brut d'exploitation |
|
← |
|
|
|
intérêts, dividendes, transferts courants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
← |
|
|
← |
|
subventions d'exploitation |
|
|
|
|
|
subventions d'exploitation |
|
investissements, variation des stocks |
épargne brute ou revenu disponible |
← |
épargne brute ou revenu disponible |
intérêts, dividendes, transferts courants |
|
|
|
|
|
|
|
investissements, variation des stocks |
intérêts, dividendes, transferts courants |
|
|
transferts en capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
transferts en capital |
|
|
besoin de financement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
besoin de financement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compte de capital |
|
Compte de revenu |
|
Compte d'exploitation |
|
Compte de production |
|
Ensemble des Comptes |
|||||