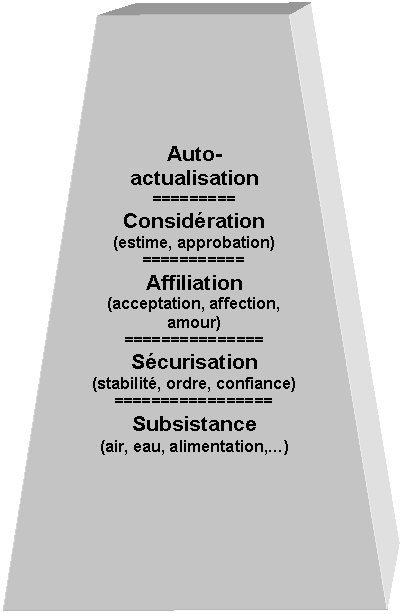
♦ Sommaire |
♦ PREMIÈRE ÉTAPE : la famille Van Vlees dans l'économie belge
♦ Introduction, objectifs et mots-clefs
♦ Science Économique et Sciences Sociales : leur objet ?
♦ D'où viennent nos besoins ? Ont-ils une origine sociale ? Pourquoi ?
♦ Rareté et travail : Pourquoi travaillons-nous ?
♦ Gestion des ressources rares : un des objets de l'économie
♦ Agents économiques et leurs principales opérations
♦ Exemple d'utilisation du circuit économique
♦ Secteurs institutionnels, acteurs économiques et leurs opérations économiques
♦ Processus productif : facteurs de production et rôle des entreprises dans leur combinaison
♦ Le circuit économique : rappel et suite...
♦ Évaluation des connaissances et des savoir-faire
♦ Ce que les programmes en disent...
♦ PREMIÈRE ÉTAPE : la famille Van Vlees dans l'économie belge, une économie et un environnement social en mouvement... |
Les Van Vlees, une famille bien de chez nous : Madame 30 ans, Monsieur 33 ans, leur fils 10 ans, leur fille 8 ans. Chaque jour, comme tous les autres Belges, ils participent à la vie économique du pays.
Cette première étape s'adresse aux lecteurs n'ayant aucune notion économique, les analphabètes de l'économie. Si vous jugez que son niveau est trop faible pour vous, lisez seulement les relais et faites les tests de progression de cette première étape. Si vous vous jugez d'un niveau supérieur, vous pouvez faire de même jusqu'à la cinquième étape.
I. Le matin à huit heures, M. Van Vlees, après avoir accompagné ses deux enfants à l'école, se rend à l'usine où il _ _ _ _ _ _ _ Il ne reviendra à la maison qu'à 18:00, après son travail.
II. Mme Van Vlees va, de son côté, faire le _ _ _ _ _ _ _ afin de préparer le repas de midi.
III. Grâce à l'argent que gagne M. Van Vlees, elle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des beefsteaks chez le boucher, des pommes de terre, de la salade et des fruits chez l'épicier, du pain chez le boulanger. La viande de boeuf, la farine de blé, les fruits et les légumes sont _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans les exploitations agricoles.
IV. Le boucher, l'épicier et le boulanger sont des _ _ _ _ _ _ _ Grâce à eux, la _ _ _ _ _ _ _ _ _ des agriculteurs peut être vendue aux ménagères.
V. En rentrant chez elle, Mme Van Vlees fait ses comptes : elle pensait dépenser 2 500 BEF, or elle n'en a dépensé que 1 800, elle a donc fait 700 BEF d'_ _ _ _ _ _ _ _
VI. À midi, les deux enfants de M. Van Vlees rentrent déjeuner ; ils ont faim, ils ont _ _ _ _ _ _ _ _ de nourriture et consomment avec grand appétit le repas préparé par Mme Van Vlees.
i) travaille
ii) marché
iii) achète ; produits
iv) commerçants ; production
v) économie
vi) besoin
relais
Produire, travailler, vendre, faire son marché, avoir besoin de nourriture, acheter ou consommer, gagner de l'argent, faire des économies sont des actes qui font partie de la vie quotidienne des Van Vlees comme de tous les ménages belges.
Ces actes sont à la base de l'économie, aussi bien de l'économie de la famille Van Vlees que de l'économie belge :
· l'économie de la famille Van Vlees doit lui permettre de ne pas dépenser plus d'argent que n'en gagne M. Van Vlees et éventuellement faire des économies, par exemple pour les vacances.
· l'économie est la manière dont sont organisées la production et la distribution de ce dont les Belges ont besoin pour vivre.
C'est cette seconde signification que revêtira dans cet ouvrage le mot "économie".
test de progression
Que signifie : Les Van Vlees font des économies ?
Réponse : Ils _ _ _ _ _ _ _ _ _ moins que ne _ _ _ _ _ _ _ M. Van Vlees.
Que signifie : Les Belges font l'économie belge ?
Réponse : Les Belges, grâce à leur _ _ _ _ _ _ _ _ _, produisent et distribuent ce dont ils ont _ _ _ _ _ _ _ pour vivre.
T.P. dépensent ; gagne (V.)
travail ; besoin (VI.)
I. Pour ses achats de produits alimentaires, Mme Van Vlees dépend du boucher, de l'épicier et du boulanger. De qui dépend, par exemple, le boucher?
Soulignez les personnes dont il dépend, et expliquez en quoi consiste leur dépendance : l'agriculteur, le chef de gare, Mme Van Vlees, ses clients, le fabricant d'aliments pour le bétail, le vétérinaire, le transporteur routier, le contremaître d'une usine de camions, le directeur d'une papeterie, l'agent de police, le mineur.
II. Le boucher de Mme Van Vlees dépend donc de _ _ _ _ _ _ ceux que nous avons cités ; de même, chacun de nous dépend de _ _ _ _ _ _ les autres Belges : nous sommes tous solidaires.
III. Cette _ _ _ _ _ _ _ _ _ dépasse les frontières de la Belgique ; mais, par suite des circonstances historiques et géographiques, elle est plus étroite entre les Belges qu'entre les Belges et les habitants des pays _ _ _ _ _ _ _ _ _
Faites la liste des aliments que vous avez consommés hier en les classant en deux catégories :
a Produits étrangers : ....
b Produits belges : ....
i) Le boucher dépend de toutes les personnes citées : l'agriculteur, le vétérinaire, le fabricant d'aliments pour le bétail interviennent directement dans la production d la viande.
Le chef de gare, le transporteur routier, le contremaître d'une usine de camions, l'agent de police assurent le transport rapide de la viande de l'exploitation agricole du boucher.
Le mineur extrait le minerai, matières premières permettant de fabriquer, par exemple, les camions.
Le directeur d'une papeterie assure la fabrication du papier et de nombreux produits d'emballage.
Mme Van Vlees et ses clients achètent la viande.
ii) tous ; tous
iii) solidarité ; étrangers (voisins) :
produits étrangers : café, olives, arachides, oranges, fromage (français ou de Hollande), citron, thon, saumon, saucisses (de Frankfurt), camembert ;
produits belges : beurre, lait, gaufres (de Liège), Passendaele ou autre fromage (un peu de tout...), bière (Westmalle, Chimay, Jupiler), pommes de terre, chicons (endives pour les Français), viande, eau (Spa, Chaudfontaine), tarte à l'jote, waterzooie,
relais
Cette solidarité étant très étroite à l'intérieur des frontières nationales, l'économie belge constitue une sorte de machine.
Quand un des rouages de cette machine économique fonctionne, il entraîne avec lui tous les autres. Autrement dit, lorsqu'une ville, une industrie ou une région agricole est prospère, cette prospérité rejaillit sur les autres villes et régions ; par contre, quand quelque chose ne va pas dans un des rouages de l'économie nationale, tout le monde en supporte les conséquences .
test de progression
Citez une activité dont la prospérité vous paraît influencer la vie de l'économie nationale tout entière, en vous efforçant d'expliquer le pourquoi.
T.P. En Belgique, nous n'avons pas de véhicule belge connu, mais nous construisons des voitures. L'industrie de fabrication automobile fait appel à de nombreuses activités : extraction de minerai, production d'acier, de verre, de plastic de préférence recyclable, ingénieurs mécaniciens et électriciens, électroniciens, peinture, production d'équipements de surveillance, main d'oeuvre pour le montage, réseau de distribution d'essence, service d'assurances (civile, obligatoire ; vol, omnium, facultative), etc. De plus, l'augmentation du nombre de véhicules exigent les constructions et entretien des routes, du nombre de garagistes, du nombre de vendeurs d'équipements divers, etc. Voici quelques informations d'après "Le Soir", 7/3/97... Renault nous a quitté d'une manière très peu sociale, ce qui a donné naissance à la loi Renault.
|
Marque Où ? Emplois dir Investissem Achats Belg Chiffre d'aff
Modèles Nombre véh % exportation |
Volvo Gand 6000 9,3 Md (1996) 19,4 Md 94,7 Md
V70 S70 144 300 + 90 % |
Opel Anvers 7775 18 Md en 5 ans 20 Md 45,6 Md
Astra Vectra 295 000 95 % |
Renault Vilvorde 3100 8,3 Md en 3 ans 20 % 36,8 Md
Mégane Clio 143 000 93 % |
VW Forest 5850 20,5 Md : 10 ans 7 Md 75 Md
Golf Passat 196 000 93 % |
Ford Genk 13100 60 Md ? 160 Md
Mondeo Transit 450 000 96 % |
I. Pour faire ses comptes, Mme Van Vlees s'est servie d'un stylo à bille ; il y a 2 000 ans, le stylo à bille n'existait pas, on se servait d'une plume d'oie. Pour fabriquer une plume d'oie, il fallait une _ _ _ _ _ _ _ _ (morte ou vivante) et un _ _ _ _ _ _ _ _ pour épointer la plume.
II. La plume d'oie est un vieil instrument, sa fabrication n'exigeait pas de nombreux travaux. Il fallait seulement nourrir l' _ _ _ _ et fabriquer un _ _ _ _ _ _ _ Tout ceci pouvait se réaliser dans un même village, et ne nécessitait pas un long temps de production : le processus de _ _ _ _ _ _ _ _ était bref.
III. On peut imaginer que la personne qui utilisait une plume d'oie avait elle-même produit tout ce qui était nécessaire pour l'obtenir : nourrir l'oie et éventuellement fabriquer le couteau. Peut-on en faire autant pour un instrument plus moderne tel que le stylo à bille ? _ _ _ _ _ _ _ _
IV. Si nous supposons que la même personne puisse à la fois élever l'oie et produire le couteau, il ne lui est pas nécessaire d'acheter autre chose que du fer, car elle pourrait produire elle-même les grains nécessaires pour élever l'oie. L'économie ancienne ne nécessitait pas beaucoup d' _ _ _ _ _ _ _ _
V. Faites la liste de matières (premières) entrant dans la fabrication d'un stylo à bille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VI. Ainsi le progrès _ _ _ _ _ _ _ _ permet de fabriquer des produits plus perfectionnés et en plus grand nombre, mais aussi, il multiplie les travaux nécessaires pour transformer les matières premières en biens consommables. On dit qu'il y a allongement du _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _
VII. Dans le cas du stylo à bille, des milliers de personnes interviennent dans le _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ : le travail est _ _ _ _ _ _ _ _ en de très nombreuses opérations : il faut donc multiplier les transports, mettre en relation de nombreuses personnes éloignées les unes des autres, et ainsi faciliter les _ _ _ _ _ _ _ _ entre elles.
i) oie couteau
ii) oie couteau production (I)
iii) Non, la vie entière d'un homme n'y suffirait pas
iv) échanges
v) matières plastiques provenant du pétrole et/ou du charbon, acier, tungstène, colorant, cuivre, aluminium, etc
vi) technique processus production (II)
vii) processus de production divisé échanges (II,VI)
relais
Le progrès technique a donc provoqué un allongement du processus de production qui a rendu solidaires de grandes masses d'hommes, plus spécialement à l'intérieur d'une même nation.
La division du travail est la conséquence de l'allongement du processus de production.
L'économie d'échange découle directement de la division du travail.
test de progression
Le grand facteur de solidarité entre les différents éléments d'une économie moderne est le p _ _ _ _ _ t _ _ _ _ _ _ _ C'est lui qui est la principale cause de l'évolution de l'économie moderne.
T.P. progrès technique
I. Les enfants Van Vlees ont échangé avec des copains des "copies pirates" de leur traitement de texte contre une "copie pirate" d'un tableur, pour compléter leur softhèque. Ainsi, lorsque peu de produits sont échangés et que peu de personnes interviennent dans ces échanges, il est possible d'agir comme les enfants Van Vlees, en échangeant des p_ _ _ _ _ _ _ _ contre des p_ _ _ _ _ _ _ _ .
II. Dans certaines régions du monde, les habitants produisent eux-mêmes presque tout ce dont il ont besoin et n'échangent que peu de choses. L'_ _ _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _ _ _ _ de production, et la _ _ _ _ _ _ _ _ du travail liés au progrès _ _ _ _ _ _ _ _ n'ont pas encore fait leur apparition dans ces anciennes économies : on y pratique l'échange sous forme de troc.
III. Le _ _ _ _ _ _ _ _ n'est pas réalisable dans une économie qui ne peut fonctionner que grâce à des milliers et des milliers d'échanges, car il suppose que celui qui _ _ _ _ _ _ _ _ ce que vous désirez, _ _ _ _ _ _ _ _ au même instant ce que vous possédez.
IV. Dans l'économie moderne, afin de faciliter les échanges, on introduit un bien intermédiaire que tout le monde désire : l'argent. Il est nécessaire à l'échange et on l'appelle en langage économique la _ _ _ _ _ _ _ _ d'échange.
V. Ainsi, M. Van Vlees n'est pas payé par son usine en produits nécessaires à la vie de sa famille, mais avec de la _ _ _ _ _ _ _ _ qui lui sert à acheter chez les commerçants ce dont sa famille a _ _ _ _ _ _ _ _ pour vivre.
i) produits produits
ii) allongement du processus division technique (3.VI)
iii) troc possède (détient) désire (souhaite) (I, II)
iv) monnaie (I,II)
v) monnaie besoin (III, 1.VI)
relais
La monnaie facilite donc les échanges en décomposant le troc, employé dans les économies anciennes, en deux échanges successifs. Elle est en quelque sorte la courroie qui entraîne les rouages économiques. C'est un intermédiaire qui permet l'échange.
Les échanges monétaires s'étendent à toutes les activités dans une économie moderne, car la solidarité de tous ceux qui agissent au sein de celle-ci implique de très nombreux échanges.
test de progression
Un agriculteur désire acheter une charrue et offre du blé. Le forgeron désire du blé et dispose d'une charrue à "offrir". Que se passe-t-il en cas de troc, en cas d'échanges monétaires ? À l'aide de flèches (couleurs différentes) dessinez dans les deux cas, le schéma des opérations.
TROC AGRICULTEUR
MARCHAND FORGERON
de blé
ÉCHANGE MONÉTAIRE AGRICULTEUR
MARCHAND FORGERON
de blé
T.P.
TROC AGRICULTEUR
1 charrue
2 blé
MARCHAND FORGERON
de blé
ÉCHANGE MONÉTAIRE AGRICULTEUR
1a blé 2a charrue
1b monnaie 2b monnaie
3b monnaie
MARCHAND FORGERON
de blé 3a blé
I. S'il fallait réaliser un schéma général de l'économie, en tenant compte de tous les échanges qu'elle nécessite, nous ne pourrions pas y parvenir, car ces échanges sont très nombreux, il y en a des millions, voire des milliards. Nous allons donc réaliser une simplification en regroupant les principaux acteurs de la vie économique. En voici d'ailleurs quelques uns :
vous, votre voisin, les Van Vlees,
l'épicier, la DEXIA, le gouvernement,
Compaq, une ferme, ministère de l'intérieur,
les Dupont, la commune de Braine-l-C Cora,
Crédit communal, votre collègue, Boël.
Classez-les selon les catégories suivantes : Ménages, Entreprises, Banques, Administrations.
Ménages : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entreprises : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banques : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Administrations : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Les Van Vlees sont un _ _ _ _ _ _ _ _ ; comme tous les_ _ _ _ _ _ _ _ , ils _ _ _ _ _ _ _ _ les biens produits par les _ _ _ _ _ _ _ _ . On appelle les achats des ménages sur les marchés la _ _ _ _ _ _ _ _ des ménages.
III. Boël est une _ _ _ _ _ _ _ _ qui _ _ _ _ _ _ _ _ des lavabos en vue de les _ _ _ _ _ _ _ _ aux ménages qui en auront besoin.
IV. Le ministère de l'éducation et de la recherche de la Communauté française est une _ _ _ _ _ _ _ _ ; les cours organisés par cette _ _ _ _ _ _ _ _ sont apparemment (partiellement) gratuits, pour ceux qui en ont besoin.
V. La DEXIA est une _ _ _ _ _ _ _ _ ; elle reçoit l'argent que ses clients ne veulent pas garder chez eux, elle en _ _ _ _ _ _ _ _ à ceux qui en font la demande.
i) Ménages : vous, vos voisins, les Dupont, les Van Vlees, votre collègue ;
Entreprises : Boël, Compaq, une ferme, Cora, l'épicier ;
Banques : DEXIA, Crédit communal ;
Administrations : gouvernement, ministère de l'intérieur, commune de B-l-C
ii) ménage ménages achètent entreprises consommation (achats) (1.III)
iii) entreprise produit (fabrique) vendre
iv) administration administration
v) banque (institution financière) prête
relais
On nomme agents économiques les grands types d'acteurs économiques. Au point de vue national, ce sont donc : les ménages, les entreprises, les administrations, appelées parfois état, les banques, appelées aussi institutions financières, qui constituent les quatre types d'agents économiques.
Une entreprise vend les biens ou les services qu'elle produit.
Une administration ne vend pas ses services, elle les distribue gratuitement ou à un prix inférieur à leur coût réel.
Nous aurons l'occasion de revoir d'une manière plus précise les fonctions de ces agents économiques au fur et à mesure que nous établirons les relations économiques qui existent entre eux.
test de progression
Un avocat est-il une "entreprise" ?
Un coiffeur est-il une "entreprise" ?
Un supermarché est-il une "entreprise" ?
T.P. Tous sont des entreprises : ils produisent et vendent des biens "immatériels" appelés services :
= l'avocat vend une plaidoirie ;
= le coiffeur vend une coupe de cheveux ;
= le supermarché permet aux ménages de se procurer dans un lieu unique les biens consommables dont ils ont besoin. Le prix de ce service est inclus dans le prix des produits qu'il offre.
I. L'entreprise où travaille M. Van Vlees fabrique des téléviseurs. Comme toutes les entreprises, ses fonctions principales sont de _ _ _ _ _ _ _ _ _ des biens et de les vendre. De plus, elle distribue de la monnaie à ceux qu'elle emploie en échange de leur _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cet argent constitue une partie des revenus des ménages.
II. L'entreprise où travaille M. Van Vlees fabrique et vend des biens matériels : des téléviseurs. Certaines autres entreprises, telles le médecin, le salon de coiffure ou une salle de cinéma, produisent des biens immatériels que l'on appelle des _ _ _ _ _ _ _ _ _
III. De leur côté, les Van Vlees, comme tous les ménages, reçoivent en échange de leur travail, un _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ils en _ _ _ _ _ _ _ _ _ la plus grande partie pour _ _ _ _ _ _ _ _ _ des biens et des services vendus par les entreprises. Une grande partie de ces achats est faite hebdomadairement, quand Mme Van Vlees va au _ _ _ _ _ _ _ _ _ Les dépenses de Mme Van Vlees et de tous les ménages, sur le marché, s'appelle la c_ _ _ _ _ _ _ _ _ des ménages.
IV. Aujourd'hui encore, l'expression "faire son _ _ _ _ _ _ _ _ _ " vient du temps où plusieurs commerçants se rassemblaient dans un même lieu pour vendre leurs marchandises. Dans certaines villes, ont encore lieu des _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; presque partout, on trouve aujourd'hui des super- _ _ _ _ _ _ _ _ _ , forme plus moderne de ces lieux de rencontre, [orthographié normalement en un mot, sans tiret].
V. Au niveau de l'économie nationale, on parle de _ _ _ _ _ _ _ _ _ même lorsque les vendeurs et acheteurs ne sont pas réunis dans un même lieu. Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ représente l'ensemble des achats et des ventes pour tous les biens et services produits par les entreprises. Même dénomination s'il ne s'agit d'un bien ou un service particulier ; ne parle-t-on pas du _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l'automobile ou du _ _ _ _ _ _ _ _ _ informatique ?
VI. Lorsque Mme Van Vlees veut acheter de la salade, elle va voir au _ _ _ _ _ _ _ _ _ ce qui lui est offert aux étalages. Elle peut ainsi se rendre compte si les _ _ _ _ _ _ _ des commerçants correspondent à ce qu'elle désire acheter, c'est-à-dire à sa demande.
VII. Donc, sur un marché, ce que les vendeurs se propose de vendre s'appelle la _ _ _ _ _ _ _ _ _ et ce que les acheteurs se proposent d'acheter s'appelle l' _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) produire travail (5.III)
ii) services
iii) salaire dépensent acheter marché consommation(1.II)
iv) marché marchés marchés
v) marché marché marché marché
vi) marché offres
vii) demande offre
relais
Nous pouvons maintenant concevoir le circuit de base de l'économie. Pour le construire, il faut partir de la production des entreprises. En effet, le but de l'économie est de nous permettre de satisfaire des besoins divers au moyen de nourriture, de vêtements, de logement et de transport, etc., il faut d'abord produire ces biens et ces services. La production des entreprises forme tout au long de l'année un ensemble de biens et de services offerts sur le marché. Cet ensemble, qui constitue un courant, un flux de biens et de services qui approvisionnent le marché, correspond à l'offre. De même, l'ensemble des revenus que les entreprises versent aux ménages tout au long de l'année, en rémunération de leur travail, constitue un courant, un flux de revenus qui va des entreprises aux ménages. Les ménages dépensent une grande partie de leur revenu en achetant sur le marché les biens et les services que leur offrent les entreprises. Cet ensemble des dépenses effectuées au cours d'une année par les ménages s'appelle la demande ; elle forme un flux (un courant) de dépenses qui va des ménages au marché. Sur le marché, le flux de monnaie de la demande s'échange contre le flux de biens et de services qui constituent l'offre.
test de progression
En joignant les entreprises, les ménages et le marché par des flèches, construisez le circuit de base de l'économie. Distinguez chaque fois les flux de revenus et les flux de biens et services soit par des couleurs, soit par des hachures caractéristiques.
MÉNAGES ENTREPRISES
Marché
T.P.
salaires, loyers
MÉNAGES ENTREPRISES
travail
b &serv achetés b &serv vendus
Marché
dépenses des ménages produits des ventes
I. Nous avons retracé les principales relations d'échange entre les _ _ _ _ _ _ _ économiques qui sont :
les _ _ _ _ _ _ _ _ ,
les _ _ _ _ _ _ _ _ ,
les _ _ _ _ _ _ _ _ ,
et les _ _ _ _ _ _ _ _
Nous y avons ajouté un cinquième _ _ _ _ _ _ _ _ économique d'un type un peu spécial : le "Reste du monde"ou l'étranger. L'ensemble de leurs activités économiques va aboutir à l' _ _ _ _ _ _ _ _ de biens et de services sur les marchés. Simultanément, la monnaie qui circule entre eux se transforme en _ _ _ _ _ _ _ _ sur ces mêmes marchés.
II. Quelles sont les demandes des divers agents économiques sur les marchés ? Regarder le circuit du test 53.
Sur le marché des biens de consommation :
la demande des _ _ _ _ _ _ _ _ , qui constitue la plus grande partie de ce qui est demandé sur ce marché ;
la demande des _ _ _ _ _ _ _ _ , qui comprend les achats par les _ _ _ _ _ _ _ _ civiles de fournitures diverses et surtout les achats de matériel d'équipements pour l'armée que l'on assimile à une _ _ _ _ _ _ _ _ . En effet, en aucun cas les armements ne doivent être assimilés à des biens de production. Ce sont des biens de d_ _ _ _ _ _ _, et, au même titre que les biens de c_ _ _ _ _ _ _ _ , ils disparaissent au premier usage et n'interviennent pas dans le processus de _ _ _ _ _ _ _ _
III. Sur le marché des biens de production :
la demande des _ _ _ _ _ _ _ _ représente la plus grande partie de ce qui y est demandé. Elle consiste dans :
1 la demande de m_ _ _ _ _ _ p_ _ _ _ _ _ _ ;
2 la demande d'é_ _ _ _ _ _ _ ;
3 la demande de produits s_ _ _ _ _-f_ _ _ _ _ ;
4 la demande de _ _ _ _ _ _ _ divers pour la production (ingénieurs‑conseils, assurances, transports, etc.) qui vont être presque tous immédiatement incorporés dans la _ _ _ _ _ _ _ _ Ce sont tous des biens qui disparaissent au cours du _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ On les nomme aussi biens de _ _ _ _ _ _ _ _ et parfois aussi "biens intermédiaires".
IV. Conjointement à cette demande, on en distingue une autre comportant aussi une demande de matières premières, la demande de produits semi‑finis.
Mais, à la différence des précédents, ces biens ne sont pas acquis en vue d'une utilisation immédiate. Ils sont _ _ _ _ _ _ _ pour une production _ _ _ _ _ _ _ : ils constituent un investissement, capital circulant mais improductif tant qu'ils restent en _ _ _ _ _ _
Enfin, elle comprend aussi une demande de biens d'é_ _ _ _ _ _ _ ou biens de production qui ne disparaissent pas au cours du _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ Ces biens d'_ _ _ _ _ _ _ _ ou capitaux _ _ _ _ _ sont aussi appelés investissements _ _ _ _ _ _ _ _
V. On trouve aussi, sur le marché des biens de production, la demande de biens qui doivent servir à la construction de routes, de ponts, de ports, d'écoles ou d'hôpitaux. C'est la demande de certaines _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui "offrent"ces biens (ou services) à la collectivité. Elle permet donc de réaliser les b_ _ _ _ _ c_ _ _ _ _ _ _ _ qui sont à la charge de l'_ _ _ _ _ (fédéral, communautaire ou régional confondus) et que l'on trouve inscrits au budget d'équipement des administrations.
VI. Grâce à quoi peut‑on satisfaire ces demandes ?
D'abord et essentiellement grâce à la _ _ _ _ _ _ _ actuelle des entreprises. Celle‑ci comprend : (1) la production de biens _ _ _ _ _ _ _ _ _ destinés à satisfaire la demande des entreprises en capitaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui disparaissent au cours du _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ ou qui peuvent être _ _ _ _ _ _ _ _ en vue d'une production _ _ _ _ _ _ _ _ ; (2) la production de biens d'é_ _ _ _ _ _ _ _ destinés soit aux ent_ _ _ _ _ _ _ , soit aux adm_ _ _ _ _ _ _ _ ; (3) la production des _ _ _ _ _ _ et des _ _ _ _ _ _ _ _ destinés à la consommatíon des ménages ou des a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En plus de la _ _ _ _ _ _ _ de la période actuelle, on dispose de biens _ _ _ _ _ _ au cours d'une période antérieure et _ _ _ _ _ _
VII. Toute la production ne servira pas à satisfaire la demande exprimée sur le marché belge. Une partie sera expédiée à l'_ _ _ _ _ _ pour y être vendue : elle représente les _ _ _ _ _ _ _ belges.
De même, tous les biens offerts sur le marché belge ne sont pas produits par des entreprises situées en _ _ _ _ _ _ _ Une partie de ceux‑ci proviennent de l'_ _ _ _ _ _ _ Elle représente nos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Comme ce sont pratiquement toujours des entreprises qui réalisent les exportations et les importations, dans les deux cas, on situera les exportations et les importations dans le cadre du marché des biens de _ _ _ _ _ _ _ _
En simplifiant : l'ensemble des biens offerts sur le marché belge correspond à :
production belge + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VIII. Dans les cas où les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont différentes des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , cela donne lieu au paiement d'un solde soit par la Belgique, si les _ _ _ _ _ _ _ _ sont plus importantes que les _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; soit par le "reste du monde" ou l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ si c'est l'inverse qui se produit. Ce solde est payé par l'intermédiaire des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ car, dans les deux cas, il faut procéder à une opération de _ _ _ _ _ _ _ entre pays qui ont des _ _ _ _ _ _ _ _ _ différentes.
i) agents, ménages entreprises administrations institutions financières agent offre (mieux que l'échange) demande
ii) ménages administrations administrations administration destruction consommation production
iii) entreprises matières premières énergie semi‑finis services production processus de production biens de production
iv) stockés future stocks équipement processus de production équipement fixes productifs
v) administrations biens (équipements) collectifs État
vi) production intermédiaires (ou de production) circulants processus de production stockés future équipement entreprises administrations biens services administrations production produits stockés
vii) étranger exportations Belgique étranger (reste du monde) importations production + importations - exportations
viii) importations exportations importations exportations étranger institutions financières change monnaies
relais
Au cours des étapes suivantes, nous allons examiner comment la production est réalisée et comment, dans le même temps, les revenus monétaires sont manipulés par les institutions financières et les administrations. Dans un circuit exclusivement national, production et flux monétaire se rencontrent sur le marché des biens de production et sur celui des biens de consommation. N'oublions cependant pas qu'une "fuite"est observée au niveau des flux monétaires : lorsque les ménages gardent leurs économies dans un bas de laine... c'est la thésaurisation.
Une partie de la production, destinée à être vendue à l'étranger, est cependant retirée des circuits nationaux : ce sont les exportations. Les achats réalisés à l'étranger, les importations, viennent par contre accroître les ressources disponibles.
Ainsi, dans une économie, on dispose d'un certain nombre de ressources destinées à faire face aux divers emplois que les agents économiques veulent en faire et qui se traduisent par des demandes sur les différents marchés.
test de progression
Complétez ce circuit économique en y ajoutant :
les importations la thésaurisation
les exportations le paiement d'un solde de la balance commerciale
$$$$
Correction :
$$$$
N O T I O N S A C Q U I S E S
| achat administration agents économiques allongement du processus de production banque besoins biens demande division du travail échanges |
économie entreprises exportations importations flux de biens et services flux de revenus institutions financières marché ménages monnaie |
offre processus de production production progrès technique revenu des ménages salaires services solidarité travail troc |
♦ Introduction, objectifs et mots-clefs |
Vous abordez cette année l'étude d'une discipline nouvelle : celle des sciences économiques et sociales. Vous avez peut-être quelques idées sur le domaine de l' "économie" et sur celui du "social". Mais pourquoi associer ces deux termes ?
Après avoir introduit l'économie et quelques éléments de base sous une approche "non classique", imagée, à savoir la parabole de la veuve et de ses deux fils (après tout, nous sommes dans l'enseignement libre, pas vrai ?), nous avons introduit la famille Van Vlees qui sera notre fil rouge au niveau du présent syllabus. Ce chapitre vous permettra de comprendre l'association "économique et sociale" en partant du phénomène de "rareté". II y a situation de rareté lorsque nos ressources ne suffisent pas à couvrir nos besoins. L'actualité nous en apporte maints exemples : dans de nombreux pays en développement sévit la pénurie de ressources alimentaires, d'eau potable, de soins médicaux, d'espace pour se loger dans les grandes métropoles... Nos pays industriels semblent connaître l'abondance, pourtant la presse nous informe de la situation des sans-logis qui campent en pleine ville, et nous savons qu'un nombre croissant de personnes connaissent des difficultés économiques... L'un des objets de la science économique est précisément d'étudier comment on peut vivre face à la rareté, et par quels moyens une société parvient à la réduire.
Mais la rareté est aussi un phénomène social qui prend diverses formes selon les époques ou les lieux : toutes les sociétés ne répondent pas aux mêmes besoins, ou ne répartissent pas les ressources entre leurs membres de manière identique.
Lutter contre la rareté, c'est en même temps vivre ensemble : chaque société adopte donc une organisation et des "règles du jeu économique et social"qui lui sont propres. Pour comprendre pleinement les phénomènes de rareté, la science économique ne suffit donc pas : d'autres sciences sociales (sociologie, démographie...) apportent un éclairage indispensable.
D'où l'association des deux termes : "économique et social".
Quels sont nos besoins ? Peut-on distinguer les besoins élémentaires (ou primaires) des besoins secondaires ? L'origine de nos besoins est-elle biologique ou sociale ?
Si leur origine est avant tout sociale, les besoins devraient être assez différents d'une société à l'autre : qu'en est-il exactement ?
Comment définir la rareté ? Quels liens y a-t-il entre les besoins, la rareté et le travail ? Comment s'effectuent les échanges de travail ?
Quels exemples peut-on donner de la manière dont des sociétés différentes comme les sociétés traditionnelles (celles du passé, celles qui subsistent encore aujourd'hui), les sociétés industrielles ou les sociétés en développement sont confrontées à la rareté ? L'abondance comme la pénurie ne sont-elles pas des notions relatives à l'époque ou au lieu ?
L'objet de la science économique peut être défini comme la gestion de la rareté. Encore faut-il préciser son domaine qui s'intéresse à la satisfaction des besoins à partir de ressources rares, au travail et à la production de biens et services, à leur répartition entre les membres de la société, enfin à leur utilisation en particulier sous forme de consommation.
La mesure de la rareté peut être donnée comme exemple de recherche économique : dans quelle mesure les prix des biens nous renseignent-ils sur l'écart entre ce que les économistes appellent l'offre (la quantité produite) et la demande (la quantité consommée) ?
Quelles sont les autres sciences sociales ? Quels exemples peut-on donner de ce qu'elles apportent à la compréhension des phénomènes de rareté ?
La suite de ce chapitre est de relier ces différents aspects entre eux pour obtenir une vision d'ensemble : ces éléments forment un système ; ils sont interdépendants.
Il est commode de représenter les liens entre les diverses catégories d'agents économiques sous forme d'un circuit. La première représentation du circuit économique a été faite par François Quesnay en 1758 dans son "Tableau économique des Physiocrates".
L'idée que la richesse créée par un agent circule et se transforme pour finalement lui revenir, s'est révélée féconde : elle a donné naissance, deux siècles plus tard environ, à la Comptabilité nationale qui nous présente chaque année un "modèle réduit"ou une "maquette"de l'économie nationale. Grâce à ce modèle chiffré, on peut effectuer des analyses et des prévisions, en examinant l'ensemble des répercussions d'un événement quelconque sur toutes les parties du circuit.
Nous rappellerons les grands acteurs de la vie économique. Les économistes les qualifient de catégories d'agents ou de secteurs institutionnels : ménages, sociétés et quasi-sociétés non financières, institutions financières, administrations publiques et privées, reste du monde. Nous verrons quelles sortes d'opérations ils effectuent, quelles sont leurs ressources et dépenses principales.
Certaines de ces opérations correspondent à une offre de produits, d'autres à une demande qui se rencontrent sur les marchés (des biens de production et des biens de consommation).
On peut alors construire un circuit économique en représentant par des flèches les opérations qui relient les agents entre eux. On distingue celles qui correspondent à des flux réels de biens ou services, et celles qui sont des flux monétaires, se traduisant par une circulation de monnaie.
Quelle est l'utilité de la notion de circuit pour la compréhension des phénomènes économiques ? Que se passe-t-il lorsque l'on décide d'augmenter les salaires de façon importante ? Nous imaginerons, à l'aide du circuit, les répercussions possibles d'un tel événement. Nous verrons alors que le circuit est ouvert sur le reste du monde par les exportations et les importations que l'on regroupe au sein de la balance commerciale.
I N F O R M A T I O N S
C O M P L É M E N T A I R E S
R A R E T É, B E S O I N S, É C O N O M I E
Les sciences sociales étudient les hommes vivant en société, elles ont donc pour objet les groupes humains et les phénomènes ayant une dimension collective. Ces phénomènes sont appelés "faits sociaux", ils s'imposent aux individus, et ne sont pas réductibles aux comportements individuels.
* Dans une formule célèbre : "Il faut considérer les faits sociaux comme des choses", Émile Durkheim[1] souligne, dès la fin du XlXe siècle, la difficulté de la tâche qui attend le chercheur en sciences sociales. Celui-ci doit s'efforcer de dépasser ses convictions personnelles, pour comprendre, sans chercher à juger, des faits (tels que la criminalité) qui peuvent le concerner personnellement.
* L'ensemble formé par les sciences sociales comprend de nombreuses disciplines : sociologie, ethnologie, psychologie sociale, démographie, sciences économiques, science politique, sciences juridiques.
Elles font partie du domaine plus vaste des sciences humaines : vous avez déjà abordé dans vos études d'autres disciplines de ce domaine, comme la littérature, l'histoire et la géographie, la psychologie, la linguistique. Toutes ces disciplines se complètent, si la psychologie s'intéresse d'abord à l'individu, elle n'ignore pas qu'il fait partie de groupes sociaux. La psychologie sociale s'occupe précisément de cette dimension. Les dimensions historiques et géographiques sont nécessaires à la compréhension des phénomènes sociaux : on a vu que la rareté prenait des formes très diverses selon les époques et les lieux. Nous avons vu la contribution de la science économique à l'analyse de la rareté. Donnons quelques exemples des apports d'autres sciences sociales.
La sociologie étudie comment les sociétés se constituent, s'organisent et se transforment, quelles sont les interactions entre ses membres et les divers groupes qui la composent. Exemple : la sociologie montre que notre appartenance à certains groupes sociaux influence notre consommation et façonne nos besoins.
La psychologie sociale étudie les comportements des individus dans leur relations mutuelles, en particulier au sein de groupes restreints : école, famille, quartier, équipe de sport, entreprises, etc.. Exemple : la psychologie sociale explique le rôle joué par l'éducation et la socialisation dans l'acquisition des goûts personnels.
ethnologie : étude comparative des sociétés humaines. Par exemple : les observations des ethnologues nous présentent des sociétés traditionnelles, qui n'ont pas le sentiment d'être misérables malgré leurs faibles ressources ; elles ont juste assez pour répondre à des besoins modérés et jouissent d'un temps libre bien supérieur au nôtre.
démographie : étude quantitative des populations humaines. Par exemple : la démographie nous explique la forte croissance des populations de nombreux pays du Tiers-monde.
science politique : étude des phénomènes de pouvoir au sein d'une société, ou entre sociétés. Par exemple : les sciences politiques pourront nous aider à comprendre les raisons des conflits armés qui aggravent le problème de faim dans certaines régions du monde (géopolitique).
Les sciences juridiques étudient l'ensemble des règles qui régissent la société (jus = droit) au niveau des personnes (droit privé) ou des institutions (droit public). Par exemple : lors du "Sommet de la Terre" qui s'est tenu à Rio en juin 92, des délégations de 185 pays ont recherché des réponses communes à des problèmes comme celui de la propriété des espèces végétales que l'on découvre en forêt amazonienne.
De très nombreuses facettes de nos existences sont soumises à l'influence des phénomènes économiques. Ces multiples constatations de notre proximité avec l'environnement économique quotidien doivent nous inciter à mieux appréhender cette science.
· Dans quels métiers y a-t-il des emplois disponibles ?
· Quelle filière d'enseignement choisir ?
· Comment ces métiers seront-ils rémunérés ? Quelles sont les perspectives de carrière ?
· L'insertion dans le monde du travail sera-t-elle aisée ou pénible ?
· Comment évolueront les conditions de travail (durée du travail hebdomadaire, congés, pénibilité des tâches...) ?
· Quelle sera l'évolution de mon pouvoir d'achat ? Quels seront les choix futurs en matière de répartition des gains de productivité ?
· Le chômage est-il enrayable ?
· L'ouverture des frontières conduira-t-elle à des restructurations d'entreprises ? à des destructions d'emplois ? à la création de richesses nouvelles ? d'emplois moins durs et/ou plus qualifiés ?
· À partir de quel âge va-t-on considérer qu'un travailleur peut prendre sa retraite ?
· Par quels mécanismes les pensions des retraités sont et seront-elles assurées ?
· Aurais-je dû me fier au système collectif de retraite ? Aurais-je dû mettre au point un système individuel de capitalisation ? L'État a-t-il raison d'encourager l'épargne pension ? Quelles en seront les conséquences ?
"l’économie, c’est l’étude du comportement humain comme une relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages mutuellement exclusifs."
Lionel Robbins
"La science économique n’est rien d’autre que l’étude de l’humanité dans sa conduite de sa vie quotidienne"
"l'économique examine cette part de l'activité individuelle et sociale consacrée à atteindre et à utiliser les conditions matérielles du bien-être"
Alfred Marshall
"l’économie est la science de l’administration des ressources rares dans la société humaine, elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l’aménagement onéreux du monde extérieur en raison de la tension qui existe entre des désirs illimités et des moyens limités des sujets économiques"
Oscar Lange
"l’économie, c’est l’étude des mécanismes de production, d’échange, et de consommation dans une structure sociale donnée et des interdépendances entre ces mécanismes et cette structure"
Jacques Attali et Marc Guillaume
"l’économie recherche comment les hommes et la société décident, en faisant ou non usage de la monnaie, d’affecter des ressources productives rares à la production, à travers le temps, de marchandises et de services variés, et de répartir ceux-ci, à des fins de consommation présente et future, entre les différents individus et collectivités constituant la société."
Paul Samuelson L’Economique
"la science économiques est celle qui a pour objet la production, la consommation et l'échange de biens et services rares"
Jean Fourastié
"L'économie a pour objet de rechercher comment satisfaire au mieux les besoins pratiquement illimités des hommes avec les ressources et les connaissances limitées qui sont les leurs, et de définir les institutions dans le cadre desquelles cet objectif peut être atteint."
Maurice Allais (prix Nobel 1988)
"L'économie politique montre comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses."
Jean Baptiste SAY : Traité d'économie politique, I, page 1, 1803.
"Je fais remarquer une fois pour toutes que j'entends par économie politique classique toute économie qui, à partir de William Petty, cherche à pénétrer l'ensemble réel et intime des rapports de production dans la société bourgeoise, par opposition à l'économie vulgaire qui se contente des apparences, rumine sans cesse pour son propre besoin et pour la vulgarisation des plus grossiers phénomènes les matériaux déjà élaborés par ses prédécesseurs, et se borne à ériger pédantesquement en système et à proclamer comme vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peupler son monde à lui, le meilleur des mondes possibles."
Karl Marx, Le Capital, livre 1 (1867), Éditions Sociales, 1971 p.83
"La finalité de l'étude de l'économie n'est pas d'acquérir un ensemble de réponse toutes faites aux questions économiques, mais d'apprendre à ne pas se laisser duper par les économistes."
Joan Robinson
"L'économie est un processus institutionnalisé d'interaction entre l'homme et son environnement naturel et social qui permet un approvisionnement en moyens matériels de satisfaire les besoins."
Karl Polanyi (1957)
"L’analyse économique se propose d’établir la façon dont la société décide ce qu’elle doit produire, comment et pour qui elle doit le faire."
David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush
"L’économie politique, au sens le plus étendu, est la science des lois qui régissent la production et l’échange des moyens matériels de subsistance dans la société humaine. Les conditions dans lesquelles les hommes produisent et échangent varient de pays à pays et dans chaque pays de génération à génération. L’économie politique ne peut donc pas être la même pour tous les pays et pour toutes les époques historiques. Depuis l’arc et la flèche du sauvage, depuis son couteau de silex et ses relations d’échange intervenant à titre purement exceptionnel jusqu’à la machine à vapeur de mille chevaux, au métier à tisser mécanique, aux chemins de fer et à la Banque d’Angleterre, il y a une énorme distance. […] Quiconque voudrait ramener aux mêmes lois l’économie politique de la Terre de Feu et celle de l’Angleterre actuelle ne mettrait évidemment au jour que le plus banal des lieux communs. L’économie politique est donc essentiellement une science historique. Elle traite une matière historique, c’est-à-dire constamment changeante ; elle étudie d’abord des lois particulières à chaque degré d’évolution de la production et de l’échange, et ce n’est qu’à la fin de cette étude qu’elle pourra établir les quelques lois tout à fait générales qui sont valables en tout cas pour la production et l’échange."
Friedrich ENGELS 1, Anti-Dühring, Éditions sociales.
♦ D'OÙ VIENNENT NOS BESOINS ? ONT-ILS UNE ORIGINE SOCIALE ? POURQUOI ? |
* Nos besoins ont tout d'abord une origine biologique. Tout être humain, quelle que soit la société à laquelle il appartient, doit répondre à un certain nombre de besoins qu'on peut qualifier d'élémentaires ou d'essentiels à la vie. Ce sont les besoins primaires - ou naturels, ou physiologiques - que l'on doit satisfaire : se nourrir pour combattre la faim, se loger pour combattre les agresseurs éventuels, dormir pour lutter contre la fatigue. Les biens qui répondent à ces besoins primaires sont appelés biens vitaux.
* Les besoins secondaires - ou psychosociologiques, ou de civilisation - paraissent moins essentiels que les précédents : se déplacer à l'aide d'un moyen de transport pour ..., se distraire et se cultiver (loisirs et culture), améliorer son état de santé ou prévenir la maladie (hygiène et santé), etc. La satisfaction de ces besoins, sans être absolument indispensable à la vie, apporte un mieux-être à l'individu. Les biens qui répondent à ces besoins secondaires sont appelés biens de civilisation.
Mais la distinction entre les besoins primaires et secondaires semble difficile à établir, et parfois peu justifiée :
- N'est-il pas essentiel de vivre en bonne santé ? De même, peut-on disposer de nourriture sans les moyens de transport qui acheminent les produits alimentaires vers les villes ?
- Les économistes classent parfois les moyens de loisirs et de culture ou même de santé dans les catégories des biens superflus ou biens de luxe : est-ce légitime ? Certains parlent même de besoins superflus ou tertiaires : "Les besoins tertiaires contribuent davantage à montrer son appartenance à un groupe social, en consommant des produits de luxe, par exemple."
La sociologie va nous aider à comprendre pourquoi il est difficile, voire parfois injustifié, d'établir une hiérarchie des besoins ou des biens.
"La civilisation est la création indéfinie des besoins dont on n'a pas besoin" (Mark Twain)
|
Idée méthodologique de Pierre Collie (promo ?) : On pourrait, pour différencier besoins primaires et secondaires : 1)dresser une liste regroupant des besoins primaires et secondaires 2)demander aux élèves de classer les besoins selon l’ordre d’importance pour eux 3)une fois les listes dressées, demander aux élèves de justifier leur choix 4)conclure en « définissant besoins secondaires et primaires, et souligner que la distinction n’est pas toujours évidente |
|
Idée méthodologique : Vous pouvez faire découvrir, sur base d'une situation donnée, qu'il existe plusieurs manières de satisfaire un besoin ; faire découvrir les éléments dont l'homme tient compte lorsqu'il choisit une manière de satisfaire son besoin… |
Le couple Velobus et ses 2 enfants de 15 et 19 ans habitent Ploegsteert (environ 9 km de Comines, ouest du Hainaut) ; monsieur, médecin, travaille à Gent (71 km de Ploegsteert) de 8h30 à 16h30 ; madame ne travaille pas (économiquement parlant) mais doit faire des courses au moins deux fois par semaine à Comines ; la cadette va à l'école à Comines, l'aîné est étudiant à l'école normale de Braine-le-Comte.[2]
1. Rechercher une dizaine de réponses possibles pour satisfaire ce besoin.
2. Choisir 5 solutions parmi les réponses trouvées.
3. Numéroter ces solutions choisies.
4. Rechercher les éléments qui peuvent influencer le choix des Velobus.
· physique ou matériel [nécessité physique, biologique…ressentie]
· économique (=prix)
· psychologique [état mental de l'individu] (peur des transports en commun, des trajets en vélo quand il fait noir)
· social [appartenance à un groupe ou une catégorie sociale] (qualité de vie, standing, niveau de vie)
· culturel [appartenance à une culture particulière, manière de vivre d'une population] (convient-il d'aller au boulot en moto ? fait-on appel au vélo-taxi en Belgique ? convient-il que monsieur loge à Gent ?)
5. Rechercher les données qui peuvent "mesurer"certains des éléments repris ci-dessus.
· coût au km d'un véhicule ;
· horaire des bus, trains, etc. desservant les communes de Ploegsteert, Comines, Gent et Braine-le-Comte ;
· coût des trajets isolés et/ou abonnements ;
6. Dresser un tableau à double entrée, permettant de faire un choix judicieux et réfléchi.
J’ai soif, en rentrant je bois un grand verre (d’eau), j’éprouve une grande satisfaction.
En hiver, j’ai le crâne et les oreilles gelés ; j’enfile ma casquette et je me dis : "Quel soulagement !".
Je suis malade ; le médecin me dit ce qui ne va pas et ce que je dois faire (et prendre [prescriptions]) pour me sentir mieux.
Après plusieurs heures de travail et d’étude, j’en ai marre et je regarde la télévision "Enfin, un peu de détente".
|
Mes besoins |
Mes réponses à ces besoins |
Mes réactions |
|
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|
= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
$$$$page3 Besoins et satisfaction
Les biens (matériels) sont des produits matériels et donc stockables : par exemple une paire de ciseaux ou une caméra ;
Les services sont des produits immatériels, non stockables : par exemple une séance de cinéma, une coupe de cheveux chez le coiffeur ;
Une autre approche des biens est de les définir d'une façon plus globale qui permette d'inclure les services comme des biens : Biens : toutes choses (matérielles ou immatérielles) susceptibles de faire disparaître un besoin.
Valeur morale // Définition de droit
Le lecteur observera que cette définition enlève aux mots bien et service leur valeur morale et religieuse : en effet, la drogue, l'excès d'alcool et/ou de tabac seront économiquement considérés comme des biens, puisqu'ils répondent au besoin ressenti par quelqu'un qui est déprimé, mal dans sa peau... Je suis très nerveux, je vais me calmer un fumant une cigarette. J'ai rendez-vous avec mon copain ; je vais partir à la dernière minute et rouler comme un malade. La session arrive, je vais me bourrer de médicaments divers pour "tenir le coup". J'ai un problème, je vais boire et oublier.
De même, le droit civil (voir Code civil) parle de biens et de choses sans en donner de définition légale. Cependant la lecture de certains articles de droit nous permet d'imaginer que la chose n'a pas de propriétaire, alors que tout bien (en ce compris les droits relatifs aux personnes [droit personnel] et aux objets [droit réel]) a un propriétaire ; mais cette distinction n'est pas reconnue universellement.
Art CC 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles"
Art CC 526 : Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes...
Art CC 537 : Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par la loi...
Lorsque nous assistons à un spectacle artistique, nous payons en fait du temps : celui que les musiciens, acteurs, etc., nous consacrent. Ce temps n'est pas stockable (hormis au travers de la mémoire que nous en garderons) : il s'agit d'un service. Si nous achetons un disque ou une cassette, il s'agit d'un bien matériel que nous pourrons conserver un certain temps ou échanger.
J'ai faim, je mange de la viande ;
Les châssis sont abîmés, je vais devoir les repeindre ;
"Quel calcul compliqué, où est ma calculatrice ?"
"Papa, je dois aller à Braine, je prends ta voiture" ;
Je vais chez le pharmacien chercher les médicaments prescrits,
J'en ai marre, je vais acheter un C.D. ce soir.
J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste ;
Le moteur de l'auto fait un bruit, je vais chez le garagiste ;
La loi m'oblige à nettoyer la cheminée, j'appelle un ramoneur ;
Je ne me sens pas bien, j'appelle le médecin ;
J'en ai marre, je vais au cinéma ce soir.
= biens économiques : biens relativement rares, produits par le travail humain. Leur valeur provient soit de leur utilité, exprimée subjectivement par les individus, soit du travail qu'ils ont nécessité.
= biens non économiques (ou libres) : biens donnés en abondance, n'ayant nécessité aucune opération de transformation. Ils sont offerts à tous gratuitement., à titre non onéreux (Exemples : air, eau de source, terre, paysages naturels, espace, soleil, faune, flore...). Certains auteurs parlent de besoins non économiques…ce qui nous semble être une erreur.
= biens marchands : biens ou services acquis à titre onéreux par celui qui en fait la consommation.
= biens non marchands : biens ou services pour lequel le consommateur ne paie pas (l'entièreté) du bien (Exemples : école et enseignement, éclairage public, visite du médecin,...)
= biens durables : biens qui peuvent être utilisés à plusieurs reprises, sans pour autant être détruits. (Exemples : four à pain, réservoir d'essence, voiture du médecin,...)
= biens non durables : biens complètement détruits après un usage unique (Exemples : pain, essence, visite du médecin, voiture destinée aux tests de sécurité...)
= biens obsolètes : biens durables devenus impropres à la satisfaction des besoins d'un individu. (Exemples : paire de lunettes si la vue change, moulin à vent, chaussures usées, vêtement hors mode, ordinateur 8086..)
= biens de consommation (finale) : biens qui satisfont des besoins propres à l'individu qui les consomme, sans intention de les revendre[3]
= biens de production : biens qui serviront à produire d'autres biens destinés à la revente, biens qui servent à un individu à mieux faire son métier
= biens individuels : biens qui satisfont des besoins propres à un individu
= biens collectifs : biens ou services dont l'usage par un individu, n'empêche pas d'autres individus d'en faire l'usage (Exemples : piscine communale, ramassage des immondices, réseau routier,...)
= biens individuels et collectifs : les définitions varient suivant les auteurs ; on peut tenir compte de critères aussi différents que "celui/ceux qui sont propriétaires, celui/ceux qui en font usage, celui/ceux qui paient pour l'utilisation, etc..."
|
|
bien économique |
bien non économique |
bien individuel |
bien collectif |
bien durable |
bien non durable |
|
1 chaleur du soleil
2 crème glacée
3 amitié d'un copain
4 amitié obtenue par "téléphone rose"
5 eau de mer
6 crayon
7 plaine de jeux
8 partie de "flipper"
9 le flipper
10 brosse à dents
11 cahier
12 tableau noir
13 un cours à Braine
14 un cours particulier
15 une cour à Braine
16 service d'une agence matrimoniale |
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
|
L'ethnologue Malinowski s'est interrogé sur le fait suivant : certaines sociétés ignorent l'usage de la fourchette, alors que dans la nôtre, on ne saurait s'en passer. On pourrait répondre qu'il s'agit d'un progrès de la civilisation mais des études historiques (Norbert Élias, "La Civilisation des mœurs", Calman Levy, 1976) montrent que, lorsque la fourchette apparut à Venise au XIe siècle, les Vénitiens la jugèrent barbare et incommode.
Les hommes et les femmes du XVIIe siècle, qui finirent par l'adopter, ne le firent pas pour une raison d'hygiène, notion trop moderne pour l'époque. Et Norbert Élias fait remarquer que prendre avec ses doigts ce qui se trouve dans sa propre assiette n'est pas forcément moins hygiénique. L'usage de la fourchette a donc bien une origine sociale.
Certains besoins ressentis doivent être satisfaits, faute de quoi l'individu se dégrade physiquement ou socialement (ceci semble être une autre définition correcte des besoins primaires) ; d'autres naissent par le "matraquage"publicitaire : certains besoins de civilisation sont donc quasi artificiels, et les biens pour les satisfaire paraissent indispensables alors qu'ils ne le sont pas : produits de beauté, vêtements à la dernière mode, chaîne hi-fi hypersophistiquée, ordinateur (hardware) et/ou logiciels (software) du dernier cri.
Remarque : on distingue ici besoins vitaux et/ou de civilisation ; certains auteurs font la même distinction en parlant des biens.
Les besoins ne sont pas les mêmes pour tous. Ils varient en fonction de :
a) Un besoin d'alimentation sucrée chez Véronique, qui a 5 ans, est satisfait par une sucette ; chez Léontine, qui a 65 ans, ce même besoin est satisfait par un petit gâteau.
= variation de la réponse en fonction de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) Un besoin de s'habiller sera résolu en cinq minutes pour Christophe ; pour Sandrine, la satisfaction de ce besoin sera le fruit d'une longue séance d'essayage.
= variation de la réponse en fonction du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) Un besoin de se distraire chez Miguel, fils de famille ouvrière, se résoudra par la TV ; chez Didier, fils de famille libérale, ce besoin de distraction se résoudra par la lecture.
= variation de la réponse en fonction du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d) Un besoin de sport chez Anne, en bonne santé, sera satisfait par les 20 km de Bruxelles ; chez Émilie, qui a un souffle au cœur, ce même besoin sera satisfait par une promenade.
= variation de la réponse en fonction de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e) Un besoin d'écouter de la musique chez René, qui habite dans un immeuble, sera résolu par l'audition de la musique sur écouteurs ; chez Vincent, qui habite une villa isolée, ce besoin sera satisfait par l'écoute de la musique sur des baffles de 100 watts.
= variation de la réponse en fonction de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
f) Un besoin de matériel professionnel chez Niro, qui est boucher, sera satisfait par un hachoir industriel ; chez Patrick, qui est économiste, ce besoin sera satisfait par un ordinateur.
= variation de la réponse en fonction de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
g) Le besoin de partir en vacances pour Florence, qui est caissière, sera satisfait par des vacances en Ardennes : pour France, qui est avocate, ce même besoin sera satisfait par des vacances à la Côte d'Azur.
= variation de la réponse en fonction du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h) Le besoin de loisirs chez Marc, qui est bricoleur, sera satisfait par la construction d'un abri de jardin ; chez Michel, qui est plutôt maladroit et intellectuel, ce besoin de loisirs sera satisfait par la lecture d'un livre.
= variation de la réponse en fonction des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) Un besoin de s'habiller était résolu rapidement en 1900 ; aujourd'hui, la satisfaction de ce besoin sera le fruit d'une longue séance d'essayage.
= variation de la réponse dans le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (variation temporelle)
j) Un besoin de s'habiller en Éthiopie est résolu sans grande recherche aujourd'hui ; la satisfaction de ce besoin en Belgique, sera le fruit d'une longue séance d'essayage.
= variation de la réponse dans l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (variation spatiale)
Il existe des besoins élémentaires que l'on satisfait : manger pour fuir la faim, dormir pour chasser le sommeil, etc. Mais chaque société impose d'utiliser pour les satisfaire certains objets, comme le couteau ou la fourchette, et certaines façons de faire, qui lui sont propres.
* Malinowski qualifie ceux-ci de besoins dérivés des besoins élémentaires :
- pour dormir (satisfaire un besoin élémentaire) nous avons "besoin"d'un lit (besoin dérivé) mais c'est la société qui l'impose car on pourrait dormir par exemple sur une natte ou dans un hamac.
- pour nous mouvoir, (satisfaire un besoin élémentaire) nous avons "besoin"d'une auto ou du chemin de fer, parce que notre époque exige le transport rapide sur des longues distances.
- la sexualité et la reproduction sont des besoins élémentaires, mais la société établit des règles (plus tard nous les appellerons juridiques) pour les satisfaire : interdiction d'épouser de proches parents, cérémonie et fête de mariage. On peut qualifier ceux-ci de besoins dérivés.
* La distinction : besoins primaires (biologiques) - besoins secondaires n'est pas vraiment justifiée.
La plupart de nos besoins sont dérivés et ont une origine sociale. Notre façon de les satisfaire provient de l'éducation reçue dans notre famille, du mode de vie de notre groupe social ou de notre pays. Ainsi, le sociologue Henri Mendras donne quelques exemples de biens satisfaisant des besoins liés au groupe social :
- le caviar : "Ce n'est certainement pas parce que les gens ont faim qu'ils mangent du caviar [...]. En revanche, affirmer sa position et son rang social est chose fondamentale dans le jeu social".
- la tondeuse à gazon : "Personne n'a besoin d'une tondeuse pour vivre [...] ; acheter une tondeuse de tel type et de telle marque, c'est acheter un signe d'appartenance à une catégorie sociale : ceux qui ont un gazon à tondre, et ceux qui ont les moyens de s'acheter une tondeuse…siège, pourquoi pas."
La recherche des besoins (marketing) // Un exemple
· Le rôle essentiel d'un vendeur consiste à préciser les besoins de ses clients, puis à offrir un produit qui correspond le plus à ses désirs.
· Le vendeur cherchera à faire naître les besoins en énumérant les qualités des objets qu'il présente.
· Vendeur : Bonjour, monsieur, que désirez-vous ?
· Client : J'aimerais faire un cadeau à mon neveu ; j'aimerais lui offrir un chevalet de peintre.
à Recherche du besoin (secondaire = peindre = loisir)
· Vendeur : Est-ce un débutant ou un professionnel ?
· Client : C'est un amateur débutant.
à Recherche de l' utilisateur du produit
· Vendeur : Peint-il dehors ou en atelier ?
· Client : Il peint essentiellement des paysages.
à Recherche de l' usage futur du produit
· Vendeur : Il aimerait donc un chevalet léger, solide et facilement transportable pour commencer ses peintures de paysage ?
· Client : Oui, c'est cela ! Pouvez-vous m'en montrer quelques modèles ?.
à Confirmation du besoin et des désirs diffus : le vendeur peut maintenant présenter un choix de produits correspondant aux besoins et désirs du client
· Vendeur : Quel budget pensez-vous consacrer à ce cadeau ?
· Client : J'aimerais ....
à Éventuellement, recherche de renseignements complémentaires
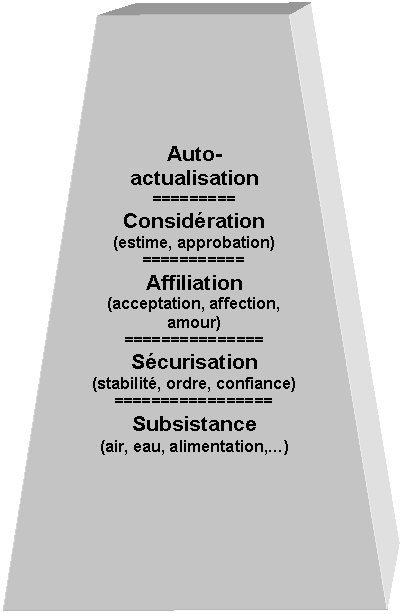 |
L'homme ne cherchera un abri pour se loger que s'il assouvit son besoin d'alimentation ; de même, il ne cherchera à se faire accepté par ses semblables que lorsqu'il aura trouver de quoi se mettre sous la dent et de quoi se protéger ; …
Besoins de subsistance ou physiologiques : il s'agit ici de la simple survie dans des situations accidentelles catastrophiques. Ce sont essentiellment la faim et la soif.
Besoins de sécurité ou sécurisation : les préoccupations de la personne se situent au-delà de la survie. Il s'agit de la prudence, qui au niveau précédent, pouvait être totalement négligée pour satisfaire les besoins physiologiques. On peut y ranger le goût de la stabiblité, la préférence pour le connu, le familier, la crainte de l'inconnu qui ne peut être envisagée que sous un aspect dangereux; et aussi le besoin de savoir (avoir des connaissances, des techniques, des procédés, des recettes), le besoin de théories, de croyances.
Besoins d'affiliation, d'appartenance et d'affection : c'est le besoin universel d'être reconnu en tant que personne et d'être accepté en tant que membre d'un groupe, d'une communauté; le besoin d'avoir de l'importance pour sa famille, ses voisins, ses proches, ses amis, ses collègues; le besoin de recevoir des témoignages d'affection, d'amitié, d'avoir une place dans différents groupes sociaux.
Besoins de considération ou d'estime : Besoin d'avoir un statut social, une position qui suscite sa propre estime et celle des autres; besoin de se sentir et d'être considéré comme capable et respecté; besoin d'assurer sa liberté personnelle, son indépendance, de jouir d'une réputation, d'un prestige.
Besoins d'autoactualisation ou de réalisation : besoins de réalisation de soi, d'accomplissement. S'il est vrai que "ce qu'une personne peut être, elle doit l'être", chacun a le soin d'actualiser ses possibilités qui sont très variables selon les individus : organiser, diriger, seconder, aider, conseiller, apprendre, comprendre, créer, faire une oeuvre représentative de soi, même modeste (maison, jardin, mobilier, objet etc................
besoin de pain, de sport // besoin de manger, de se détendre
De nombreux ouvrages économiques distribués et utilisés dans l'enseignement ont tendance à mal démarrer en définissant les notions de base : besoins, biens, consommer...
Nous avons volontairement négligé de définir cette notion fondamentale, alors que diverses classifications ont déjà été faites : primaires/secondaires, physiologiques/psychosociologiques, dérivés, etc. Nous insistons ici sur diverses approches qui tendent à créer une certaine confusion dans l'esprit des élèves "débutants" dans cette matière.
Le défaut de ce type de définition est
(1) de ne pas faire apparaître l'aspect désagréable du besoin ressenti,
(2) de déjà montrer le bien qui permettra de faire disparaître cette sensation désagréable qui doit être présente dans l'approche de la notion de besoin.
Le défaut de ce type de définition est
(1) de ne pas faire apparaître l'aspect désagréable du besoin ressenti,
(2) de déjà montrer l'action qui permettra de faire disparaître cette sensation désagréable qui doit être présente dans l'approche de la notion de besoin, l'action de satisfaire le besoin.
Besoin : sensation d'un manque, envie désagréable, qui génère le souhait d'un "mieux-être".
|
Ne dites pas... |
Dites plutôt... |
|
avoir besoin de pain avoir besoin de boire avoir besoin de détente avoir besoin du médecin avoir besoin de l'auto de papa
avoir besoin de dormir |
avoir faim... avoir soif... en avoir marre de travailler... être malade... être jaloux et/ou en avoir marre de se déplacer à pied ou en vélo...
être fatigué, avoir sommeil... |
Les biens meubles et immeubles // les autres distinctions que fait la loi
les droits
Chaque jour, tous les individus de notre société rencontrent des centaines de choses ( des voitures, des maisons, des immeubles, des bureaux, des bancs, des chaises, _ _ _).
Est-ce que toutes ces choses appartiennent-elles à une seule personne ?
Bien sûr que non, il y a toujours une limite à ce que l'on possède.
Au point de vue juridique ; dès qu'une chose a un propriétaire, elle devient son bien, un élément du patrimoine de la personne qui ce l'est approprié.
Cependant, il y a 3 exceptions :
- les choses communes : il existe des choses qui n'appartiennent à personne mais que tout le monde peut utiliser ( ex : le soleil, la mer, l'air).
- les choses qui n'appartiennent à personne : on entend par là qu'il existe des choses qui n'appartiennent actuellement à personne mais que l'on peut se les approprier ( ex : les poissons, les animaux sauvages).
- les choses abandonnées : il s'agit de choses qui ont été volontairement abandonnées par leur propriétaire (ex : le contenu des poubelles).
L'article 516 du code civil : "Tous les biens sont meubles ou immeubles." divise tous les biens en biens meubles ou immeubles.
On distingue trois sortes de biens meubles :
- les biens meubles par nature
- les biens meubles par détermination de la loi
- les biens meubles par anticipation
Les juristes considèrent comme bien meuble par nature, tout corps qui peut se transporter d'un lieu à un autre.
Soit qu'il se bouge par lui-même, comme un animal,
soit qu'il ne puisse changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme une chose inanimée ( ex: un livre, une fourchette, un chat, une grenouille, _ _ _ ).
La loi détermine que l'on range aussi dans les biens meubles, tous les droits qui portent sur des meubles (ex: droit de propriété d'un bien meuble, l'usufruit sur un bien meuble).
Il s'agit de biens immeubles par nature qui, avant d'avoir été détachés du sol, sont déjà considérés comme biens meubles.
Exemple : L'arbre appartient à la catégorie des biens immeubles par nature.
Dès qu'on l'abat, il devient toutefois meuble.
Lorsqu'un propriétaire vend des arbres à abattre, ces arbres sont réputés meubles par anticipation.
Il existe également 3 sortes de biens immeubles :
- les biens immeubles par nature
- les biens immeubles par destination
- les biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent
On considère comme biens immeubles par nature tous les biens qui ne peuvent être déplacés sans dégâts, parce qu'ils sont incorporés de façon durable au sol (ex : une balançoire, un bâtiment).
Certains biens meubles par nature sont considérés par la loi comme des immeubles en raison de l'usage auquel leur propriétaire les destine.
On peut les diviser en 2 catégories :
- les meubles affectés au service et à l'exploitation d'un fonds :
ex : la caisse d'un commerce, ses rayons, la vaisselle des restaurants,_ _ _
- les meubles attachés à un fonds à perpétuelle demeure : l'attache à perpétuelle demeure ne signifie pas nécessairement adhérence matérielle. De simples aménagements spéciaux, traduisant une intention du propriétaire, suffisent.
ex : Un coffre-fort encastré dans le mur d'une maison.
Une statue posée dans une niche spécialement aménagée à cet effet.
Cette catégorie comprend tous les droits qui portent sur des immeubles.
La distinction entre les biens meubles et immeubles a une grande importance car des règles différentes s'appliquent à ces deux catégories de biens.
Notamment en ce qui concerne :
Ø les saisies : la saisie mobilière se pratique plus aisément que la saisie immobilière.
Ø les sûretés : Seuls des biens immeubles peuvent être mis en hypothèque et seuls les biens meubles peuvent être remis en gage.
Les biens consomptibles sont tous les biens qui disparaissent au premier usage que l'on en fait.
ex : Le poisson pêché disparaît dès qu'on l'a mangé.
Les biens non consomptibles sont les biens qui résistent à un usage.
ex : un parasol, une paire de lunettes.
Les biens fongibles sont des biens qui peuvent être remplacés par d'autres qui leur sont équivalents. On les distingue (parfois) entre eux en les pesant, en les comptant, en les mesurant.
ex : un poisson, un chien, un kilo de sel.
Les biens non fongibles sont des biens uniques, non remplaçables par d'autres.
ex : le chien REX de Paul, la bague que j'ai reçue de ma grand-mère.
Tous les biens qui ont une existence matérielle, sont des biens corporels (on peut les toucher).
ex : un livre.
Les biens incorporels n'ont, quant à eux, pas d'existence matérielle. On ne peut pas les toucher.
ex : un droit.
On distingue 3 sortes des droits :
- les droits réels
- les droits personnels ou de créance
- les droits intellectuels
Les droits réels réunissent tous les droits dont l'objet est une chose.
ex : le gage, l'hypothèque, les servitudes, _ _ _
Les droits personnels ou de créance réunissent tous les droits dont l'objet est un lien de droit qui autorise une personne à exiger d'une autre personne qu'elle exécute une obligation.
ex : un contrat de prêt.
Ils protègent des créations de l'esprit : œuvres d'art, inventions, créations.
Toute personne qui invente un produit ou un procédé nouveau peut faire protéger son invention. Pour cela, il peut utiliser un brevet ou faire le dépôt d'une marque.
Introduction // Définition du droit de propriété // Possession et détention
Droits que confèrent la propriété // Les limites du droit de propriété
La copropriété // Les différentes façons d'acquérir la propriété
Dès qu'une chose a un propriétaire, elle devient son bien. Être propriétaire, c'est avoir un droit de propriété.
C'est le lien juridique qu'il y a entre une chose et la(les) personne(s) qui possède(nt) cette chose.
Avoir la possession d'un bien, c'est avoir le bien en son pouvoir et se comporter comme si l'on était le propriétaire.
Ex : Une personne pense trouver un bien meuble abandonné par son propriétaire. La personne s'en empare. Elle en a la propriété (car la loi présume pour les biens meubles, que la possession et la propriété coïncident). Mais le bien meuble n'a pas été abandonné par le propriétaire. La personne n'en a que la possession.
Avoir la détention d'un bien, c'est détenir le bien avec la permission ou pour le compte d'autrui. Le détenteur ne se comporte pas comme s'il était propriétaire (il ne garde pas le bien).
Ex : Un locataire et un emprunteur ne sont que des détenteurs. À l'issu de leur contrat, ils vont restituer le bien au propriétaire ou au prêteur.
Le droit de propriété est le droit réel le plus étendu. Le propriétaire peut en faire ce qu'il veut pour autant que la loi ne l'interdise pas. Le droit de propriété est perpétuel; il ne s'éteint pas, il se transmet.
Le droit de propriété confère :
- le droit de jouir du bien : c'est-à-dire pouvoir utiliser le bien conformément à sa destination et à en percevoir les fruits. Il existe plusieurs catégories de fruits : les fruits naturels (produits spontanément par la terre ou les animaux) et fruits civils (loyers, intérêts).
- le droit de disposer du bien : le propriétaire d'un bien peut en disposer matériellement ou juridiquement
Il existe beaucoup de lois limitant le droit de propriété :
- l'état peut exproprier un immeuble pour cause d'utilité publique.
- les plans d'aménagement du territoire imposent des restrictions aux personnes qui veulent bâtir un immeuble (limitation concernant l'emplacement, la nature , les dimensions, _ _ _)
- le classement d'un monument, d'un site diminue les droits de son propriétaire.
- les arbres ne peuvent être plantés qu'à une certaine distance de la limite d'un terrain.
Le droit de propriété est un droit exclusif (1 bien a 1 propriétaire) mais on rencontre dans certains cas, plusieurs personnes qui sont propriétaires d'un même bien : il y a copropriété.
La copropriété n'est que temporaire.
- par succession : la personne hérite du bien.
- par donation : la personne l'a reçu d'un ami.(voir étape 4).
- par convention : la personne achète le bien.
- l'accession ou l'incorporation : mécanisme qui permet au propriétaire d'une chose principale d'acquérir la propriété d'une chose accessoire qui s'incorpore ou s'unit à elle.
- la prescription acquisitive : cela permet au possesseur d'une chose d'en devenir propriétaire après un certain laps de temps.
- l'invention : c'est le mode d'acquisition des trésors.
- l'occupation : mode d'acquisition des choses qui n'appartiennent à personne ou des biens qui ont été abandonnés par leur propriétaire.
ex : un ferrailleur s'empare des vieux métaux placés dans les décharges.
Introduction // Définition de l'usufruit // Droit de l'usufruitier
Un couple marié vit avec leurs 3 enfants dans la maison dont l'homme a hérité de ses parents. Celui-ci décède. En principe leurs enfants sont les héritiers. Où vivra l'épouse?
Devra-t-elle quitter la maison? Non
Quels sont les intervenants?
- Celui qui a le droit de jouissance d'un bien : l'usufruitier
- Celui qui a le droit de posséder le bien: le nu-propriétaire.
Droit de jouir d'un bien dont un autre est propriétaire
L'usufruitier doit utiliser le bien en bon père de famille , c'est-à-dire soigneusement et avec respect.
- Que lui manque-t-il pour avoir la qualité de propriétaire? Seul le nu-propriétaire peut disposer du bien (vendre, détruire, donner, brûler ce bien).
Le droit de l'usufruit peut être accordé pour une durée déterminée ou à vie. Il prend fin dès la mort de l'usufruitier. Le nu-propriétaire deviendra propriétaire.
- usufruit légal
- usufruit testamentaire.
- la loi accorde les droits (lors du décès d'un conjoint) ;
- les droits découlent de la volonté de l'homme (lors de la rédaction d'un testament).
♦ RARETÉ ET TRAVAIL :
|
* Dans un texte célèbre intitulé : "Pourquoi travaillons-nous", l'économiste Jean Fourastié s'interroge sur la raison essentielle du travail : "À la question : "Pourquoi travaillez-vous ?" 95 % des Belges répondent : "Pour gagner de l'argent". [...]. Cette réponse n'est pas fausse ; mais elle est superficielle. Car elle ne retient que l'un des effets du travail, celui qui engendre un salaire ou un profit."
Jean Fourastié veut dire que l'argent que procure le travail n'est pas, fondamentalement, le but du travail. Quelle est donc la "vraie" raison du travail ? Nous travaillons, nous dit Fourastié, "pour réduire notre rationnement ; nous travaillons pour produire. Et ainsi pour pouvoir consommer".
- Ce "rationnement", c'est précisément la conséquence de la rareté : à l'exception de l'oxygène, la nature ne nous offre rien pour satisfaire immédiatement nos besoins. "Nous travaillons pour transformer la nature naturelle qui satisfait mal ou pas du tout les besoins humains, en éléments artificiels qui satisfassent ces besoins".
- Nous croyons que notre alimentation vient de la nature, en réalité, elle nous vient d'une transformation de la nature par le travail : "Toutes les choses que nous consommons sont en effet des créations du travail humain, et même celles que nous jugeons en général les plus naturelles comme le blé, les pommes de terre ou les fruits"
* Toutes les sociétés répartissent le travail entre différentes tâches ou professions : chaque travailleur se spécialise dans certaines activités précises ; c'est la division de notre travail. Pour répondre à tous nos besoins, il sera donc nécessaire d'échanger le produit de notre travail contre celui des autres.
* Dans les sociétés traditionnelles, cette division est peu développée : le chasseur d'une tribu indienne façonne ses outils, répare lui-même sa hutte. Cependant, il y a des échanges de travail à l'intérieur de la tribu.
* Cet échange peut se faire sans recourir à l'argent : c'est le troc. Tout se passe alors comme le décrit Jean Fourastié : chacun travaille pour se procurer le produit du travail d'autrui. Les ethnologues ont montré que, contrairement à ce que l'on croit généralement les équivalences entre les objets échangés par troc sont soumises à des règles précises et au moins aussi complexes que la fixation des prix dans nos économies de marché. De plus, la plupart de ces sociétés utilisent des objets qui jouent le rôle de la monnaie. C'est le cas des "cauris", petits coquillages, qui circulaient autrefois en Chine et Afrique.
* Dans les économies utilisant la monnaie, l'argent va servir d'intermédiaire dans l'échange. L'argent provenant de notre travail est finalement le moyen d'acquérir, par l'achat et la vente, le produit du travail des autres. Mais l'analyse de J. Fourastié reste valable : nous travaillons non pour gagner de l'argent, mais pour répondre à nos besoins.
Par exemple, supposons que Colette, boulangère, produise des galettes tandis que Sylvain, producteur laitier, fait des fromages blancs. Colette apprécie le fromage blanc et Sylvain raffole des galettes.
|
Figure 1 : échanges Sylvain-Colette |
Nous examinerons plus loin, les conséquences de ces échanges monétaires sur le "circuit de l'économie nationale".
Nous avons vu, dans la présentation du chapitre, différents aspects de la rareté : des biens produits, des ressources naturelles, de l'espace et même du temps disponible. Nous allons en donner certains exemples dans le cas des sociétés dites "traditionnelles", et examiner la manière dont les sociétés résolvent le problème posé par la rareté.
Ces règles codifient la totalité de la vie sociale : le domaine de l'économie apparaît comme subordonné ou dépourvu d'autonomie. Les exemples en sont très variés : autrefois, la société rurale de la Belgique non indépendante ; aujourd'hui, de rares sociétés ayant pu conserver leurs traditions à l'abri du contact avec le monde industrialisé comme certaines tribus amérindiennes.
* Si l'on prend l'exemple des tribus indiennes d'Amérique latine, telles qu'ont pu les observer des ethnologues comme Claude Lévi-Strauss[4], les Nambikwaras ; Pierre Clastres, les Guayakis, ou Jacques Lizot, les Yanomami, on est frappé par leur dénuement, le très petit nombre d'objets dont elles se servent, le caractère souvent rudimentaire de leurs techniques. "Dans la savane obscure, les feux de campement brillent. Autour du foyer, seule protection contre le froid qui descend, derrière le frêle paravent de palmes et de branchages hâtivement plantés dans le sol du côté d'où l'on redoute le vent et la pluie ; auprès des hottes emplies des pauvres objets qui constituent toute une richesse terrestre ; [...]. Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec les Indiens, se sent pris d'angoisse et de pitié devant le spectacle d'une humanité aussi totalement démunie."
* La Belgique médiévale, connaissait la succession périodique des famines et des épidémies qui souvent accompagnaient ces dernières. Jean Fourastié note[5] qu'au Moyen Âge, "la misère était l'état normal de l'homme médiéval". Un "journalier" pouvait, dans le meilleur des cas, offrir à sa famille 750 grammes de pain de méteil (le pain blanc était un luxe) par personne : "En ajoutant quelques légumes, raves ou choux, cette ration fournissait environ 1 800 calories par jour ce qui est loin des 3 200 calories nécessaires, selon les théories de la diététique moderne au bon équilibre physique de l'homme moyen." Jusqu'au début du XVIIIe siècle (la dernière grande famine date de 1 709), l'espérance de vie était de l'ordre de 25 ans en Belgique. J. Fourastié ajoute : "La souffrance et la mort étaient au centre de la vie, comme le cimetière au centre du village."
* Les tribus indiennes ont une organisation différente par rapport à notre société, si elles ont peu de biens, elles ont aussi très peu de besoins. Ce dont elles ont besoin, elles le trouvent presque directement dans la nature par la chasse, la pêche ou la cueillette. La durée journalière du travail est donc très faible : Jacques Lizot l'évaluait à 4 h 30 au grand maximum.
* Une autre différence en découle : la notion de loisir n'est pas perceptible. Tandis que nous opposons loisir et travail, les Indiens ne font de différence qu'entre activités intéressantes (chasse) et ennuyeuses (jardinage). Partir en expédition de chasse pendant une semaine n'est pas une contrainte, et pourtant cette activité est vitale pour le groupe, c'est à la fois du travail et du loisir.
* L'ethnologue Marshall Sahlins[6] a écrit un livre au titre étonnant. Son raisonnement est simple : si les tribus de chasseurs ont peu de besoins, et trouvent dans la nature, en travaillant très peu, de quoi les satisfaire, elles ignorent la rareté. Ce sont donc des sociétés d'abondance.
* Pour Jean Fourastié, cette vision de la société traditionnelle comme d'un âge d'or est, dans le cas de la Belgique médiévale, une sorte de conte de fées, un mythe, celui du "bon vieux temps", qui n'a jamais réellement existé, même si le rythme de vie et la qualité du travail y étaient sans doute plus agréable que les nôtres.
Il existe, comme pour les sociétés traditionnelles, plusieurs définitions possibles des sociétés industrielles, nous retiendrons celle qu'en donne Raymond Aron[7] en fin de chapitre. Depuis le XIXe siècle, ces sociétés ont beaucoup évolué. Le changement technique et social est sans doute l'un des traits qui les oppose le plus aux sociétés traditionnelles.
Le progrès technique a fait reculer la rareté des ressources naturelles, mais a, dans le même temps, créé de nouvelles raretés, avec le gaspillage et la dégradation par la pollution de notre "capital nature".
* Il y a un siècle, l'eau et les glaçons étaient rares dans de nombreuses villes. Les "porteurs d'eau" et "porteurs de glace" étaient encore des personnages familiers et indispensables de la société des grandes villes. Aujourd'hui, plus personne n'imaginerait vivre sans eau courante et sans tout‑à‑l'égout, ce qui est pourtant le sort de plus de 2 milliards de personnes dans le Tiers-monde.
* En 1972, le rapport Meadows, publié par le club de Rome, et intitulé "Halte à la croissance", annonçait une pénurie d'énergie et de la plupart des matières premières dans un délai de quelques décennies. La découverte de gisements (comme le pétrole off shore), le perfectionnement du traitement des matières premières (pour l'aluminium par exemple) et de nouvelles sources d'énergie (comme le nucléaire) ont repoussé ce danger vers une échéance plus lointaine.
* Bertrand de Jouvenel[8] fait remarquer que l'abondance des forêts était telle autrefois en Occident que les arbres pouvaient être utilisés gratuitement. L'extension des zones cultivées au détriment des bois a fait de l'arbre une ressource rare.
Nos besoins en eau ne cessent d'augmenter à cause des villes, mais aussi de l'agriculture et de l'industrie, autres grandes consommatrices. De plus ces activités sont polluantes et entraînent des dépenses croissantes de traitement des eaux. Que surviennent plusieurs années de sécheresse et l'on prend conscience que l'eau est une ressource rare dont nous pourrions manquer.
|
Figure 2 : lien entre environnement et développement |
Les graphiques ci-avant montrent bien le double aspect du progrès économique tantôt améliorant l'environnement tantôt en le dégradant.
En particulier, on voit que :
- plus les villes sont pauvres, plus l'air recèle des "particules" mais plus l'émission de gaz carbonique est faible ;
- plus les pays sont riches, plus ils produisent de déchets ;
- plus riche est la population, meilleur est son accès à l'eau potable.
Entre l'abondance des pays industrialisés et la pauvreté de certains pays en voie de développement, le contraste est saisissant. On peut se représenter comme à mi-chemin entre les sociétés traditionnelles et les pays industrialisés : ils connaissent d'importants progrès agricoles et industriels, et en même temps, une forte croissance démographique. Mais ils ont souvent conservé la modération des besoins de sociétés traditionnelles.
Cependant, il faut éviter de généraliser à l'ensemble du Tiers-monde les situations de rareté extrême que connaissent certains d'entre eux.
* C'est dans certains pays du Tiers-monde que la pénurie d'eau est la plus durement ressentie.
- Cette pénurie d'eau ne provient pas seulement de périodes de sécheresse exceptionnelle : le Tiers-monde connaît plus fortement que nous encore la pollution et le gaspillage de l'eau résultant d'une urbanisation et d'une industrialisation rapide ;
- La pénurie d'eau peut avoir des conséquences tragiques : maladies véhiculées par une eau impropre (la recrudescence du choléra au Pérou, par exemple), irrigation insuffisante des terres cultivées.
* Les économistes présentaient l'air comme l'exemple-type de la ressource naturelle abondante et gratuite ; pourtant, en certains endroits du monde, l'air pur se fait rare. Mexico est aujourd'hui la ville la plus peuplée du monde, et celle où l'on respire le moins bien. Les 12 millions d'habitants de Calcutta souffrent aussi de problèmes respiratoires dus à une insuffisance en oxygène.
Le principal facteur de la rareté de l'espace aujourd'hui est la démographie : la croissance naturelle des populations limite nécessairement les surfaces disponibles pour le logement ou la production agricole :
- Les grandes métropoles du Tiers-monde connaissent de façon aiguë 1e manque d'espace pour le logement.
- À Calcuta, 300 000 personnes dorment dans les rues, tandis que plusieurs millions d'autres s'entassent dans les 3 000 bidonvilles de la plus grande ville de l'Inde, qui accueille les migrations successives de paysans ruinés.
- En Inde, la surface moyenne des exploitations agricoles est inférieure à 2 hectares, alors qu'elle est d'environ 30 hectares en France. Or, la population de l'Inde s'accroît de 16 millions de personnes chaque année.
- La rareté de la terre disponible entraîne des conflits, comme en Amérique latine entre les paysans sans terre et les grands propriétaires de "latifundia".
|
Figure 3 : Progrès technique et rareté |
La famine touche encore régulièrement les pays du Tiers-monde, en particulier l'Afrique (Éthiopie, Somalie, pays du Sahel, Soudan, Ouganda, Mozambique).
* La sécheresse qui en est la cause immédiate n'explique pas tout.
* Plusieurs facteurs sociaux et politiques viennent en effet l'aggraver :
- guerres locales entraînant le déplacement des populations loin de leurs terres, ou empêchant le transport des vivres de l'aide internationale ;
- dégradations écologiques, elles‑mêmes conséquences de la pression démographiques, du surpâturage ;
- pour rembourser la dette internationale, les pays en voie de développement augmentent les surfaces affectées aux cultures d'exportation au détriment de la production vivrière destinée au marché local ;
- inégale répartition des terres signalée plus haut.
♦ GESTION DES RESSOURCES RARES : UN DES OBJETS DE L'ÉCONOMIE |
Voici quelques définitions des sciences économiques :
- Celle du Petit Larousse en Couleurs, 1991 : "L'économie est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, la distribution et la consommation des richesses."
- Celle de Jean Fourastié[9] : "La science économique est ainsi la connaissance, conduite selon la méthode expérimentale, des activités humaines tendant à transformer la nature, et à échanger les produits ainsi obtenus, en vue de satisfaire les besoins humains [...]. La science économique est celle qui a pour objet la production, la consommation et l'échange de biens et services rares."
- Celle de Paul Samuelson[10] : "L'économique recherche comment les hommes et la société décident en faisant ou non usage de la monnaie, d'affecter des ressources productives rares à la production à travers le temps de marchandises et services variés, et de répartir ceux-ci à des fins de consommation future ou présente, entre les différents individus constituant la société."
ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DE SCIENCE ÉCONOMIQUE :
La science économique étudie comment l'on peut satisfaire des besoins humains, à partir de ressources productives rares, en particulier le travail, en produisant des biens et services destinés à la consommation, que l'on échange et répartit entre les membres de la société.
- besoins, rareté, travail, production, répartition/échange et consommation ;
- la science économique s'intéresse à des décisions et à des actions.
Précisons le sens de certains termes qui seront fréquemment employés par la suite :
- la terre et les ressources naturelles
- le travail humain
- le capital (les machines)
exemples :
le bûcheron abat (travail) des arbres (nature) avec sa hache (capital) ;
l'enseignant développe (travail) les facultés mentales (nature) de ses élèves avec l’emploi de livres, cahier, documentation, ordinateur (capital).
Bien que rencontré souvent déjà, le terme "production" et ses dérivés seront approfondis dans l'étape 3, et le terme "consommation" le sera dans l'étape 4. C'est dans l'étape 3 que le lecteur trouvera une leçon préparée pour aborder les bases de l'économie, mais plus particulièrement la "production".
production : activité socialement organisée destinée à créer des biens et services, destinés à la consommation ; remarquons qu'en économie, il n'y a production que s'il y a réinjection dans le circuit économique, donc, s'il y a intention de vendre…
bien : toute chose (matérielle et stockable), par exemple, une paire de chaussures, apte à satisfaire un besoin ;
nous avons volontairement noté entre parenthèses l'aspect matériel du bien, car nous préférons une définition plus générale des biens, dont certains seront des services ;
service : toute chose immatérielle et non stockable ; par exemple, une séance de cinéma, apte à satisfaire un besoin ;
consommation finale : utilisation et destruction par l'usage de biens (et services) propres à la satisfaction des besoins personnellement ressentis.
Distribution des produits entre membres de la société.
Dans les sociétés utilisant la monnaie, la répartition prend la forme :
- d'une distribution de revenus aux personnes qui interviennent dans le processus productif ;
- d'une redistribution de revenus par l'État ou les organismes de protection sociale.
À l'origine le mot "économie" signifie "administration de la maison" (l'origine du mot est grecque : oikos veut dire maison, et nomos, règle). Mais le sens de ce mot a évolué, et s'applique à des groupes humains plus importants, comme une nation. On n'étudiera donc pas l'économie ménagère : "Si vous voulez apprendre à cuire un gâteau ou à tenir les comptes d'un ménage, fermez ce livre et adressez-vous ailleurs" a écrit Samuelson au début de son livre L'Économique (op. cit.)
Un des objectifs de l'économie est donc de traiter le problème (et la manière dont l'homme va procéder pour le résoudre) des besoins nombreux, face à des biens limités.
S'il n'est pas vraiment commode ni souhaitable de faire des expériences à l'échelle d'un pays, on peut chercher à établir des lois économiques à partir de faits observés. L'observation économique repose sur des statistiques qui mesurent différents phénomènes : par exemple, la quantité de production du pays ou produit intérieur brut (PIB), ou les variations de prix comme moyen de mesurer la rareté (voir ci-dessous).
Les études économiques doivent permettre d'éclairer les décisions prises par le pouvoir politique. N'oublions pas qu'il s'agit de combattre la rareté sous ses multiples formes actuelles : chômage et pauvreté dans les pays riches, pénurie dans les pays en développement et à améliorer l'efficacité des unités de production ou de ce que l'économiste appelle "combinaisons productives".
Le prix d'un bien est, pour les économistes, un indicateur de sa rareté. Toutefois, il mesure également la quantité de travail employée à sa fabrication.
Les économistes sont attentifs à l'évolution des prix des produits : une forte hausse de prix signifie en général que ce bien devient rare, et que les besoins en sont insatisfaits. Une des plus célèbres lois économiques, la loi de l'offre et de la demande exprime cette idée. Nous aurons à l'utiliser fréquemment.
* Le besoin que nous avons d'un bien ou son utilité ne suffisent pas à expliquer son prix. Prenons les trois biens suivants : l'air, l'eau et l'essence.
- Nous ne pouvons nous passer d'air plus de deux ou trois minutes ni d'eau plus d'un jour ou deux, tandis que l'essence semble le bien le moins vital des trois.
- Pourtant, l'air est gratuit et un litre d'eau au robinet coûte (encore) bien moins qu'un litre d'essence à la pompe.
- Après 8 heures de cours, un verre de bière a plus d'utilité que le dixième que je pourrais boire le même soir, pourtant, le prix est toujours le même.
* Le prix de chacun de ces trois biens semble plutôt proportionné à leur rareté respective.
* Le prix d'un bien mesure également la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Un produit qui a pris plus de temps à être fabriqué qu'un autre coûtera généralement plus cher.
* Ces deux aspects du prix : indicateur de rareté et mesure du travail nécessaire peuvent se rejoindre : le travail est, on l'a vu, une ressource rare.
Tes parents veulent acheter un immeuble. Ils sont disposés à dépenser 150 k€ pour obtenir la maison dont ils rêvent ; dans une agence immobilière, ils en découvrent entre 100 et 250 k€ ; un architecte leur propose une construction pour 270 k€.
· L'acquéreur du bien pense à une valeur d'usage, il pensera à l'agrément (vidéo, voyage, vie à la campagne,…) ou à l'utilité (machine à laver la vaisselle, absence de loyers à payer pour ne rien posséder plus tard) que lui procurera le bien.
· L'artiste, le concepteur ou le fabricant du bien songera à une valeur travail, il pensera à la somme de travail, de recherche, d'imagination, d'essai, de créativité à mettre en œuvre pour "faire" ce bien ;
· Les vendeurs, experts, évaluateurs songeront à une valeur d'échange, qui correspondra au prix de ce bien actuellement sur le marché…
En voici une formulation simplifiée :
|
Figure 4 : loi de l'offre et la demande |
Soit le marché d'un bien de consommation donné, où se rencontrent :
- les producteurs qui offrent (vendent) ce produit,
- les consommateurs qui en demandent (achètent),
on appelle :
- l'offre : la quantité du produit mise à la vente par les producteurs (à un prix fixé) ;
- la demande : la quantité du produit que souhaitent acheter les consommateurs (à un prix fixé) ;
et,
- si l'offre devient supérieure à la demande, les prix vont baisser,
- si la demande devient supérieure à l'offre, les prix vont augmenter.
Nous préférons cependant cette deuxième formulation :
- si l'offre augmente,
les prix vont baisser et les quantités échangées vont augmenter ;
- si l'offre diminue,
les prix vont augmenter et les quantités échangées vont diminuer ;
- si la demande augmente,
les prix vont augmenter et les quantités échangées vont augmenter ;
- si la demande diminue,
les prix vont baisser et les quantités échangées vont diminuer ;
|
Idée méthodologique de Pierre Collie : Vous pouvez : 1)demander aux élèves de se mettre dans la peau d’un vendeur de télévision si tout le monde veut acheter mon téléviseur, qu’est ce je fais( sachant que le but est de faire du bénéfice)…et si plus personne ne veut acheter mon téléviseur, qu’est ce je fais ?
2)demander aux élèves de se mettre dans la peau d’un acheteur de télévision …même type de questions...enfin le principe est compris. Évidemment cette approche de la matière peut être utilisé pour beaucoup. . |
suggérées par Livia Paolini (promo 98)
· La notion de besoin peut être introduite par une BD (voir Doc 1$$$$) en demandant notamment aux E “Qu’éprouve ce groupe de personne ?”. De plus, n’importe quel extrait de BD pourrait faire l’affaire, mais dans celui-ci l’E découvre également que ce sont les ménages (Boule, ses parents,...) qui éprouvent des besoins.
· Comme la notion, la définition du mot besoin peut être découverte par un extrait de BD (voir Doc 2). Ce qui est plus motivant pour l’élève que d’analyser des textes (ce qui se fait souvent en économie).
À partir du Doc 2, P demandera aux élèves d’analyser chaque phase, cadre de la BD,... ce qui permettra en reformulant une phrase correcte avec les différentes étapes découvertes d’aboutir à la définition du mot besoin.
· Pour introduire les notions de besoins primaires et secondaires, on peut réaliser un brainstorming autour du mots "besoins" : par exemple, chaque élève cite deux besoins qu’il éprouve et P note au TN tous les différents besoins énumérés par les E. "À partir de tous les besoins notés au TN, pouvons-nous les classer ?" en interaction avec les E, P peut entourer de deux couleurs différentes les besoins primaires et les besoins secondaires. Une fois la distinction faite, on peut demander aux élèves de définir les deux termes.
· Certains maîtres de stage insistent sur les variations des besoins dans l’espace et dans le temps.
Pour la variation des besoins dans l’espace, on peut diffuser une K7 vidéo décrivant Le mode de vie d’un autre pays. P peut donner un questionnaire sur la séquence aux E ou encore stopper la séquence après chaque étape de la vidéo (dans ce cas, il faut bien préciser la question de départ aux E: "Repérez les différents besoins éprouvés par les citoyens de ce pays")
Une K7 vidéo sur les Finlandais se prête bien pour cette activité, vous pouvez la trouver au centre audiovisuel de M.Boulogne, réf.: GEO/CRM 064D12/SEC
Pour la variation des besoins dans le temps, on peut utiliser l’outil informatique par exemple.
Il existe un CD-ROM sur les hommes préhistoriques, intitulé "Homo Sapiens: À la découverte des origines de l’humanité".
· Les notions de bien et de service peuvent être introduites par la comparaison de deux extraits de BD (voir Doc 3). Quatre questions peuvent être posées sur ce document :
1) Repère quel était le besoin éprouvé par la famille de Boule pour chacun des extraits.
2) Quelles sont les réponses apportées à ces besoins ?
3) Qu’ont-ils en plus qu’auparavant ?
On dira que les médicaments sont des _ _ _ _ _ _ _
On dira que la réparation est un _ _ _ _ _ _
4) Définis ces deux termes
· Pour faire découvrir aux E le schéma économique, il est très intéressant de faire comme le syllabus l’indique : de façon structurée, en y ajoutant un agent à la fois,... Mais on peut ajouter à cette manière de procéder, le fait que chaque agent économique soit représenté par un élève au TN (jeu de rôle).
Ce qui permettra de tracer au TN le schéma économique dans son entièreté.
De plus, le jeu de rôle permet aux élèves de se sentir plus concerné par le cours (envie de participer,...)
$$$$ LiPa
♦ AGENTS ÉCONOMIQUES ET LEURS PRINCIPALES OPÉRATIONS |
Pour décrire l'économie d'un pays comme la Belgique, on a besoin de définir les grandes catégories d'agents économiques, que la comptabilité nationale désigne désormais sous le terme de secteurs institutionnels, et leurs activités.
À quel propos les rencontrons-nous ?
- Les ménages : ils sont constitués d'une ou de plusieurs personnes qui partagent la même résidence principale.
- Les entreprises : dans cette présentation, sont les unités de production qui produisent des biens et services marchands.
- Les administrations publiques comprennent l'État et les collectivités locales, qui financent les transferts sociaux par la redistribution et produisent des biens et services collectifs ou non marchands.
- Les institutions financières : collectent l'épargne et fournissent du crédit.
Le reste du monde n'est pas abordé directement. Mais nous savons que nos unités de production doivent compter avec la concurrence étrangère et chercher à exporter leurs produits. Aucun pays aujourd'hui n'est autosuffisant, il est donc nécessaire de présenter cet agent, qui rassemble les pays avec lesquels l'économie nationale effectue des échanges extérieurs (par exemple : exportations et importations).
* Le tableau ci-dessous présente les cinq catégories d'agents avec leurs opérations classées selon qu'elles représentent pour eux une ressource ou une dépense (emploi).
|
5 catégories d’agents et leurs opérations principales |
||
|
|
OPÉRATIONS correspondant pour l’agent à des : |
|
|
|
Ressources |
Dépenses (emplois) |
|
Ménages |
· revenu (d’activité, du patrimoine, de transferts) · crédit |
· consommation finale · épargne · impôts et taxes |
|
Entreprises |
· production (biens et services marchands) · crédit |
· distributions de revenus · achats de matières premières |
|
État |
· transferts reçus (impôts, taxes, cotisations sociales) · crédit |
· transferts versés (redistribution des revenus) · production de biens et services non marchands (= consommation finale des administrations = production de services non marchands offerts par les administrations aux autres agents) |
|
Institutions financières |
· épargne |
· crédits |
|
Reste du monde |
· importations (du pays considéré, en provenance du RdM) |
· exportations (du pays considéré, vers le RdM) |
Nous avons étudié, parmi les unités de production, les entreprises du secteur de la distribution (petits commerces ou grandes surfaces) qui servent d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Plus généralement, on désigne par le terme "marché"le lieu où se rencontrent l'offre (la production, les ventes) et la demande (les achats).
Dans notre représentation du schéma économique, nous devrions distinguer 3 ou 4 marchés :
+ Marché des biens de consommation (finale) : lieu de rencontre de l'offre (la production, les ventes) et de la demande de biens de consommation (ex : achat), c'est-à-dire ne servant pas à la production d'autres biens (ex : le réseau de distribution des petits commerçants ou des grandes surfaces).
+ Marché des biens de production (et de consommation productive) : lieu de rencontre de l'offre (par des entreprises spécialisées dans ces produits) et de la demande de biens de production (ex : achat de machines par des entreprises qui investissent) ou de biens intermédiaires (ex : achat de biens incorporés dans la production d'autres biens), à d'autres entreprises qui les utilisent pour produire d'autres biens.
+ Marché des biens intermédiaires : lieu de rencontre de l'offre (par les entreprises spécialisées dans les produits) et de la demande de biens intermédiaires (ex : achat de matières premières, d'énergie, de produits semi-finis).
+ Marché des facteurs de production : lieu de rencontre de l'offre du travail (par les ménages, ou demande d'emploi) et des capitaux nécessaires aux entreprises (qui demandent du travail et offrent de l'emploi) pour produire.
♦ CIRCUIT ÉCONOMIQUE |
* Considérons les deux premiers agents : les ménages et les entreprises, ainsi que le marché des biens de consommation. Quelles sont leurs relations ? Comment faire apparaître leur interdépendance ?
- Les ménages apportent aux entreprises leur travail.
- Les entreprises apportent au marché leur production.
- Le marché apporte aux ménages les biens et services nécessaires à la consommation.
On peut représenter ces échanges sous forme d'un circuit partant des ménages et y retournant :
|
Figure 5 : les flux de biens/services |
* Cette représentation en forme de circuit met en évidence l'interdépendance des ménages et des entreprises et des trois opérations concernées.
- Sans le travail des ménages, les entreprises ne peuvent produire.
- Sans la production des entreprises, les ménages ne peuvent consommer.
- Sans la consommation, les ménages ne peuvent travailler.
* La notion de flux s'oppose à celle de stock :
le flux correspond à une opération au cours d'une période de temps donnée,
tandis que le stock correspond à une richesse inemployée pendant cette période et disponible pour la période suivante.
Le circuit que nous venons de présenter ne comporte que des produits (biens et services) et du travail. Mais dans une économie où la monnaie sert d'instrument, et de compte, il y a une double circulation de biens et de monnaie : l'argent circule en sens inverse des biens et en contrepartie de ceux-ci.
Cela conduit à distinguer des flux réels et des flux monétaires.
+ un flux réel : mesure la quantité de biens et services échangée entre des agents à l'occasion d'une opération et pendant une période déterminée.
+ un flux monétaire : mesure la quantité de monnaie échangée entre des agents à l'occasion d'une opération et pendant une période déterminée.
* Nous pouvons illustrer cette idée par l'exemple suivant : le circuit d'un billet de banque.
|
Figure 6 : circuit d'un billet de banque Figure 7 : flux de monnaie |
Supposons que la Compagnie générale des Pétroles paie un de ses employés, M. Van Vlees, avec un billet de 50 €.
M. Van Vlees l'utilise pour régler ses achats à l'épicerie Albert. L'épicier à son tour le transmet à la station Carbu où il achète de l'essence. Enfin la station-service utilise ce billet pour payer son fournisseur. La Compagnie générale des Pétroles. Le circuit du billet est fermé.
* Ces exemples très rudimentaires (dans la réalité, les agents peuvent utiliser d'autres formes de monnaie que le billet et, la monnaie, au lieu d'être intégralement dépensée, peut être épargnée), illustre un phénomène de portée tout-à-fait générale : les richesses créées en un point de l'économie y retournent le plus souvent sous une autre forme.
* Si l'on reprend maintenant le premier circuit d'une économie à deux agents et à un marché, on représentera de la même façon, la double circulation des biens et de la monnaie :
|
Figure 8 : flux réels et monétaires... |
- au travail (flux réels) correspondent les revenus des ménages (monétaires),
- à la production (flux réels) correspondent les ventes des entreprises (monétaires),
- à la consommation (flux réels) correspondent les achats des ménages (monétaires).
* celles-ci vont recevoir l'épargne placée par les ménages et l'employé, sous forme de crédits aux ménages et aux entreprises. Ces crédits s'ajouteront aux ressources provenant de la vente de la production pour permettre aux entreprises d'investir, par exemple en achetant des biens d'équipement et de payer leur consommation intermédiaire.
* remarquons que le schéma proposé ici distingue la production des entreprises selon qu'elle réponde à la satisfaction finale des ménages ou qu'elle réponde à la consommation productive de biens intermédiaires.
Cependant, la représentation de ces ressources provenant de la vente de la production pour permettre aux entreprises d'investir, par exemple en achetant des biens d'équipement et de payer leur consommation intermédiaire est mal représentée ici, puisque le flux réel se présente dans un sens double, sans montrer clairement la contrepartie,
ni la production unique qui se partage en consommation intermédiaire (par les entreprises) et consommation finale (par les ménages).
|
Figure 9 : ...avec les institutions monétaires... |
|
Figure 10 : ...ou avec les administrations |
* Elles reçoivent les prélèvements des ménages et des entreprises (impôts, cotisations sociales) et les redistribuent sous forme de transfert, versent également des revenus d'activités à leurs salariés ; le reste de ressources est essentiellement versé aux ménages ; elles s'emploient à offrir des services non-marchands (qui sont comptés comme une consommation finale des administrations) ou à investir .
|
Figure 11 : Schéma économique de base... sans marchés des facteurs ni des biens de productions... |
· il n’y a pas de ventes directes du producteur au consommateur ;
· les ménages apportent aussi des capitaux ou des outils (capital) aux entreprises qui leur paient ce "loyer" d’argent sous forme d’ "intérêts" ou mieux, de "dividendes" ;
· le lecteur aura corrigé l’erreur de fléchage concernant les biens de production acquis par une entreprise ;
· de même, pour le fléchage de flux réels et/ou monétaires relatifs aux importations / exportations ;
· de même, l'imprécision des termes consommation, ventes (ou produits des ventes),...
♦ EXEMPLE D'UTILISATION DU CIRCUIT ÉCONOMIQUE |
* On remarque que tout agent "reçoit" et "envoie" un certain nombre de flèches : cela traduit le principe d'équilibre des ressources et des dépenses. La comptabilité nationale belge fournit chaque année le "chiffrage" de l'ensemble des opérations du circuit. Elle les établit en faisant des comptes équilibrés pour chaque agent.
* Toute modification intervenue à un endroit du circuit se répercute sur l'ensemble : c'est le principe d'interdépendance des agents et des opérations.
* Le circuit économique permet de prévoir les répercussions d'un événement important sur la totalité des agents et de l'économie.
* Supposons que l'ensemble des salaires soit relevé de 10 %. Quelles en seraient les conséquences sur l'économie ? Suivons le "trajet"des répercussions de cette hausse dans le circuit.
|
Figure 12 : un scénario "rose" |
* Le premier élément du circuit à être modifié est bien entendu l'opération "revenus"qui relie les entreprises aux ménages.
* Examinons tout d'abord les conséquences sur les ménages : des revenus plus élevés vont permettre une hausse de leurs achats de biens de consommation sur le marché.
* À son tour, la production des entreprises va être stimulée pour répondre à cette nouvelle demande de produits.
* Si la totalité de la hausse de 10 % des salaires revient ainsi dans les caisses des entreprises, elles retrouveront les sommes qu'elles ont dû dépenser au départ : ne perdons pas de vue que les hausses des salaires ont été payées par elles.
* On peut même prévoir que cette dynamique va continuer : pour produire davantage les entreprises devront recruter des travailleurs. Le chômage diminuera, et les ménages y gagneront de nouveaux revenus qui seront consommés et ainsi de suite à l'infini...
Tout ne se passera pas nécessairement aussi bien. Le scénario "rose"a en effet omis plusieurs éventualités :
· Les ménages peuvent préférer les produits importés à ceux produits par nos entreprises. Ce que les économistes appellent la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) connaîtra un déficit.
|
Figure 13 : ou un scénario "gris" |
* Si toute la hausse salariale aboutit à des importations, il n'y aura pas de ventes supplémentaires pour les entreprises du pays.
* Les entreprises auront des difficultés à payer les augmentations de salaire. Certaines devront fermer ou licencier. Le circuit fonctionnera alors en sens inverse du cas précédent : possible réduction de la masse des salaires, de la consommation, etc.
Pour rappel : une balance penche du côté le plus lourd
Pour le savoir, il faudrait chiffrer avec assez de précision le montant (en milliards de francs) de chaque flux du circuit : Nous verrons plus tard comment la comptabilité nationale y parvient.
Il faudrait prévoir les réactions possibles des agents face à la situation imaginée : quelle proportion de la hausse des salaires va être consommée ou épargnée, dépensée en produits nationaux ou importés ?
Quel est l'état des finances des entreprises, et pourront-elles payer l'augmentation de leurs charges ? Dans quelle mesure le pays peut-il accepter un déficit de son commerce extérieur ?
Enfin, quelles seront les conséquences sociales des deux politiques ? C'est à cet ensemble de questions que la suite du programme s'efforcera de répondre...
♦ Secteurs institutionnels, acteurs économiques et leurs opérations économiques |
L'objet de cette partie de chapitre est de proposer une vue d'ensemble de l'économie nationale : c'est l'occasion de revoir ou d'acquérir des notions indispensables, inscrites au programme de l'option de Sciences économiques et sociales de deuxième secondaire.
Quels sont les principaux acteurs de la vie économique ? Ces acteurs, que la comptabilité nationale belge qualifie de "secteurs institutionnels" effectuent différentes sortes d'opérations dont vous devez connaître le sens précis.
Le cadre de référence des définitions qui vont suivre est celui du système élargi de comptabilité Nationale : créée en 1945, la comptabilité nationale a été modifiée afin d'harmoniser le système avec les méthodes proposées par l'ONU pour l'ensemble des pays.
La comptabilité nationale définit tout d'abord les unités institutionnelles qui sont des "unités statistiques élémentaires de décision économique". Un ménage, une entreprise sont des exemples types de ces unités statistiques, mais ils sont trop "individuels". La comptabilité nationale va regrouper ces unités élémentaires en ensembles homogènes, les secteurs institutionnels, agrégats d'unités individuelles.
Un secteur institutionnel regroupe un ensemble homogène d'agents selon deux critères :
· ils remplissent la même fonction principale dans la vie économique ;
· leurs ressources sont de même nature ;
Termes synonymes : catégorie d'agents, agrégats ou simplement "agent économique", "acteur économique".
Ne pas confondre avec les "secteurs d'activité".
Les six secteurs institutionnels sont :
1. les ménages ;
2. les sociétés et quasi-sociétés ;
3. les administrations publiques ;
4. les administrations privées ;
5. les institutions financières ;
6. les entreprises d'assurance.
La comptabilité nationale ajoute à ces six secteurs le reste du monde : il s'agit en réalité d'une unité comptable fictive, puisqu'elle recouvre des fonctions et des ressources hétérogènes.
Ménage : entité qui comprend une ou plusieurs personnes, n'ayant pas forcément de lien de parenté, occupant la même résidence principale.
La notion de ménage est plus large que celle de famille.
Famille : partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes, et constituée soit d'un couple et le cas échéant de ses enfants célibataires de moins de 25 ans, soit d'un parent isolé et de ses enfants célibataires de moins de 25 ans.
Les ménages ont une fonction principale : la consommation finale de biens et de services ; ils peuvent également, en tant qu'entrepreneurs individuels, produire des biens et des services.
Les entrepreneurs individuels sont à la fois des entreprises et des ménages. La comptabilité nationale a choisi de les classer au sein du secteur institutionnel des ménages, notamment parce qu'on ne peut distinguer le patrimoine de l'entrepreneur de celui de son ménage : l'entrepreneur individuel engage ses biens personnels dans son entreprise.
Les ressources principales des ménages proviennent des revenus d'activité (pour les salariés ou les entrepreneurs individuels) et de revenus de transferts.
Le secteur institutionnel des sociétés et quasi-sociétés non financières (SQS) regroupe les unités dont la fonction principale est de produire des biens et des services marchands.
Leurs ressources principales doivent provenir au moins pour moitié de la vente de leur production sur le marché.
Une société privée se caractérise par le fait que son capital appartient à plusieurs personnes privées.
Il y a plusieurs sortes de sociétés privées. Rappelons quelques traits qui les différencient, pour plus de détails voir le cours ci-avant :
|
Types de sociétés |
Propriétaires (nature, droits, pouvoirs) |
|
Société de personnes en nom collectif |
· responsables sur leurs biens propres · accord des associés pour vendre des parts · pouvoir au gérant et aux associés
|
|
Société privée à responsabilité limitée (SPRL) |
· pas responsables sur leurs biens propres · accord des associés pour vendre des parts · pouvoir au gérant et aux associés
|
|
Société anonyme (SA) |
· pas responsables sur leurs biens propres · revente libre des parts (= actions) · pouvoir aux actionnaires majoritaires (1 action = 1 voix), qui élisent le conseil d'administration
|
|
$$$$ |
· pas responsables sur leurs biens propres · les statuts fixent le fonctionnement · possibilité de dissocier la possession du capital et le pouvoir de décision
|
|
Société coopérative |
· les salariés sont propriétaires de leur entreprise · accord des associés pour vendre des parts · pouvoir aux associés : 1 homme = 1 voix
|
voir aussi "Formes des entreprises" ci-après
Les entreprises publiques ont des statuts juridiques variés : l'Électrabel, la SNCB ou La Poste ont un statut d'établissement public, la Sabena ou Belgacom sont des sociétés d'économie mixte.
Dans le premier cas, ces entreprises sont sous la tutelle d'un ministère, mais elles disposent d'une autonomie de gestion suffisante pour qu'on puisse parler de quasi-sociétés.
· Le capital des entreprises publiques appartient en totalité à l'État ou à une collectivité publique.
· Le capital des sociétés d'économie mixte est partagé entre l'État (qui doit au moins avoir une minorité de blocage = 25 %) ou des collectivités publiques et des personnes privées.
· Les quasi-sociétés sont des établissements publics de grande taille, produisant des biens et services marchands et dont l'administration n'est pas le seul client.
· Ces sociétés et quasi-sociétés publiques tirent leurs ressources principales de la vente de leur production sur le marché : c'est ce qui les distingue des administrations publiques.
La comptabilité nationale regroupe les comptes des grandes entreprises qui ont en commun d'avoir une position de monopole dans un secteur de base.
Ce n'est pas le cas de nombreuses autres sociétés nationalisées du secteur commercial concurrentiel, telles que Belgacom, la Sabena, etc. qui doivent (ou devront) partager le marché avec des sociétés privées et étrangères.
Ce secteur institutionnel a pour fonction essentielle la production de services non marchands. Il faut savoir que :
Les administrations publiques ont deux fonctions principales :
· la production de services non marchands destinés à la collectivité ;
· la redistribution.
Leurs ressources proviennent au moins pour moitié des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales).
Les APU regroupent trois sous-secteurs :
· les administrations publiques fédérales : l'État et certains organismes qui lui sont rattachés (ex : l'Administration pénitentiaire) ;
· les collectivités locales : communes, provinces, Régions et/ou Communautés ; ainsi que diverses administrations locales : communautés urbaines, bureaux d'aide sociale, chambres de commerce et d'industrie (CCI), etc. (ex : Le C.P.A.S.) ;
· les organismes de Sécurité sociale dont la fonction essentielle est la redistribution : ils prélèvent les cotisations sociales et les redistribuent aux ménages sous forme de prestations sociales (ex : l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I.).
Le terme d'administrations privées recouvre en fait des institutions qui vous sont familières : syndicats, associations, communautés religieuses, partis politiques, etc.
Ces administrations privées (APRI) ont pour fonction principale de produire des services non marchands réservés à des groupes particuliers de ménages, ou encore de vendre des services marchands, mais "sans but lucratif"c'est-à-dire sans profit. Plus de la moitié de leurs ressources proviennent des contributions volontaires de leurs membres.
Les institutions financières ont pour fonction le financement de l'économie, qui peut se résumer à un triple rôle :
· d'intermédiaire financier entre les agents qui souhaitent placer leur épargne et ceux qui désirent emprunter des fonds ;
· de transformation de l'épargne placée à court terme en prêts à moyen ou, long terme ;
· de circulation et de création de moyens de paiement (création de monnaie).
Leurs ressources proviennent principalement de l'épargne collectée ou des emprunts contractés sur les marchés de capitaux ainsi que de la monnaie qu'elles créent.
Nous allons voir que certains agents dégagent une "capacité de financement", et les autres, un "besoin de financement". Les institutions financières vont les rapprocher ; ce rôle d' "intermédiation" comme celui de transformation et de création monétaire seront développés plus loin.
On trouve parmi les institutions financières : la Banque Nationale et les banques, ainsi que de nombreux organismes financiers parmi lesquels on peut citer :
La Caisse Générale de l'Épargne et de Retraite (CGER) dont l'essentiel des ressources provenait des dépôts des petits épargnants, le Crédit Communal (prêts d'accession à la propriété pour les communes), la Société Nationale de Crédit à l'Industrie [SNCI] (financement dans l'industrie et l'énergie, etc.).
Les entreprises d'assurances ont pour fonction l'indemnisation des sinistres auxquels sont exposés leurs assurés.
Leurs ressources proviennent des primes prévues dans les contrats souscrits par ces derniers ou de cotisations volontaires (cas des mutuelles), ainsi que des intérêts rapportés par les fonds placés.
Le "reste du monde" regroupe l'ensemble des agents non résidents qui font des opérations de toute nature avec les agents résidant sur le territoire économique national, qui ne comprend que le territoire du Royaume. Un agent est qualifié de "résident" s'il exerce une activité sur le territoire national depuis au moins un an (ex : VW à Forest, Bruxelles). Une entreprise belge, dont les activités sont "hors" territoire national, sera considérée comme faisant partie du "Reste du Monde" (ex : Lion Food aux USA, entreprise Delhaize le Lion).
Au sens large, la production est la création de biens et de services afin de satisfaire les besoins. Nous préférons une définition de la production qui rejette toute "fabrication"ou "transformation" d'ordre privé et qui ne remet pas dans le circuit économique, le fruit de cette transformation. Ainsi, même si je "transforme" la farine que j'achète en pain, je ne "produis" pas, je satisfais mon besoin d'une autre manière... j'aime faire mon pain et le préfère à celui acheté ; on parlera alors d'autoproduction des consommateurs. Toute opération de production met en jeu tout un processus productif qui fait l'objet de la suite.
La comptabilité nationale adopte une définition plus stricte :
la production est l'activité économique socialement organisée consistant à créer des biens et des services s'échangeant sur le marché et/ou obtenus à partir de facteurs de production s'échangeant sur le marché.
Cette définition permet, en procédant par élimination, d'exclure des activités qui ne sont pas comptabilisées comme production :
· "socialement organisée" exclut les activités illégales, comme le travail au noir. Cette "économie souterraine"est pourtant non négligeable, et a pu être évaluée à environ 6 % du PNB, dans le cas de la France ;
· "s'échangeant sur le marché "exclut le travail domestique que l'on effectue pour soi, sans contrepartie monétaire et que nous qualifierons d'autoproduction, échappant aux statistiques économiques. Désolé, mais des livres destinés à l'enseignement secondaire font état d'une consommation productive lorsqu'un ménage achète de la farine pour faire du pain...
Cette convention peut être critiquée : si un patron épouse sa femme de ménage, il est probable qu'il ne continuera pas à la payer pour faire le ménage, et cela contribuera à faire baisser le PNB. Mais il est difficile de mesurer avec précision cette importante autoproduction domestique : elle représenterait, selon les études, de 30 à 45 % du PNB.
En revanche, la fin de la définition inclut les services non marchands tels que l'enseignement ou les services hospitaliers. Ces services ne sont pas vendus, mais nécessitent le paiement des facteurs de production : salaires de l'enseignant ou du personnel hospitalier.
On distingue donc, au sein de la production, entre :
· la production marchande, qui comprend les biens et les services vendus à un prix permettant de couvrir les coûts nécessaires à leur production ;
· la production non marchande, qui comprend les services fournis gratuitement ou quasi gratuitement à la collectivité : ils ne donnent pas lieu à un paiement couvrant les coûts de leur production. Certains auteurs y ajoutent aussi l'autoproduction des ménages ; nous ne commenterons plus cette approche imprécise.
Les services non marchands sont financés par les prélèvements obligatoires (impôts, cotisations) ou par des contributions volontaires.
La production marchande d'une entreprise se mesure aux prix du marché et correspond donc au chiffre d'affaires de l'entreprise, soit le total de ses ventes.
Les consommations intermédiaires comprennent les biens et les services marchands qui sont utilisés pour produire d'autres biens : ces biens de production sont en quelque sorte "détruits"ou transformés au cours du processus de production.
Par exemple, une entreprise fabriquant des confitures achètera des fraises et du sucre afin de les transformer. Mais elle utilisera également des pots en verre, de l'énergie pour faire tourner ses machines, elle réglera les services d'une entreprise de communication chargée de sa publicité, d'un expert-comptable, etc. : l'ensemble constitue ses consommations intermédiaires.
L'enseignement secondaire inférieur fait peu état de cette consommation intermédiaire, il l'assimile à une consommation de biens de production...
La valeur ajoutée d'un agent permet de mesurer la contribution de celui-ci à la production nationale. Il faut donc soustraire du total de sa production les différentes consommations intermédiaires qu'il s'est procurées auprès d'autres agents :
Valeur ajoutée = production - consommations intermédiaires
Si l'entreprise de confitures évoquée ci-dessus a un chiffre d'affaires de 100 millions de BEF, et qu'elle achète pour 60 millions de BEF de consommations intermédiaires, sa valeur ajoutée est de 40 millions de BEF, qui mesure ce qu'elle a ajouté aux biens et services qu'elle a transformés ou utilisés.
Nous verrons que c'est la valeur ajoutée qui est utilisée pour calculer le produit intérieur brut.
La consommation finale des ménages est l'utilisation de biens et de services destinés à la satisfaction de leurs besoins.
Elle est qualifiée de finale dans la mesure où elle achève le processus de production : les biens consommés sont considérés comme détruits, même si, dans le cas des biens durables ou semi-durables (comme des vêtements), ils peuvent servir au delà d'une année.
L'achat de fraises par un ménage est une consommation finale. Le même achat effectué par l'entreprise pour la fabrication de confitures est une consommation intermédiaire.
La consommation de services non marchands, tels que l'entretien des routes ou l'éclairage public, est impossible à affecter entre les différents agents (ménages, entreprises) qui en bénéficient, dans la mesure où la plupart de ces services collectifs ne sont pas facturés aux utilisateurs.
Par convention on considère donc que ce sont les administrations qui les consomment :
La consommation finale des administrations correspond à l'ensemble des services non marchands qu'elles ont produits, et dont bénéficie la collectivité.
Investir, au sens large, c'est effectuer des dépenses en vue de maintenir, d'augmenter ou de perfectionner le capital fixe nécessaire à la production.
Le capital fixe est l'ensemble des moyens de production matériels (terrains, bâtiments, machines) et immatériels (brevets, logiciels...) qui ne sont pas détruits au cours du processus de production. Autres biens de production, dont la durée excède un an.
On distingue deux sortes d'investissements : l'amortissement et l'investissement net, l'ensemble formant l'investissement brut :
· L'amortissement est l'investissement servant à renouveler le capital usé ou techniquement dépassé ("obsolète") ;
· l'investissement net est celui qui augmente le stock de capital existant.
· Investissement brut = investissement net + amortissement.
La comptabilité nationale distingue quant à elle : la formation brute de capital fixe, l'acquisition de terrains et d'actifs incorporels (brevets, licences, droits d'auteur) et la variation des stocks.
La formation brute de capital fixe (FBCF) est l'acquisition de biens durables utilisés pendant au moins un an pour la production : achats de biens d'équipement et de bâtiments par les entreprises, de logements par les ménages.
Une augmentation des stocks peut être considérée comme un investissement : l'entreprise constitue des stocks (de matières premières, et de produits finis) de façon à pouvoir répondre rapidement à une hausse de la demande, avec des délais réduits de livraison aux clients. Cependant le niveau des stocks ne doit pas être excessif : il immobilise de l'argent, puisque l'entreprise a dû payer les frais nécessaires à leur production puis à leur stockage.
Les exportations sont les ventes au reste du monde de biens et services produits sur le territoire national.
Les importations sont les achats de biens et de services en provenance du reste du monde.
Les opérations de répartition décrivent comment sont distribués ou redistribués les revenus entre les différents agents.
À partir du partage de la valeur ajoutée s'effectue une première répartition ou distribution des revenus primaires, puis une redistribution déterminant finalement le revenu disponible des agents.
Le tableau ci-dessous récapitule les principales opérations de répartition, selon le classement de la comptabilité nationale, en précisant les agents pour lesquels chaque opération est une dépense (ou un "emploi") et une ressource : par exemple, le paiement des salaires est une dépense pour les entreprises et une ressource pour les ménages.
|
Les principales opérations de répartition :
|
|||
|
Sous-ensembles |
Opérations |
Dépense (emploi) pour |
Ressource pour |
|
Rémunération des salariés |
Salaires, traitements bruts Cotisations des employeurs |
Entreprises |
Ménages |
|
Impôts liés à la production et à l'importation |
T.V.A Prélèvement de la CE Droits de douane |
Entreprises, Ménages Admin.publ. Reste du Monde |
Admin.publ. Reste du Monde Admin.publ. |
|
Subventions d'exploitation ou à l'importation |
Subventions d'exploitation |
Admin.publ.
|
Entreprises |
|
Revenus de la propriété et de l'entreprise |
Intérêts des prêts Dividendes Redevance (brevet) |
tous Sociétés &Quasi-sociétés Entreprises |
tous tous Entreprises, Ménages |
|
Opérations d'assurance-dommage |
Primes d'assurances Indemnités d'assurances |
tous Entreprises d'assurance |
Entreprises d'assurance tous |
|
Transferts courants sans contrepartie |
I.P.P. I.Soc. Cotisations des salariés Prestations sociales |
Ménages Sociétés &Quasi-sociétés Ménages Admin.publ. |
Admin.publ. Admin.publ. Admin.publ. Ménages |
|
Transferts en capital |
Droits de succession Aides à l'investissement |
Ménages Admin.publ. |
Admin.publ. Entreprises, Ménages |
Les opérations financières se traduisent, pour un agent, par une modification du montant de ses créances ou de ses dettes.
· Avoir une créance, c'est avoir un droit sur un autre agent ; ex. : effectuer un prêt, contracter une assurance ; synonyme de créance : détention d'actif financier.
· Une dette, c'est une obligation de livrer à une échéance donnée une partie de ses avoirs à un autre agent ; ex. : obligation pour l'emprunteur de rembourser son emprunt ou pour l'assureur de couvrir les dépenses occasionnées par un sinistre.
· Toute créance détenue par un agent a pour contrepartie une dette équivalente pour un autre agent, et vice-versa.
Les sociétés de personnes // Les sociétés de capitaux // Les sociétés mixtes
l
Dans ce type de société, l’élément fondamental est la prise en considération de la personnalité des associés (intuitu personnae). Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, c’est à dire que toute leur fortune est engagée et qu’ils sont liés par les actes de gestion posés par leurs partenaires. La société prend fin à la mort du gérant.
Exemples : SNC, SCS, SCRIS.
L’élément fondamental est l’apport des associés. Les associés n’engagent qu’une mise déterminée.
Exemple : SA.
La personnalité de l’associé reste un élément important mais pas prépondérant.
Exemples : SPRL, SCRL.
La société en commandite simple est celle qui comprend deux groupes d’associés :
- les commandités indéfiniment et solidairement responsables (les commerçants).
- les commanditaires qui ne sont responsables qu’à concurrence de leur apport.
La société existe sous une raison sociale qui ne peut comprendre que le nom des commandités. L’associé commanditaire ne peut poser aucun acte de gestion, même en vertu d’une procuration.
L’acte de constitution peut être authentique ou sous seing privé.
La société en commandite par actions est celle qui comprend deux groupes d’associés :
- les commandités
- les actionnaires commanditaires.
La société existe sous une raison sociale qui ne peut comprendre que le nom des associés responsables, elle doit être suivie ou précédée de la mention « société en commandite par actions .
L’acte doit être authentique.
La S.C. est celle qui se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables. Le nombre des associés et par conséquent le capital est variable ; les parts sociales sont, en principe, incessibles à des tiers ; la société n’existe pas sous une raison sociale, elle est qualifiée par une dénomination particulière.
La S.C. peut revêtir deux formes :
- la S.C.R.L., la S.C. à responsabilité limitée (cfr. conditions pour les S.P.R.L.)
- la S.C.R.I.S., la S.C. à responsabilité illimitée et solidaire.
La société en nom collectif est celle que contractent deux ou un plus grand nombre de personnes et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Cette dernière peut être formée de plusieurs façons :
le nom de tous les associés s’ils sont peu nombreux ;
le nom de deux ou trois associés suivis des mots &C° ;
le nom d’un seul associé suivi des mots &C°.
La loi impose cette prescription parce que la S.N.C. est composée d’associés tenus solidairement, le nom de la société est donc aussi le leur ; la loi a voulu empêcher que les tiers ne soient induits en erreur par suite de l’existence dans la raison sociale de noms de personnes étrangères à la société, et que ces tiers ne soient amenés à donner à celle - ci plus de crédit qu’elle n’en mérite réellement.
Les associés sont responsables :
· solidairement : les associés répondent solidairement, chacun pour tous, vis à vis des tiers de tous les engagements de la société, même lorsque ces engagements n’ont été pris que par l’un des associés, à condition que ce soit la raison sociale. Les créanciers peuvent contraindre n’importe lequel des associés pour la totalité des dettes de la société.
· indéfiniment : tous les associés s’engagent non seulement jusqu'à concurrence de leur apport mais aussi pour tout leur avoir personnel en dehors de la société.
La S.P.R.L. est celle constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent que leur apport et où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions.
La société peut compter comme associés des personnes physiques ou des personnes morales. S’il s’agit d’une société unipersonnelle constituée par une personne physique, cette personne bénéficie de la séparation des patrimoines.
Le capital doit être d’un montant minimum de 750.000 BEF, intégralement souscrit, la libération doit atteindre au moins 250.000 BEF.
Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Chaque part doit être libérée d’un cinquième au moins, mais les parts représentatives d’apports doivent être libérées intégralement.
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à 1.000 BEF. On ne peut pas créer des parts privilégiées ou des parts bénéficiaires non représentatives du capital.
Les comparants à l’acte constitutifs sont considérés comme fondateurs. Leur responsabilité est analogue à celle des fondateurs de S.A.
Il est tenu au siège de la société un registre des associés qui mentionne :
- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;
- l’indication des versements effectués ;
- les transferts et transmissions de parts.
La S.A. est celle dans laquelle au moins deux associés n’engagent qu’une mise déterminée.
Elle n’existe pas sous une raison sociale, elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés, elle est qualifiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise.
Le capital doit être entièrement souscrit et ne peut être inférieur à 2.500.000 BEF. Le capital souscrit doit être libéré à concurrence d’au moins un quart sans pouvoir être inférieur à 2.500.000 BEF. Les actions correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de 5 ans.
La société doit être constituée par un acte authentique. Les apports en nature doivent faire l’objet d’un apport du réviseur désigné préalablement à la constitution par le fondateurs.
Les fonds sont préalablement à la constitution versés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
Les fondateurs doivent remettre au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer.
L’acte de la société indique :
n la forme et la dénomination de la société ;
n la désignation précise de l’objet social ;
n la désignation précise du siège social ;
n la durée de la société, lorsqu’elle n’est pas illimitée ;
n le montant du capital social souscrit ainsi que le montant de la partie libérée (éventuellement le montant du capital autorisé) ;
n le nombre et le mode de désignation des représentants des organes de gestion ;
n le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions représentatives du capital social ;
n le nombre et le droit des parts bénéficiaires ;
n l’identité des fondateurs (au moins deux représentants, au moins un tiers du capital social, ils sont responsables en cas de faillite dans les trois ans de la constitution si le capital était manifestement insuffisant).
La S.A. peut également être constituée sous forme de souscription. Elle est administrée par un conseil d’administration, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Le capital se divise en actions, avec ou sans mention de valeur. Elles peuvent être nominatives ou non.
La modification des statuts est décidée par l’assemblée générale à majorité des ¾ des voix et si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social (majorité spéciale des 4/5, si la modification porte sur l’objet social).
♦ PROCESSUS PRODUCTIF : FACTEURS DE PRODUCTION et RÔLE DES ENTREPRISES DANS LEUR COMBINAISON |
Les économistes retiennent couramment deux facteurs : le travail et le capital (certaines analyses prennent en compte un troisième facteur : les ressources naturelles (assimilées à du capital détenu, pour ceux qui n'en font pas un facteur distinct) ; d'autres y ajoutent la recherche, ou l'énergie ou encore l'information).
Les facteurs de production sont les éléments nécessaires à la production : le travail et le capital. Les producteurs combinent au mieux ces 2 facteurs pour produire mieux et moins cher.
Travail : désigne, dans les sociétés industrielles, une activité humaine rémunérée, qui donne lieu à une contrepartie en monnaie ou en nature.
Gary Becker, prix Nobel d'économie en 1992, est à l'origine d'un nouveau sens donné à l'expression "capital humain" ; désignant les capacités intellectuelles et professionnelles d'un individu, capacités propres à lui assurer des revenus monétaires nouveaux. Cette notion est intéressante, car elle permet de parler d'investissement en capital humain, à travers l'éducation et la formation. Elle montre que les salariés ne sont plus qu'un coût pour l'entreprise, ils sont aussi une occasion d'investissement pour assurer l'avenir de l'entreprise.
voir Étape n° 2
voir Étape n° 2
voir Étape n° 2
Le capital est le second facteur indispensable à toute activité productive. Le terme de capital peut être employé dans deux sens différents :
Le capital d'une entreprise, au sens financier ou comptable, désigne les fonds propres d'une entreprise : la somme d'argent que les propriétaires lui apportent à son démarrage, puis pour lui permettre de se développer.
Ainsi : "société anonyme au capital de 10 millions de francs"signifie que les actionnaires ont souscrit par exemple 10 000 actions de l'entreprise, valant 1 000 francs chacune. Si la société décide une augmentation de capital de 5 000 000 francs, cela signifie qu'elle va émettre 5 000 actions nouvelles pour augmenter ses fonds propres. (voir syllabus de comptabilité)
Par extension, au sens technique, il désigne alors un facteur de production de l'entreprise : Le capital technique est l'ensemble des actifs ou du patrimoine susceptible de procurer un revenu, ce que l'entreprise possède, ses moyens de production
· - matériels (terrains, bâtiments, machines, matières premières, énergie...) ;
· - immatériels (brevets, logiciels...) ;
qui permettent à une entreprise de fonctionner.
Il comprend le capital fixe (défini avec les opérations sur biens et services)et le capital circulant.
Le capital circulant est l'ensemble des moyens de production détruits au cours du processus de production, dont la durée d'utilisation est inférieure à un an. Terme quasi-synonyme : consommations intermédiaires.
Imaginons un agriculteur habitant loin d'un point d'eau. Pour irriguer ses champs, il peut se rendre régulièrement au point d'eau (travail). Mais il peut aussi fabriquer son système de canalisation, assurant une irrigation immédiate de ses plantations. La construction de ce système constitue un "détour"de production car l'agriculteur a passé du temps (au détriment de ses activités agricoles) pour concevoir ce système. Mais, ce détour lui permet d'avoir aujourd'hui des terres plus rentables grâce au capital que constitue son système d'irrigation, résultat d'un travail antérieur, "accumulé".
L'entreprise a pour objectif premier de produire afin de satisfaire les besoins de ses clients. Cependant, en économie de marché cet objectif général n'est atteint qu'indirectement : l'entreprise est confrontée à un environnement concurrentiel (cf. suite du cours), et doit lutter pour se maintenir sur le marché.
Dès lors, elle vise plusieurs objectifs interdépendants qui assureront sa survie, et son expansion :
· maintenir ou augmenter son chiffre d'affaires ;
· maximiser son profit ou bénéfice ;
· minimiser ses coûts de production ;
· conserver ou augmenter ses parts de marchés face aux concurrents.
Le chiffre d'affaires est le total des ventes de l'entreprise :
Chiffre d'Affaires (CA) = Σ(quantité produite x prix de vente unitaire).
Les coûts de production sont la somme des dépenses en travail (salaires, cotisations sociales de l'employeur, etc.), en capital fixe (achats de machines) et circulant (consommations intermédiaires) engagées dans la production. On doit y ajouter les frais financiers et les impôts et taxes versés par l'entreprise.
Bénéfice total = Chiffre d'affaires - coûts de production
|
Chiffre d'affaires =
quantités * prix de vente
|
|
Coûts de production :
travail (salaires, cotisations sociales…) investissement consommations intermédiaires frais financiers impôts et taxes |
|
|
Bénéfice (=profit)
|
La concurrence à laquelle se livrent les entreprises est une des caractéristiques de l'économie de marché. Elle se fait sentir sur les différents marchés (voir section 3, A) où intervient une entreprise et qui constituent son environnement immédiat. Sur ces marchés l'entreprise rencontre, outre ses concurrents, plusieurs acteurs avec lesquels elle doit négocier.
On verra comment l'entreprise détermine son prix de vente et la quantité qu'elle doit vendre sur le marché de son produit, de façon à maximiser son profit. Les décisions qu'elle prend dépendent du degré de concurrence sur ce marché. De même, l'entreprise négocie sa marge bénéficiaire avec les entreprises de distribution qui commercialisent ses produits.
|
Figure 14 : environnement concurrentiel... |
Sur le marché du travail, l'entreprise recherche le personnel dont elle a besoin. Elle y négocie, dans le cadre de la législation du travail, le montant des salaires qu'elle lui versera.
Le marché du travail est le lieu fictif (partie du marché des facteurs de production) où se rencontrent une demande de travail émanant des employeurs et une offre de travail provenant des travailleurs. Termes synonymes : demande de travail = offre d'emploi ; offre de travail = demande d'emploi.
Dans la réalité, la rencontre de l'offre et de la demande de travail se fait par l'intermédiaire de l'ONEM, (Orbem, Forem), des cabinets privés de recrutement, des annonces d'offre et de demande d'emploi dans les journaux, de contacts directs avec l'employeur, etc.
· Sur le marché des biens de production, l'entreprise s'approvisionne en capital circulant, et achète les biens d'équipement. Elle peut aussi faire fabriquer une partie de sa production par des sous-traitants.
· Sur les marchés monétaire et financier (cf. chapitre 3), l'entreprise emprunte et place de l'argent, émet des actions nouvelles, etc.
Ayant défini ses objectifs, et les facteurs de production dont elle dispose, l'entreprise doit déterminer un mode d'organisation du travail. Les entreprises regroupent un personnel souvent nombreux et diversifié. Comment faire travailler toutes ces personnes ensemble, répartir les tâches, réguler les conflits, faire circuler les informations utiles et développer la communication, etc. ? Tels sont les problèmes que doit résoudre, d'une manière ou d'une autre, l'organisation du travail.
Les différents modes d'organisation varient d'une entreprise à une autre, en fonction de sa taille, des techniques employées et de la "culture de l'entreprise", qui est le produit de son histoire propre.
Cependant, certains modèles d'organisation apparaissent comme dominants à une époque donnée : c'est ainsi qu'au taylorisme et au fordisme succéderait aujourd'hui un modèle d'organisation post-fordiste.
Le modèle tayloriste d'organisation scientifique du travail , (OST) repose sur une double division du travail :
· une division verticale : séparation absolue entre la conception du travail (effectuée par les "cols blancs"des "bureaux des méthodes") et son exécution (par les "cols bleus", ouvriers spécialisés [OS] non qualifiés, étroitement contrôlés et soumis à des cadences strictement chronométrées) ;
· une division horizontale : spécialisation (ou parcellisation) très poussée des tâches d'exécution : chaque OS doit accomplir une tâche simple et répétitive, en un minimum de temps.
Le modèle fordiste d'organisation du travail reprend la division taylorienne, en y ajoutant trois innovations :
· Le travail à la chaîne : un convoyeur permet la circulation automatique du produit en cours de fabrication entre des postes de travail fixes et alignés ; la vitesse de la chaîne impose une cadence uniforme au travail des ouvriers ;
· la standardisation des produits, permettant un abaissement considérable des coûts de production, et débouchant sur une production de masse ;
· une pratique de "hauts salaires" afin de réduire l'instabilité du personnel (turn-over) qui résulte du caractère éprouvant du travail à la chaîne, et de favoriser indirectement une consommation de masse, équilibrant la production de masse.
Aujourd'hui, les modèles tayloriste et fordiste d'organisation du travail semblent de moins en moins bien adaptés à l'évolution des facteurs de production : hausse du niveau d'instruction des salariés qui ne se satisfont plus d'un travail sans autonomie ni responsabilité ; développement de l'automation qui tend à substituer des automates programmables aux OS ; souci de réduire les stocks au minimum ("zéro stock").
Du côté des consommateurs, des exigences nouvelles se manifestent : demande de produits différenciés (et non plus standardisés), d'une qualité irréprochable ("zéro défaut"), livrables immédiatement ("zéro délai").
Un nouveau modèle d'organisation du travail - encore en gestation - semble se dessiner, que l'on définira par le trait qui semble l'opposer le plus au taylorisme :
Post-taylorisme (ou post-fordisme) : organisation du travail caractérisée par la mise en oeuvre de diverses formes de participation des travailleurs aux décisions concernant la production ; notamment par :
· la rotation des postes (l'ouvrier occupe successivement différents postes de travail) ; - l'élargissement et l'enrichissement des tâches ;
· les groupes semi-autonomes (responsables de l'organisation des moyens pour atteindre une norme fixée par la direction) ;
· les cercles de qualité : groupes volontaires réunis pour étudier et résoudre des problèmes liés à la qualité du produit.
Si ce modèle est apparu, sous des formes assez différentes, dans des entreprises telles que Volvo en Suède, Toyota au Japon ou General Motors aux États-Unis, il est loin d'être généralisé : de nombreux secteurs restent dans la logique taylorienne ; d'autres y accèdent maintenant.
Combinaison productive : c'est l'opération qui consiste à utiliser une certaine quantité de travail et de capital pour obtenir un produit (bien ou service).
Elle est optimale lorsqu'elle minimise les coûts de production et procure donc le bénéfice maximal.
L'entreprise, en fonction du prix de chaque facteur et de sa productivité (voir ci-dessous), pourra choisir de remplacer par exemple le travail par du capital : on parle alors de substitution des facteurs :
Il y a substitution du capital au travail lorsque l'on décide de remplacer un certain nombre de travailleurs par des équipements : c'est le cas de l'automation.
Productivité d'un facteur : c'est la quantité produite par unité de facteur considéré :
productivité du travail = production totale .
quantité de travail employée
productivité du capital = production totale .
quantité de capital utilisée
Exemple : une entreprise produit annuellement 100 000 unités vendues au prix unitaire de 1000 francs, avec un personnel de 10 salariés pour une durée annuelle de travail de 1 500 heures et un capital fixe de 5 millions de francs ; on peut calculer :
· le chiffre d'affaires : 100 millions de francs ;
· la productivité du travail : 10 000 unités par tête ou 10 000 000 francs par tête ou encore 6 666 francs par heure de travail ;
· la productivité du capital : 20 BEF de C.A. par franc de capital investi.
L'entreprise soumise à la concurrence est sans cesse en quête de gains de productivité. Elle va chercher à réduire la quantité des facteurs entrant dans la combinaison productive pour une même production "sortant"de l'entreprise, ce qui contribuera à réduire le coût de production moyen ou prix de revient. L'investissement est un moyen d'y parvenir. On distingue :
· L'investissement de productivité, qui permet de réduire le coût des facteurs employés pour une quantité de production inchangée.
· L'investissement de capacité, qui permet d'augmenter la production de l'entreprise.
Ces deux investissements ne s'opposent pas nécessairement ; il est même fréquent qu'un agrandissement de la taille de l'entreprise entraîne des gains de productivité ; c'est le phénomène des économies (ou rendements) d'échelle .
· Économies d'échelle : il y a économie ou rendement d'échelle croissants lorsque l'augmentation de la taille de l'entreprise entraîne une diminution des coûts de production et, par conséquent, des gains de productivité.
Les investissements de productivité portent en particulier sur :
· l'organisation du travail : par exemple l'introduction de la chaîne pour le montage des moteurs Ford permit en quelques mois de multiplier par quatre la production par tête ;
· la substitution du capital au travail : c'est le phénomène de l'automation.
Proposé par : Danielle Dehoux
Niveau : Seconde
Thème du programme : circuit économique
Type de document : Contrôle (ou TD)
Objectifs :
Durée de la séance : 1 heure
(pensez à la présentation et à l'orthographe, indiquez le détail des calculs)
1) Représentez sous forme de circuit les échanges entre les différents agents économiques cités dans le texte ci-après, distinguez les flux de travail, les flux réels et les flux monétaires. Expliquez quel est l'intérêt de construire un tel schéma. (/ 8)
Un village imaginaire: Azzuro.
C'est un charmant petit village situé dans une zone tempérée, il est doté d'une agriculture prospère et d'abondantes ressources naturelles. Les Verdurin sont des agriculteurs heureux, comme leurs voisins les Mathieux et les Agliettaux, ils vendent les produits de leurs exploitations agricoles aux habitants du village.
L'entreprise Lequesnay fabrique divers biens de consommation achetés par les habitants du village, elle emploie de nombreux salariés, comme Madame de l'Alma, Monsieur Sage, et Mademoiselle Performa. L'entreprise Horus met son point d'honneur à produire des équipements adaptés aux besoins du village, elle emploie également de nombreux salariés: Monsieur de L'Alma, Madame Sage, Monsieur Renaudot. La banque Malais gère l'argent, les crédits, etc..
Le village dispose de plus d'un ensemble administratif efficace regroupant des services de santé, d'enseignement, et de culture dont bénéficie toute la population. Il existe aussi en Azzuro plusieurs commerces et des boutiques artisanales, par exemple: librairie (mademoiselle Agliettaux), cordonnier Angelo Ricordo, coiffeur (le fils Mathieux), esthéticiennes(mademoiselle de l'Alma). Le village n'a presque aucun échange avec les autres villages, il vit en quasi- autarcie.
1) une portion de frites au MacDonald's, 2) un repas au restaurant vietnamien, 3) un plat de spaghettis à la bolonaise préparé et mangé à la maison, 4) un morceau de pain acheté chez le boulanger, 5) une boîte de foie gras, 6) un bol de soupe préparé à la maison avec les légumes du jardin, 7) un verre de lait, 8) un repas à la cantine du lycée, 9) le stock hebdomadaire de produits alimentaires achetés dans une grande surface, 10) un verre d'eau du robinet, 11) une rivière poissonneuse, 12) une forêt, 13) un palmier dattier, 14) une rizière, 15) un verger, 16) de l'air pur .17) une romantique histoire d'amour qui finit bien, 18) un rêve 19) l'amitié, 20) l'entraide
Travail à faire:
- classer les éléments ci-dessus en tenant compte des besoins satisfaits et des modalités de satisfaction, pensez à justifier votre choix; (pour gagner du temps vous pouvez vous servir du numéro du bien).
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
tracteurs, modèle A |
100 |
125 |
150 |
165 |
|
tracteurs, modèle B |
40 |
60 |
90 |
135 |
|
production totale |
|
|
|
|
Travail à faire : calculer :
a) pour chaque année, la production totale et le poids relatif de chaque fabrication dans le total
b) la production totale moyenne annuelle.
c) la variation (en % d'une année par rapport à la précédente) de la production totale, de la production de tracteur A et de la production de tracteurs B.
♦ LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE : rappel et suite... |
La première représentation de l'économie sous forme de circuit a été donnée en 1758 par François Quesnay dans son Tableau économique des physiocrates. Cette représentation s'est révélée féconde. En décrivant les échanges entre ces trois classes ou agents sous la forme d'un tableau économique, Quesnay préfigure le tableau d'entrées-sorties (TES, voir étape 2) de notre comptabilité nationale, qui repose sur le principe de l'équilibre entre les flux de richesses qui entrent dans les comptes de chaque agent et les flux qui en ressortent.
Cette approche de l'économie adopte donc une vision globale ; elle regroupe l'ensemble des agents économiques selon leurs fonctions, en trois "classes", entre lesquelles circule le produit net. On dirait aujourd'hui qu'elle adopte une approche macro-économique, par opposition à l'approche micro-économique :
L'approche micro-économique (du grec micros petit), étudie le comportement individuel d'unités économiques élémentaires : par exemple, pourquoi un ménage choisit d'épargner telle proportion de son revenu, ou comment une entreprise maximise ses bénéfices, prend la décision d'investir, etc.
Les économistes libéraux (école néoclassique) ont construit un modèle abstrait d'individu : l' "homo oeconomicus". Par hypothèse, ses actes sont toujours guidés par des motivations utilitaristes et son comportement est rationnel. Cet individu maximise son bien-être compte tenu des contraintes qui pèsent sur lui (le consommateur maximise sa satisfaction, le producteur maximise son profit). Cette approche présuppose que l'analyse globale de la réalité économique découle de l'addition des actions individuelles.
L'approche macro-économique ( du grec macros grand), étudie les phénomènes économiques dans leur globalité en regroupant les agents individuels en catégories (les secteurs institutionnels), en additionnant les opérations élémentaires en grands agrégats (ex. : le PIB, le revenu national...) et en cherchant à établir des relations entre eux.
Les économistes keynésiens construisent des grandeurs agrégées et observent leurs interactions au niveau de l'économie dans son ensemble. Cette approche (par le circuit économique) accorde une spécificité, une autonomie à la réalité étudiée par rapport aux individus qui y participent. "L'analyse macro-économique consiste à étudier les aspects généraux de la forêt indépendamment des arbres qui la composent."[11]
Pour représenter le fonctionnement de l'économie sous forme de circuit il faut identifier les flux de richesses, réels ou monétaires, qui circulent entre les secteurs institutionnels. La notion de flux s'oppose à celle de stock :
Un flux est un mouvement de biens et de services ou de monnaie qui a lieu pendant une période délimitée.
Un stock correspond à l'accumulation de biens et de services ou de monnaie, créances et dettes sur plusieurs périodes de temps.
Flux réel : mesure la quantité de biens et de services échangée entre des agents à l'occasion d'une opération et pendant une période déterminée.
Flux monétaire : mesure la quantité de monnaie échangée entre des agents à l'occasion d'une opération et pendant une période déterminée.
Pour représenter les flux réels ou monétaires qui circulent entre les agents, il est commode d'utiliser la notion de marché :
· Un marché, au sens le plus général, est le lieu (réel ou fictif) de rencontre entre des offres et des demandes et où se déterminent les prix des produits échangés.
· L'offre correspond à la vente (de biens et de services, ou d'actifs financiers : actions, obligations...) ; certains préciseront qu'il s'agit de la quantité que les entreprises sont prêtes à vendre à un prix fixé.
· La demande correspond à un achat (de biens et de services, ou d'actifs financiers) ; certains préciseront qu'il s'agit de la quantité que les ménages sont prêts à acquérir à un prix fixé.
Il s'agit d'une représentation en partie fictive, dans la mesure où, d'une part la rencontre entre l'offre et la demande ne se situe pas toujours sur un lieu déterminé : ainsi de la vente par correspondance ou de l'offre et la demande d'emplois par petites annonces. D'autre part, deux agents peuvent entrer directement en relation sans passer réellement par le marché : par exemple la vente directe du producteur au consommateur ; une commande passée entre un client et son fournisseur, etc.
Le marché des biens de consommation permet la rencontre :
· d'un flux réel de biens mis à la disposition des ménages (l'offre) par les entreprises qui les ont produits ;
· d'un flux monétaire correspondant aux paiements des biens consommés par les ménages.
On voit dans le schéma de base que les flux réels et les flux monétaires circulent en sens inverse.
Partant d'une représentation très simplifiée du circuit à deux agents (les ménages et les entreprises), on l'enrichit en introduisant successivement les autres agents et plusieurs opérations que nous avons définies précédemment. Toutefois, la sphère non marchande sera exclue de cette représentation pour la raison dont il a été parlé plus haut : on ne peut identifier à quels agents spécifiques profite la production de services non marchands. De même, la vente directe du producteur au consommateur n'est pas représentée.
Ce premier circuit représente la double circulation des flux réels et des flux monétaires entre ces agents :
· au travail (flux réels) correspond les revenus versés en contrepartie par les entreprises (flux monétaires) ;
· la production (flux réels) offerte par les sociétés correspond les ventes (flux monétaires) des entreprises sur le marché des biens de consommation ;
· la consommation de biens et de services (flux réels) correspondent les achats des ménages (flux monétaires).
Le terme d'entreprises rassemble, à la différence de la comptabilité nationale, les sociétés et les entrepreneurs individuels. Les entreprises, par l'intermédiaire du marché de biens de production (capital fixe et capital circulant), effectuent les investissements et les achats de consommations intermédiaires. Le flux monétaire correspondant est intégré aux ventes de la production (tous biens confondus).
Voir ci-avant
On ne décrit que les investissements et les opérations de redistribution des administrations.
Voir ci-avant
Il s'agit d'une représentation simplifiée de la fonction d'intermédiaires financiers des institutions financières :
n elles collectent l'épargne (on ne représente que celle des ménages) ;
n elles accordent des crédits aux différents agents.
Pour le reste du monde, les importations et les exportations transitent par les marchés. On remarque que le flux monétaire des importations va des marchés nationaux vers le reste du monde : il correspond au paiement de nos importations ; et inversement pour le flux monétaire des exportations.
Voir ci-avant
D'après le schéma économique (à marché unique des biens et services), la production est un flux réel qui part de l'agent "Entreprises" pour aboutir sur le "marché des b&s". Cette production est ventilée par trois emplois (ou 3 types de demande) réels qui partent du "marché des b&s", à savoir
(1) la consommation de biens et services par les ménages,
(2) l'investissement des entreprises [=achats de biens de production] et
(3) la demande publique [= achats des administrations].
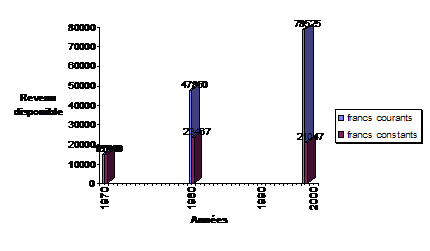
Cette égalité met en évidence les flux réels, c'est-à-dire les opérations sur les biens et services échangés. Il apparaît un équilibre entre la production (=ressources) et la somme des consommations finales et intermédiaires des autres acteurs (=emplois), autrement dit entre l'offre et la demande.
Si l'on considère l'ensemble des opérations sur biens et services, l'équilibre se notera :
Production
+ importations
=
Consommation finale des ménages
+ demande publique
+ consommation intermédiaire des entreprises
+ investissements et variation de stocks (+-)
+ exportations
Une des formules de base de la comptabilité nationale
D'après les flux monétaires du schéma économique (à marché unique des biens et services), les revenus de la production sont un flux financier qui aboutit à l'agent "Ménages"venant (indirectement) du "marché des facteurs", via le paiement des salaires et le paiement de dividendes. À ces revenus de la production s'ajoutent les revenus de transfert. Ces revenus sont ventilés par trois emplois monétaires qui partent de l'agent "Ménages", à savoir (1) les dépenses de consommation de biens et services par les ménages, (2) l'épargne et (3) les impôts. D'où l'égalité :
Revenu de la production
+ revenus de transfert
=
Dépenses de consommation finale des ménages
+ épargne des ménages
+ impôts
Remarquons que l'on parle de revenu disponible comme somme du revenu de la production et de transfert, dont on retire les impôts (et retenues sociales).
Une autre des formules de base de la comptabilité nationale. À partir des ces 2 égalités, dont l'une est construite sur les flux réels et l'autre sur les flux monétaires, on devrait pouvoir conclure :
Production
=
Revenus des ménages
et
investissements
=
épargne
Une troisième des formules de base de la comptabilité nationale.
Compte tenu de l'équilibre global du circuit économique, il apparaît nettement, que, si un agent a des emplois supérieurs à ses ressources, il devra se mettre en relation avec un autre agent dont les ressources excèdent les emplois. Par le jeu des opérations financières, les comptes de chaque agent (à capacité ou à besoin de financement) s'équilibreront :
|
"Ménages" |
|
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
Consommation
Épargne
Impôts |
Salaires versés par les "entreprises"
Revenus de transfert |
|
Les ménages disposent généralement de capacité de financement placée auprès des banques ou directement sur le marché financier |
|
|
"Entreprises" |
|
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
Salaires et dividendes versés aux "ménages" |
Production |
|
Les entreprises disposent rarement de capacité de financement ; elles ont généralement un besoin de financement, en raison de leurs efforts d'investissement. Elles l'obtiennent auprès des banques ou directement sur le marché financier. Ces dernières années, elles disposent de capacité de financement |
|
|
Administrations publiques |
|
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|
Achats publics
Transferts |
Impôts |
|
Les administrations publiques ont généralement un grand besoin de financement, en raison de leurs déficits budgétaires et des difficultés financières des organismes de sécurité sociale. Elles l'obtiennent auprès des banques, des "ménages"(emprunts ou bons d'État) ou directement sur le marché financier |
|
Ces notions seront abordées plus en détail dans l'étape 3.
L'intérêt du circuit économique est de mettre en évidence l'interdépendance des agents et des opérations : toute modification en un point du circuit se répercute sur l'ensemble des autres. Cela permet d'effectuer des prévisions économiques sur les conséquences d'un événement (ou "choc") important.
Mais ces prévisions ne seront fiables qu'à deux conditions :
· que l'on parvienne à chiffrer chaque opération : la suite montrera comment la comptabilité nationale y parvient ;
· que l'on connaisse assez bien les mécanismes de fonctionnement de notre économie, pour prévoir les réactions des agents : c'est l'objet de toute l'analyse économique...
Dans ce cas, si la baisse est significative et rapide, les économistes parlent d'un "choc de la demande". Comment les différents agents en sont-ils affectés ?
1. La baisse de la consommation des ménages se répercute sur les ventes des entreprises, qui, si elles l'anticipent comme durable, vont réduire leur production.
2. Une partie des travailleurs risque donc d'être licenciée ou mise au chômage technique. Il s'ensuit une réduction de la masse des revenus versés par les entreprises aux ménages.
3. L'économie peut alors être dans le cercle vicieux de la crise : la consommation connaissant une nouvelle baisse, etc. C'est exactement la prévision que fit l'économiste anglais Keynes lors de la crise de 1929 (v. plus loin).
4. Les administrations sont également affectées ; elles subissent une diminution des prélèvements obligatoires : les rentrées de TVA se réduisent proportionnellement à la baisse des achats des ménages. Il en va de même des impôts sur le revenu. Mais elles peuvent compenser cette perte de recettes par l'émission d'un emprunt public souscrit grâce à l'abondance de l'épargne.
5. Une partie de la consommation (un tiers des biens manufacturés) provient des importations. Celles-ci diminuent et notre commerce extérieur peut connaître un excédent (exportations >importations) avec le reste du monde.
|
Figure 15 : Choc de la demande et conséquences... |
Au total, on voit dans le schéma ci-dessus que les conséquences sont fort complexes et parfois contradictoires. Le circuit permet seulement d'envisager plusieurs scénarios possibles. Le cas le plus fréquent est le premier, celui où les rendements d'échelle sont croissants. Les entreprises sont donc incitées à grandir, c'est la cause principale de leur concentration.
|
Figure 16 : Circuit économique : variante |
♦ À retenir |
Besoins : sensation d'un manque, envie désagréable, qui génère le souhait d'un "mieux-être".
Besoins primaires (physiologiques ou élémentaires) : leur satisfaction est essentielle à la survie, ils ont une origine biologique.
Besoins secondaires (psychosociologiques) : leur satisfaction n'est pas vitale, mais apporte un mieux-être.
Besoins dérivés : manière dont toute société traduit les besoins élémentaires de l'être humain.
Biens : toutes choses (matérielles ou immatérielles) susceptibles de faire disparaître un besoin.
Biens matériels : toutes choses matérielles ou susceptibles de faire disparaître un besoin.
Services : toutes choses immatérielles susceptibles de faire disparaître un besoin.
Origine sociale des besoins : nos besoins dépendent de notre éducation familiale, du groupe social, ou du pays auquel nous appartenons.
La rareté d'un bien est l'écart entre la quantité disponible de ce bien (nos ressources) et la quantité dont nous avons besoin.
Le travail désigne, dans les sociétés industrielles, une activité humaine rémunérée, qui donne lieu à une contrepartie en monnaie ou en nature ; il permet la transformation des ressources naturelles en produits dont la consommation répondra à nos besoins. La plupart des produits que nous consommons n'existent pas tels quels, ni en abondance dans la nature : le travail a donc pour objet de lutter contre leur rareté.
Division du travail : chaque travailleur se spécialise dans une tâche précise, par exemple : artisan, agriculteur, guérisseur ou médecin.
Échange : en cas de division du travail nous devons, pour répondre à nos besoins, échanger le produit de notre travail contre celui des autres.
Le troc est un échange sans monnaie, travail contre travail. L'échange monétaire : la monnaie sert d'intermédiaire dans l'échange qui devient une opération d'achat et de vente.
Société traditionnelle : on peut les caractériser sur un plan technique, par le fait qu'elles utilisent des méthodes de production préindustrielles ; sur un plan social, elles semblent soumises à la "tradition", ensemble de règles immuables (ou ne changeant que superficiellement).
La rareté, comme l'abondance, sont des notions relatives :
- les sociétés traditionnelles ont peu de ressources et de biens ;
- mais elles ont aussi peu de besoins, et beaucoup de temps libre.
Les ménages : ils sont constitués d’une ou plusieurs personnes qui partagent la même résidence principale.
Les entreprises : ce sont les unités de production qui produisent des biens et services marchands.
Les administrations publiques : comprennent l’état et les collectivités locales, qui financent les transferts sociaux par la redistribution et produisent des biens et services collectifs ou non marchands.
Les institutions financières : collectent, l’épargne et fournissent du crédit.
Marché : c’est le lieu où se rencontrent l’offre (la production, les ventes ) et la demande (les achats).
Ménage : entité qui comprend une ou plusieurs personnes, n’ayant pas forcément de lien de parenté, occupant la même résidence principale.
Famille :partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple et le cas échéant de ses enfants célibataires de moins de 25 ans, soit d’un parent isolé et de ses enfants célibataires de moins de 25 ans.
La production (au sens large) : est la création de biens et des services afin de satisfaire des besoins.
La production : est l’activité économique socialement organisée consistant à crée des biens et des services s’échangeant sur le marché et/ou obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant sur le marché.
Le flux : est un mouvement de biens et de services ou de monnaie qui a lieu pendant une période déterminée.
L’offre : correspond à la vente (de biens et de services, ou d’actifs financiers : actions, obligations,..) ; certains préciseront qu’il s’agit de la quantité que les entreprises sont prêtes à vendre à un prix fixé.
La demande : correspond à l’achat (de biens et de services, ou d’actifs financiers) ; certains préciseront qu’il s’agit de la quantité que les ménages sont prêts à acquérir à un prix fixé.
Exportations : ce sont les ventes au reste du monde de biens et services produits sur le territoire national.
Importations : ce sont les achats de biens et de services en provenance du reste du monde.
Revenus des ménages : ce sont les ressources principales des ménages qui proviennent des revenus d’activité (Pour les salariés ou les entrepreneurs individuels) et de revenus de transferts.
Économie :a l’origine le mot économie signifie, administration de la maison (l’origine est grecque : oikos veut dire maison et nomos, règle). Mais le sens de ce mot a évolué et s’applique à des groupes humains plus importants comme une nation. Un des objectifs de l’économie est donc de traiter le problème (et la manière dont l’homme va procéder pour le résoudre) des besoins nombreux face à des biens limités.
Sociétés industrielles : (selon Raymond Aron), au début du XIXe siècle :
- au lieu d'être organisée selon la coutume, la production est agencée en vue du rendement maximum ;
- l'application de la science à l'organisation du travail permet un prodigieux développement des ressources ;
- des masses ouvrières sont concentrées dans les agglomérations urbaines ;
- il y a opposition latente ou bien ouverte entre les employés et les employeurs ;
- la multiplication des crises de surproduction crée la pauvreté au milieu de l'abondance ;
- le système économique repose sur la liberté des échanges et la recherche du profit de la part des entrepreneurs et des commerçants ;
Loi de l'offre et de la demande : les prix varient en fonction des quantités offertes et demandées :
- si demande >offre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hausse du prix du produit
(rareté, pénurie)
- si demande <offre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ baisse du prix du produit
(abondance, surproduction)
On distingue cinq/sept catégories d'agents économiques ou secteurs institutionnels, selon leur fonction et leurs ressources principales : les ménages, les entreprises, les institutions financières, les administrations publiques et privées et le reste du monde ;
les administrations privées, les entreprises d'assurances.
Balance commerciale : document qui comptabilise l'ensemble des exportations et des importations. Il y a :
+ déficit de la balance si les importations sont supérieures aux exportations ;
+ excédent de la balance si les exportations sont supérieures aux importations.
♦ E X E R C I C E S et > T R A V A U X |
I. Les bonnes manières enseignées aux enfants (1521)
À droite le gobelet et le couteau, à gauche le pain.
Beaucoup étendent aussitôt assis. les mains vers les plats. C'est ainsi que font les loups.
Ne plonge pas le premier les mains dans le plat que l'on vient de servir : on te prendra pour un goinfre et c'est dangereux. Car celui qui fourre, sans penser quelque chose de trop chaud dans la bouche, doit le recracher ou se brûler le palais en avalant. Tu susciteras les rires ou la pitié. [...]
C'est d'un paysan que de plonger les doigts dans la sauce. On prend ce qu'on désire avec le couteau et la fourchette sans fouiller le plat tout entier comme font les gourmets, en s'emparant du morceau le plus près de soi. [...]
Il est discourtois de lécher ses doigts graisseux ou de les nettoyer à l'aide de sa veste. Il vaut mieux se servir de la nappe ou de la serviette.
II. Repas au Moyen-Âge
|
Figure 17 : bon appétit... et bonnes fourchettes |
III. Usage de la fourchette
Au XIe siècle, un doge vénitien épousa une princesse grecque. Dans les milieux byzantins auxquels elle appartenait on se servait, de toute évidence, de fourchettes. Nous apprenons en effet que la princesse portait sa nourriture à la bouche "au moyen de petites fourches en or et à deux dents".
Ce fait provoqua à Venise un éclat sans précédent. Peu après, elle était atteinte d'une maladie repoussante et saint Bonaventure n'hésita pas à déclarer que c'était un châtiment de Dieu.
Il a fallu attendre cinq cents ans pour que la structure des rapports humains se modifiât de telle manière qu'on ressentait le besoin général de cet instrument. [...]
Il est fort probable qu'au début ils étaient peu habitués au nouvel instrument. Les gens racontaient en effet que la moitié de la nourriture tombait de la fourchette "entre le plat et la bouche". [...]
Ce que nous considérons comme une coutume naturelle parce que nous y sommes habitués et conditionnés depuis notre plus tendre enfance ne fut accepté et acclimaté que lentement et péniblement par la société.
IV. Pourquoi une fourchette
La première réponse qui se présente à l'esprit est celle-ci : parce que manger avec les doigts est peu hygiénique.
Mais cette explication est boiteuse : nous n'avons plus l'habitude de manger avec d'autres dans le même plat. Chacun porte à sa bouche ce qui se trouve dans son assiette personnelle. Y puiser la nourriture avec les doigts ne saurait être moins hygiénique que de manger avec la main du gâteau du pain ou du chocolat.
Pourquoi faut-il donc une fourchette ? Pourquoi est-il "barbare et peu civilisé"de prendre avec les doigts ce qui se trouve dans son assiette personnelle ?
Parce que nous éprouvons un sentiment de malaise quand nous salissons nos doigts ou du moins quand on nous aperçoit en société avec des mains crasseuses ou graisseuses. [...]
I. Que nous apprend le document I sur la façon de manger au XVIe siècle ?
II. Pour quelles raisons l'usage de la fourchette s'est-il répandu si lentement (doc. "Usage de la fourchette") ?
III. Recherchez dans le cours les définitions de :
a) Besoins primaires : ........
b) Besoins secondaires : ........
IV. Complétez la phrase suivante : La fourchette répond, dans notre société à un besoin _ _ _ _ _ _ _ _ , dérivé du besoin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de se nourrir.
V. Comment l'auteur démontre-t-il que le besoin de fourchette a une origine sociale ?
VI. Recherchez d'autres exemples de besoins d'origine nettement sociale.
Une certaine conception du monde place dans le passé l'âge d'or de l'humanité. Tout aurait été donné gratuitement à l'homme dans le paradis terrestre et même après la sortie de ce paradis et tout serait au contraire pénible et vicié de nos jours. [...]
En réalité, tous les progrès actuels de l'histoire et de la préhistoire confirment que la nature naturelle est une dure marâtre pour l'humanité. Le lait "naturel"des vaches "naturelles"donne la tuberculose, et la vie "saine"d'autrefois faisait mourir un enfant sur trois avant son premier anniversaire. Et des deux qui restaient, dans les classes pauvres, un seul dépassait, en France encore et vers 1800, l'âge de 25 ans.
Toutes les choses que nous consommons sont en effet des créations du travail humain, et même ceux que nous jugeons en général les plus "naturels"comme le blé, les pommes de terre ou les fruits. Le blé a été créé par une lente sélection de certaines graminées : il est si peu "naturel"que si nous le livrons à la concurrence de vraies plantes naturelles, il est immédiatement battu et chassé. Si l'humanité disparaissait de la surface du globe terrestre, le blé disparaîtrait moins d'un quart de siècle plus tard. Il en serait de même de toutes nos plantes "cultivées", de nos arbres fruitiers et de nos bêtes de boucherie.
À plus forte raison, les objets manufacturés, des textiles au papier et des montres aux postes de radio, sont des produits artificiels, créés par le seul travail de l'homme. [...]
Qu'en conclure sinon que l'homme est un être vivant étrange, dont les besoins sont en total désaccord avec la planète où il vit ? Pour le bien comprendre, il faut d'abord comparer l'homme aux animaux, et même aux plus évolués dans la hiérarchie biologique : un mammifère, cheval, chien ou chat, peut se satisfaire des seuls produits naturels : un chat qui a faim ne met rien au-dessus d'une souris, un chien rien au-dessus d'un lièvre, et un cheval, rien au-dessus de l'herbe. Et dès qu'ils sont rassasiés de nourriture, aucun d'eux ne cherchera à se procurer un vêtement, une montre, une pipe ou un poste de radio. L'homme seul a des besoins non naturels.
Et ces besoins sont immenses. Imaginons ce que devrait être le globe terrestre pour que l'homme y trouve, par croît naturel, tous les types de produits qu'il désire consommer : non seulement il faudrait que le blé, les pêchers et les vaches grasses y prospèrent sans soin ; mais il faudrait que des maisons y poussent et s'y reproduisent comme des arbres, avec chauffage central et salle de bain ; et qu'à chaque printemps, des postes de télévision arrivent à maturité sur d'étranges légumes... [...]
L'oxygène est le seul produit naturel qui satisfasse entièrement et parfaitement l'un des besoins de l'homme. Pour que l'humanité puisse subsister sans travail, il faudrait donc que la nature donne à l'homme tout ce dont il éprouve le besoin comme elle lui donne l'oxygène. (l'eau, il faut déjà la puiser, la pomper et souvent la filtrer) [...]
Cela étant, nous voyons bien pourquoi nous travaillons : nous travaillons pour transformer la nature naturelle qui satisfait mal ou pas du tout les besoins humains, en éléments artificiels qui satisfassent ces besoins ; nous travaillons pour transformer l'herbe folle en blé puis en pain ; les merises en cerises et les cailloux en acier puis en automobiles. [...]
La science économique est celle qui a pour objet la production, la consommation et l'échange de biens ou de services rares.
Autrement dit encore, la science économique a pour objet l'étude des moyens qui permettent à l'humanité d'aménager et de réduire le rationnement qui résulte pour elle du fait que ses aspirations, ses besoins et ses désirs dépassent de beaucoup les fruits naturels de la terre où elle vit.
I. Vérifiez en vous aidant du contexte, le sens de :
- âge d'or de l'humanité - marâtre
- produits artificiels - rationnement.
II. Expliquez :
- la nature naturelle est une dure marâtre pour l'humanité
- les objets manufacturés [...] sont des produits artificiels
- l'homme seul a des besoins non naturels
III. De quoi s'agit-il ? Quelle est la source ?
IV. "Découpez"le texte en 4 ou 5 grands paragraphes marqués A, B, C, D, (E), qui contiennent chacun une idée que vous soulignerez dans le texte. Pour cela, distinguez l'idée principale des idées secondaires (ou des exemples) qui s'y rattachent. De quelle idée principale dépend l'exemple : "si l'humanité disparaissait [...] le blé disparaîtrait moins d'un quart de siècle après ?
V. Faites sur votre classeur (cahier) le plan du texte :
- résumez chaque idée principale : A. B. etc. (une phrase par idée) ;
- pour chacune, choisissez un exemple donné par l'auteur.
VI. Mettez les phrases suivantes dans un ordre logique :
- Nous travaillons pour transformer la nature
- L'homme seul a des besoins non naturels
- La science économique étudie comment réduire le rationnement
- La nature ne fournit pas directement ce dont l'homme a besoin
VII. Retrouvez dans le texte les 4 éléments de la définition des sciences économiques (voir cours).
VIII. Y a-t-il dans ce texte, une affirmation avec laquelle vous êtes en désaccord ? Expliquez pourquoi.
I. Vie quotidienne des Yanomani
Mais regardons vivre Hoashiwe pendant une journée, dans ses travaux, ses loisirs et sa vie familiale. La vie du shabono y sera perçue à travers lui. Qu'on y prenne garde cependant, Hoashiwe [...] est plus actif que la moyenne des Yanomani.
À l'intérieur du shabono - vaste auvent circulaire - chaque groupe lignager (NDLR : ensemble des descendants d'un même ancêtre) occupe un espace déterminé. Il en est de même des familles, placées à l'intérieur de leur lignage sous la portion de l'auvent construite par elle-même. Les adolescents s'en vont tendre leur hamac à quelque distance du foyer paternel, mais continuent à recevoir du bois de chauffage et des aliments de leur mère.
5h 30 - Il est cinq heures trente. Hoashiwe s'éveille. Dans l'obscurité, Mabroma (NDLR : femme d'Hoashiwe) file déjà du coton, sa petite-fille blottie contre elle. Il dit qu'il vient de rêver, et il raconte son rêve à sa femme [...].
6h 30 - Il fait grand jour, mais tout est encore calme dans l'auvent. Hier. des chasseurs sont revenus d'une courte expédition, il y a de la viande et on se laisse aller. Hoashiwe se souvient qu'il lui manque une pointe osseuse pour fixer à l'une de ses flèches. Il affûte son couteau, essaie le tranchant sur une bûche [...].
|
Figure 18 : territoire des Yanomani |
9h Il est neuf heures lorsque Hoashiwe empoigne sa machette et se dirige vers le jardin. Il travaille peu et sans entrain ; repique deux plants de bananier, inspecte une plantation nouvelle. Il place des tuteurs sous des bananiers, arrache des herbes puis s'assoie, indécis, sur un tronc calciné. À peine plus de vingt minutes se sont écoulées lorsqu'il revient [...].
Les produits tirés de l'agriculture représente 60% en poids, de la totalité des aliments consommés. Pourtant cette activité est peu favorisée si on la compare à la ferveur avec laquelle s'accomplit la chasse, et à l'enthousiasme avec lequel un chasseur narre les moindres incidents de son expédition [...]. Les Indiens sont des usagers, ce ne sont pas des possédants de la forêt qui environne l'habitation, ils tirent les produits nécessaires à la technologie et à l'alimentation. Comme pour la construction de l'auvent communautaire, le choix d'un site pour le jardin dépend uniquement d'un consensus [...]. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait eu des querelles au sujet de la répartition de l'économie.
11h - Onze heures. Mabroma est allée filer du coton dans la proche forêt pour échapper à la chaleur accablante et au tourment des phlébotomes (NDLR : insectes). Hoashiwe s'ennuie. Il passe d`un hamac à l'autre, comme s'il voulait tous les essayer [...]
12 h - Le soleil est au zénith. Hoashiwe sommeille [...]
À l'aide d'un miroir, Hébewe et Krémoanawe (NDLR : les fils de Hoashiwe) s'oignent le visage et le corps à l'urucu. Les lignes, droites ou sinusoïdales, encadrent les traits dans une belle harmonie de formes et de couleurs, tandis que le corps, fascié à l'ocre, se meut avec élégance. Complétant leur parure, ils ceignent un cache-sexe rouge sang et se passent des brassards noirs où pendant des plumes bigarrées. Des chamanes (NDLR : guérisseur, sorcier) curent des malades, leurs parents [...].
17h - Il est dix-sept heures passées. Mabroma dit à Hébewe qu'il ferait bien d'aller chasser la perdrix. Celui-ci répond qu'il n'a pas envie et que d'ailleurs, la viande ne manque pas. Son père sera tout autant rembarré quand, un moment après, il demandera à son fils d'aller chercher de l'eau. Hébewe lui répondra le sempiternel : "Je ne suis déjà entrain de me curer les dents!"prononcé chaque fois qu'on refuse un service. Le tonnerre gronde, et brusquement, l'orage est là. Hoashiwe lâche le morceau de viande qu'il grignote pour aller repousser les esprits dont la tourmente est la manifestation. Debout devant son foyer, il fait du bras un geste large et, de concert avec les autres chamanes qui joignent leurs efforts, crie : "wau! wau!"Son devoir accompli, il s'en retourne poursuivre son repas [...]
18h - Comme la nuit va venir, Hoashiwe et sa femme s'en vont en canot chercher du bois qu'ils ont laissé le matin de l'autre côté de la rive. C'est Mabroma qui transporte les grosses bûches du canot jusqu'à chez elle ; quand elle a fini, elle bouche le passage pour empêcher les revenants de pénétrer la nuit à l'intérieur de l'auvent.
II. Situation actuelle des Yanomani
Les Yanomani ont été longtemps isolés, ce qui assurait leur survie. Vivant dans une région difficilement accessible à cheval sur deux pays, leur population s'était maintenue à un chiffre enviable, 22 000 individus, dont environ 9 000 au Brésil : aucune autre nation indigène n'est aussi nombreuse. Dans tout le territoire brésilien, il n'y a guère plus de 200 000 Indiens, alors qu'ils étaient plusieurs millions au temps de la conquête.
C. Vanhecke, Le Monde, 12 janvier 1990.
III. Contacts avec l’Occident
Au milieu des années soixante-dix, Jacques Lizot décrit un procédé plus sophistiqué : "l'assujettissement économique des Indiens par la création de besoins nouveaux que seuls les Blancs sont en état de satisfaire _
Des Indiens se mirent au service des Blancs, brisant le cycle traditionnel de réciprocité de l'échange. Des guenilles, des vieilles boîtes, des morceaux de plastique commencèrent à joncher le terre-plein des Shabono aux abords des missions. Une différence commença à s'établir entre les communautés Yanomani en contact avec les blancs et les autres. [...]
Changement rapide : "Pour des objets convoités, pour faire plaisir, par facilité, par honte d'être ce qu'ils sont. les Yanomani réduisent leurs sorties nomadisantes, auxquelles les enfants et les adolescents participent de moins en moins. On a le sentiment qu'ils sont en attente perpétuelle d'on ne sait quoi : le bruit d'un moteur, la visite impromptue d'un touriste qui distribuera quelques pacotilles et des cigarettes pour pouvoir photographier et toucher à tout. Alors, puisque les Indiens vont plus rarement camper dans la forêt, il y a moins à manger."
IV. Le prestige : donner
Le prestige, c'est de donner, de donner beaucoup et de donner partout. C'est à l'envers du monde capitaliste ! Ici on dit qu'on apprend aux enfants à économiser, à entasser. puis quand on a quelques économies, il faut trouver des systèmes qui rentabilisent cette économie. Après, on dit qu'on a des briques si on a un million. Plus on a de briques, plus on monte, plus on est grand. [...]
Dans notre système, si vous faites cela... vous devenez petit, parce que vous n'avez pas de relations. Vous êtes obligé de vous couper de la communauté. [...]
S'il y a une "coutume"c'est-à-dire un rassemblement où les gens portent leurs dons, les gens regardent : "il n'a apporté que ça !". Et les gens repèrent tout de suite. Parce que, dans l'année, il y a beaucoup de coutumes. La dernière fois, un de mes oncles qui est célibataire, manquait au rassemblement. Et mon vieil oncle, qui fait les ignames, nous dit : "Qui est-ce qui n'est pas là encore ?"-"Il y a un tel."- "Oh! mais ce n'est pas la peine, parce que lui, il apporte toujours 100 F et un kilo de sucre. Alors ce n'est pas la peine de l'attendre, on sait a priori ce qu'il va apporter !"
J-M Tjibaou, "Être mélanésien aujourd'hui", Esprit, sept.81
Jean-Marie Tjibaou, leader du FLNKS (front de libération nationale des Kanaks socialistes) jusqu'à son assassinat en 1989, décrit certains aspects de la vie quotidienne des Kanaks, groupe ethnique autochtone de la Nouvelle-Calédonie.
V. La saison des ignames
Et nous avons en cette saison, la culture de l'igname qui rythme toute l'année. Je vous ai dit que juin. juillet, août, c'est la saison où il v a beaucoup d'ignames, la pleine récolte. C'est le moment où il n`y a plus de travail. c`est le moment où il y a beaucoup à manger parce qu'il y a des ignames, il y a des taros, c`est la pleine saison des récoltes. Alors c'est la saison où l'on va faire les célébrations, on va faire les mariages, on va faire les "grands deuils". [...]
Et cela, je pense que c'est la différence fondamentale entre les ruraux qui vivent à ce rythme-là, et puis les gens qui sont en ville, qui vivent au rythme de l'entreprise, avec des projets, avec des investissements qu'il faut rentabiliser. Il faut faire des projets, il faut faire des investissements, il faut calculer, etc. Et, quand on dit projets, il faut faire des calendriers, et quand on dit calendrier il faut dire : "Bien, le 15, il faut que j'en sois là par rapport au projet."Et si je ne suis pas là par rapport au projet, il faut que ... je cavale ! il faut que je fournisse un autre rythme pour être "dans le temps".
J-M Tjibaou, op.cit.
I. Reproduisez le tableau comparatif ci-dessous et notez-y les différences entre la société Yanomani et la nôtre en ce qui concerne :
- Rareté (ressources)
- Satisfaction des besoins
- Division du travail
- Emploi du temps
- Notion du travail et des loisirs
- Propriété
II. Pourquoi ce type de société peut-il être qualifié de "société d'abondance" ?
III. En quoi le contact avec les Occidentaux menace-t-il Le mode de vie des Yanomani ?
IV. Pourquoi chez les Kanaks est-il si important de donner? Qu'en conclure sur la répartition des ressources ?
V. Comment Jean-Marie Tjibaou explique-t-il les différences de rythme de vie entre sa communauté et la nôtre ?
I. Porteurs d'eau au XIXe siècle
"Il y avait plusieurs points d'eau classiques. Dans les grandes villes, on prélevait une partie de l'eau directement dans les fleuves. La Tamise avait beau être noire comme de l'encre, on y puisait tout de même au gré des besoins. "Les fontaines publiques étaient l'autre grand point d'approvisionnement. Dans toute 1'Europe, elles étaient un lieu de vie et de sociabilité essentiel. "À Paris, on faisait la queue devant la célèbre fontaine de la Samaritaine, ou place Saint‑Sulpice. Mais la fontaine la plus réputée était celle de Passy ; l'eau surgissait naturellement du sous‑sol et sa qualité était supérieure à la moyenne croyait on. "Mais, "hormis les fontaines publiques, il n'y avait pas d'eau gratuite, rappelle Jean‑Pierre Goubert. L'eau appartenait toujours à quelqu'un, au seigneur du lieu ".
"Au XIXe siècle, partout en Europe, explique‑t‑il, les besoins en eau étaient à peu près les mêmes. Une vingtaine de litres par personne et par jour, dont sept pour boire, cuisiner et entretenir son corps. Le reste était employé pour le ménage et les industries diverses. "À Paris, capitale européenne de L'eau et de l'assainissement, la demande progressa, d'une dizaine de litres à la veille de la Révolution à cent vingt litres en 1890.
Son prix, assez élevé, freina longtemps les progrès de l'hygiène. Un bain valait environ un franc, soit le tiers d'une journée de travail. "Un porteur d'eau chauffait l'eau sur la voie publique. Puis il la montait à l'étage, pour un prix proportionnel à la hauteur des escaliers. La baignoire, faite de toile pour éviter les échardes, était également louée. Bien entendu, on se baignait tout habillé. À la rigueur, on diluait de grosses quantités de sel dans l'eau pour ne pas voir son corps : la nudité était un péché. "Jusqu'à la domestication de l'eau, on se lavait peu. "Dans les milieux populaires, on était persuadé que la saleté protégeait des maladies. Quant aux couches plus évoluées, elles couvraient les mauvaises odeurs en s'aspergeant d'eau de Cologne, qui avait également pour vertu de tuer certains microbes. »
Hervé Deguine, "Sauver l'eau", Libération, numéro hors série, juin 1992.
II. Cycle de l’eau
|
Figure 19 circuit de l'eau... |
III. Eau du robinet, miracle permanent
Parce que L'homme avait soif, Dieu a sorti sa grande cornue pour bricoler quelques molécules d'hydrogène et d'oxygène et il a créé l'eau. C'était bien joué. Mais il n'a jamais pensé ni aux canalisations ni à la pression nécessaire pour faire monter le précieux liquide dans les immeubles, ni même au travail de purification et d'assainissement que les hommes ont été contraints d'entreprendre afin d'établir l'eau courante pour (presque) tous les Français, à toute heure du jour et de la nuit. Jusqu'à une époque récente, ce miracle permanent n'intéressait guère l'utilisateur, qui ne voyait pas plus loin que le bout de son robinet : l'eau, c'était transparent. À peine savait‑on qu'elle n'était pas gratuite.
François Lenglet. Science et Vie Économie, n° 66, novembre 1990.
IV. La galère du robinet
D'un grand geste circulaire. Mahmoud englobe les toits et les balcons. Les premiers sont envahis par les antennes qui permettent de capter les télévisions étrangères ‑"les paradiaboliques ", comme les appellent les islamistes ‑, les seconds abritent de gros cylindres gris. Le rêve et le casse‑tête. "La parabole pour l'évasion, résume‑t‑il, la citerne pour ne pas se laver éternellement au milieu de la nuit. "
Mahmoud habite le Telemli. un quartier central d'Alger. et il a décidé, il y a trois ans, d'en finir avec "la galère "du robinet désespérément sec seize à dix‑huit heures par jour, parfois plusieurs jours d'affilée.
"Hors citerne, raconte Mahmoud, c'est la débrouille et l'improvisation totale : les gosses qu'on réveille à six heures du matin pour profiter des derniers filets d'eau. le robinet qui s'assèche sans crier gare, les seaux qu'on va remplir chez un voisin complaisant ou, à l'intérieur du pays. à un point d'eau. les baignoires qu'on remplit pour avoir une réserve... et qu'on vide ensuite pour pouvoir les utiliser si l'eau revient, sans se rendre compte du gaspillage. »
Plaie d'une Algérie à la démographie galopante qui a trop longtemps négligé la construction de barrages, le manque d'eau ‑"au robinet ", précisent les experts ‑est source d'injustice sociale supplémentaire.
Et de révolte quand la rumeur rapporte qu'un "nouveau riche"vient encore de faire installer une piscine dans sa villa. Car, hors les quartiers très résidentiels, une distribution d'eau continue demeure, en Algérie, un luxe totalement inconnu. Sauf à avoir les moyens de faire installer les fameuses citernes qui, en se remplissant pendant les tranches horaires où l'eau est distribuée, évitent le robinet désespérément sec.
Si la fabrication locale des citernes permet de s'en procurer sans aucun problème, le prix est souvent prohibitif dans un pays où le salaire mensuel minimum ne dépasse pas 2 500 dinars (environ 625 FRF). Installation comprise, une petite citerne ‑300 litres ‑revient environ en effet à 10 000 dinars (2 500 FRF).
José Garçon, "Sauver l'eau ", Libération, n° h.s. juin 1992.
V. Croissance de la demande d'eau
Mais en réalité l'eau est une ressource rare. extrêmement rare dans certaines parties du monde. Et. au fur et à mesure que la population mondiale s'accroît. la demande en eau et donc son coût sont amenés à augmenter.
Aujourd'hui. l'eau utilisée pour l'agriculture représente environ deux tiers de la consommation totale dans le monde. Étant donné la croissance régulière de la population mondiale. il serait impensable de limiter la production alimentaire. L'irrigation constitue le principal moyen d'élever le niveau de la production agricole et c'est elle qui a contribué à lutter contre la faim dans le tiers monde, surtout en Asie. Et si en 1900 il v avait 40 millions d'hectares de terres arables irriguées, en 1980 on en comptait plus de 200 millions. Depuis. l'apparition de symptômes d'appauvrissement aquifère. conjuguée à une industrialisation et une urbanisation croissantes. a freiné l'expansion de l'irrigation.
Tout le monde sait que le manque d'eau est particulièrement dramatique dans de nombreuses régions d'Afrique où la combinaison d'un climat aride. de la sécheresse. de l'appauvrissement du sol et de la déforestation a aggravé l'état de malnutrition d'une population à croissance galopante.
Umberto Colombo. président de la Fondation européenne de la science à Rome. Libération. op. cit
VI. Lire une facture d'eau
VII. Le budget « eau des Français
Passer de 5 à 10, 20 ou 30 francs le mètre cube, quelle importance ? Le prix de l'eau ne soulève pas de polémique. Pour la bonne et simple raison que les Français ignorent son coût. La facture d'eau, 2 000 francs par an en moyenne pour une famille de quatre personnes, est noyée dans les charges des locataires. Quant aux propriétaires de maisons, ils trouvent l'addition plus légère que celle du gaz, de l'électricité ou du téléphone.
Première évidence, les Français ne sont pas égaux devant leur robinet. Il existe environ 13 000 ou 14 000 tarifs pour l'eau. [...] En Seine‑et‑Marne, les prix varient entre 1,40 francs et 22,80 francs ! De tels écarts sont plus justifiés entre 1'Alsace, où l'abondance de la nappe phréatique évite tout pompage dans le Rhin, et la Bretagne, qui cumule l'absence de nappe phréatique, la nécessité de transporter l'eau vers le littoral où est fixée la population, et une importante pollution d'origine agricole.
J.‑P. Coulange. Le Nouvel Économiste, n° 852, 3 juillet 1992.
VIII. Le rôle du maire
Aux termes de la loi, c'est le maire qui est responsable de l'approvisionnement en eau potable. Il gère les prélèvements, l'adduction, le réseau de distribution et son entretien, la facturation des abonnés. IL fixe le prix de l'eau sur le territoire de sa commune, les disparités d'une commune à l'autre étant expliquées par l'accès plus ou moins facile aux ressources.
Le maire a la possibilité de déléguer le service de l'eau à une société privée de son choix. Les communes françaises sont donc administrées soit en régie directe, lorsque la municipalité assume la gestion de l'eau elle‑même, soit en délégation de services, lorsqu'un partenaire privé intervient.
La plus importante des sociétés privées opérant dans le secteur est la Compagnie générale des Eaux, créée en 1853, qui possède plus de la moitié du marché français, et réalise un chiffre d'affaires de près de 100 milliards de francs dont le quart avec l'eau et l'assainissement. Viennent ensuite la Société lyonnaise des Eaux, qui possède 23 % du marché, et la Saur, rachetée par Bouygues en 1984, qui réalise quatre milliards de francs de chiffre d'affaires avec 13 % du marché, surtout en zone rurale.
F. Lenglet. Science et Vie Économie, n° 66. novembre 1990.
IX. Où vont nos dépenses en eau ?
X. Évolution du prix de l'eau
eau index index
Fran Fran Belg
1980 100 100 100
1984 152,5 151,5
1988 187,0 173,7
1989 194,2 180,2
1990 203,9 184,0
1992 212,2 194,4
XI. Pas encore de pénurie, mais...
Un produit rare est forcément cher. Mais la France n'est pas menacée expliquer la hausse du prix d'un produit. par la pénurie d'eau, même si elle a connu au cours des deux ou trois dernières années des "anomalies climatiques". Sur les 400 milliards de mètres cubes que fournissent chaque année les précipitations, 170 milliards sont utilisables en tant que ressources. Et 35 milliards sont consommés. Pour le refroidissement des centrales nucléaires, EDF en accapare 50 %. Et les 18 milliards de mètres cubes restant sont utilisés à parts égales par les industriels. l'agriculture et les particuliers. Seul souci des et 1992 ! gestionnaires : la consommation d'eau potable par les ménages continue d'augmenter, alors que les industriels ont plutôt restreint leurs prélèvements. "Pas de motif d'inquiétude, mais la marge de sécurité se réduit", commente M. Jean‑Pierre Tardieu, directeur de l'eau à la C.G.E.
J.‑P. Coulange. Le Nouvel Économiste. n° 852. 3 juillet 1992.
XII. L'eau va coûter beaucoup plus cher
Avant 1995, toutes les villes de plus de 15 000 habitants devront être équipées d'une station d'épuration, et celles de moins de 15 000 habitants avant 2005. Sachant qu'une installation d'épuration représente, suivant le niveau de pollution à traiter, au bas mot 2 000 francs d'investissement par habitant, le calcul est simple. L'installation de Colombes, dans les Hauts‑de‑Seine, reviendra à 2 milliards de francs pour une population concernée de 1 million d'habitants. Traduction dans la facture d'eau : jusqu'à 5 francs de plus par mètre cube. "Au cours du sixième programme d'équipement 1992‑1996, le prix moyen du mètre cube passera de 9 à 12 francs ", prévoit M. François Cellier, sous‑directeur de l'eau. [...]
Quoi qu'il en soit, le consommateur d'eau a devant lui des décennies d'augmentations prévisibles de sa facture. Après les pollutions carbonées d'origine, les pollutions azotées, la guerre est déclarée aux pesticides. [...] À la lutte contre les pollutions s'ajoutent d'énormes investissements
dits de sécurité. Des barrages et des réservoirs supplémentaires pour porter les capacités de stockage de l'agglomération parisienne à vingt quatre heures de consommation. [...]
Les collectivités locales prendront à leur charge 45 milliards de francs, et les six agences de l'eau, ex‑agences de bassin. subventionneront les ouvrages, à hauteur de 35 milliards sur la période 1992‑1996.
J.‑P. Coulange. op. cit.
I. Montrez que le besoin d'eau a une origine biologique et sociale.
II. L'eau était‑elle rare au XIXe siècle ? Pourquoi ? Était‑elle chère ? Pourquoi ?
III. $$$
IV. Quelle est la ritualisation de l'eau courante à Alger ? Comment peut‑on l'expliquer ?
V. L'eau est‑elle également répartie ? Quelles en sont les conséquences ?
VI. Après lecture du doc. "Croissance de la demande mondiale en eau", complétez le schéma ci‑dessous. Comment pourrait‑on réduire la rareté de l'eau dans les pays en développement ?
VII. Le budget "eau"moyen des ménages français vous paraît‑il important ? Le tarif diffère‑t‑il entre les communes, pourquoi ?
VIII. Quelles dépenses couvrent la facture d'eau ?
IX. Quel est le rôle des municipalités concernant l'eau potable ?
X. Reportez sur la grille ci‑contre les chiffres du document "Évolution du prix de l'eau".
XI. À l'aide de la fiche méthode n° 5, construisez une phrase avec les chiffres de l'année 1992. Que vous apprend le graphique ?$$$$
XII. Rappelez comment la "loi de l'offre et de la demande "peut expliquer la hausse des prix. Cette loi s'applique‑t‑elle à l'évolution du prix de l'eau entre 1980 et 1992 ?
XIII. Pour quelles raisons le prix de l'eau devra‑t‑il augmenter dans les années à venir ? Qui paiera ?
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(Devoir de 4 heures "type bac"dissertation s'appuyant sur un dossier n° 2)
(proposé par M.Ch.Pothin -Académie de Grenoble-)
Il vous est demandé :
? de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;
? de construire une argumentation à partir d'une problématique que vous devrez élaborer ;
? de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier ;
? de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties .
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.
Après avoir montré que l'eau, en France, devient un bien rare, vous vous demanderez si ce bien vital peut obéir à une logique marchande
Document 1
Pendant longtemps, on a considéré la planète comme un système ouvert, inépuisable, où l'on pouvait sans risque prélever ce dont on avait besoin, et rejeter ce qui était nuisible. Cela a été notamment le cas pour l'eau.
Aujourd'hui, la pollution de l'eau, causée par les rejets industriels, les résidus de pesticides et d'engrais, et les eaux usées, est un problème majeur. Peu de pays, même industrialisés, assainissent toutes leurs eaux usées avant de les rejeter dans la nature.
De plus en plus, on comprend que l'eau n'est pas inépuisable. A la fin des années 1980 et au début des années 1990, par exemple, les États-Unis ou la France ont connu chaque été des problèmes de sécheresse qui handicapaient le travail des agriculteurs et obligeaient à des restrictions d'eau dans certaines régions.
L'eau est un bien très mal partagé : on consomme (toutes utilisations confondues : industries, agriculture, etc.) 4 000 litres par habitant et par jour aux États-Unis, 2 000 litres en Europe, et ... 40 litres en moyenne dans les pays les moins développés. Presque la moitié des habitants de la planète n'ont toujours pas accès à l'eau potable.
Source : L'État du monde Junior, La Découverte, 1992Document 2 : Combien ça coûte, l'eau ?
Prix facturé par le Service des Eaux de la SEMIDAO (Société d'économie mixte de l'Isle d'Abeau), pour un m3 d'eau consommé par un ménage en 1996 (hors TVA)
|
Eau (consommation, entretien du branchement et du compteur) |
4,45 F |
|
Taxe Fonds national d'adduction d'eau (*) |
0,14 F |
|
Redevance assainissement (**) |
4,75 F |
|
Redevance pollution (***) |
2,18 F |
Source : une facture d'eau en 1996.
(*) Taxe qui permet le financement de l'extension du réseau d'eau potable dans les communes défavorisées.
(**) Redevance qui finance l'amortissement et les dépenses de la station d'épuration.
(***) Redevance versée à l'Agence de l'eau (créée par la loi du 03/01/1992) pour le traitement des eaux usées, l'aménagement des ressources (barrages).
Document 3 : Evolution du prix de l'eau en France (en indices, base 100 en 1980)
|
|
1980 |
1984 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
|
Eau |
100 |
152,5 |
187,0 |
203,91 |
212,2 |
252,1 |
299,5 |
|
Ensemble des biens et services (*) |
100 |
151,5 |
173,7 |
184,0 |
194,4 |
201,8 |
208,9 |
(*) Indice INSEE des prix à la consommation
Source : INSEE Document 4
Nos auteurs du XVIIIe siècle aimaient à souligner les travers ou les incohérences de leur temps en laissant se promener dans la société des Candide, Huron ou autre Persan. Supposons donc, en piètres imitateurs, qu'un nomade de Mauritanie, qu'un habitant d'une mégalopole africaine ou encore un gamin de la bande de Gaza ou de la casbah d'Alger arrive chez nous. Imaginons sa surprise. Pas de sécheresse, des robinets partout, qui fonctionnent, et de l'eau à profusion. Une eau potable qui plus est (sauf dans les compartiments toilettes des trains), pour faire la vaisselle, prendre une douche, arroser le gazon, laver la voiture, nettoyer les trottoirs, ravaler les immeubles, fabriquer le ciment des murs... Quelquefois aussi pour étancher la soif, mais notre étranger remarque que les Français semblent souvent préférer boire une eau contenue dans des bouteilles capsulées. Il apprend que c'est là une spécialité hexagonale et même un record mondial. Il saisit alors son dictionnaire. Potable : "qui peut être bu sans danger pour la santé". Perplexité ! Heureusement, à la fin de la définition, il découvre qu'un autre sens, plus familier, coexiste depuis le XIXe siècle : "tout juste acceptable, passable sans plus". Il comprend alors ce que veut dire, dans les pays développés, l'expression : on n'arrête pas le progrès.
Source : Evelyne LATTANZIO, Textes et Documents pour la classe (T.D.C.) n° 677, 1er - 15 juin 1994, "L'eau potable, le temps des responsabilités", page 5. Document 5
Les technologies avec leur fiabilité et leurs progrès constants sont confrontées à deux défis majeurs.
Tout d'abord, on ne peut utiliser que l'eau dont on dispose. Or les ressources (fleuves, nappes, sources) restent les mêmes - sauf à parvenir à dessaler l'eau de mer - alors que les besoins sont en augmentation constante : dans les pays développés, parce que la consommation des ménages, des industriels et des agriculteurs continue à s'accroître, et, dans les pays en voie de développement, parce que la population augmente, notamment dans les grandes agglomérations.
D'où un second défi : maintenir en permanence la qualité de l'eau fournie alors que la concentration des hommes, le développement des activités humaines, industrielles et agricoles conduisent à polluer de plus en plus et à rejeter ensuite dans la nature les eaux usées qui n'ont pas été obligatoirement dépolluées (...)
Que se passe-t-il en amont du robinet ? Bien sûr, il faut procéder d'abord au prélèvement et au traitement, puis assurer la distribution. En France, comme un peu partout dans les pays développés, la responsabilité de l'alimentation en eau potable incombe aux communes qui, soit prennent en charge directement cette activité - on parle de régie directe -, soit la confient à des sociétés privées - on parle de concession ou d'affermage. En France, quatre sociétés distributrices desservent la plupart des communes et fournissent les trois quarts de l'eau potable. Les deux plus importantes, la Générale des eaux et la Lyonnaise des eaux-Dumez sont des leaders mondiaux de la distribution.
Source :Marie GRIMATZ, T.D.C. n° 677, pages 7 à 9.Document 6
Tout élément de la biosphère qui se dégrade ou disparaît représente donc deux choses dont il faut également tenir compte : des coûts monétaires dans la sphère économique et des fonctions qui cessent de s'accomplir dans le milieu naturel. La logique marchande permet d'appréhender plus ou moins la première de ces deux dimensions. Tout débat relatif à l' "internalisation"des coûts d'environnement (c'est à dire aux façons les plus conformes aux exigences de l'optimisation économique de les faire supporter par les agents qui les ont rejetés, "externalisés", sur la collectivité) est tout ce qu'on voudra sauf inutile. Alors faut-il taxer, subventionner, créer un marché des droits à polluer ? La réflexion ne peut être éludée.
Mais la logique marchande, ainsi reconstituée, ne saurait se confondre avec celle du réel. On a besoin aussi d'instruments non monétaires (bilans matières, bilans énergétiques, indicateurs de diversité...) pour éprouver les dimensions physiques, biologiques, chimiques ou informationnelles des phénomènes que les dérèglements en provenance de l'économie infligent à la biosphère. Il faut enfin définir les procédures pour articuler tout cela. La gestion normative sous contrainte s'attache précisément à définir les conditions d'un développement économique durable en interdépendance avec l'ensemble des ses environnements, sans réduire ces derniers à une pure logique marchande qui n'est pas la leur.
Source : René PASSET, professeur à l'université Paris I, dans Le Monde diplomatique de juin 1992
I. L'or des chambres de bonne
Recherche chambre désespérément... Les étudiants, baby‑sitters et autres apprentis en quête d'un logement bon marché (entendez « petit ») à Paris s'arrachent les cheveux. Rares, chers. assortis de garanties ou cautions, souvent à la limite de la légalité... sans oublier les placards microscopiques, éclairés d'une lucarne, pompeusement baptisés « studettes », loués à un prix exorbitant à un occupant ayant impérativement besoin de trouver un toit !
[...] Rive gauche, c'est encore pire : l'offre est moins abondante et les tarifs plus élevés. Le premier prix est un 14 mètres carrés à 1 900 francs dans le 15e, soit 135 francs le mètre carré. Les barres des 20 mètres carrés et des 2 000 francs sont ensuite joyeusement franchies.
Bien évidemment, des charges s'ajoutent aux sommes demandées et souvent le chauffage est individuel, c'est‑‑dire aux frais de l'occupant.
Françoise Vaysse, Le Monde. 28 avril 1992.
II. La cité de la joie
À présent, c'était une nouvelle sécheresse qui chassait vers Calcutta des milliers de paysans affamés.
L'arrivée de ces vagues successives de naufragés avait transformé Calcutta en une énorme concentration humaine. En quelques années, la ville allait condamner ses dix millions d'habitants à vivre sur moins de 317 mètres carrés chacun, les quatre ou cinq millions d'entre eux qui s'entassaient dans ses bidonvilles devant se contenter parfois d'à peine plus d'un mètre carré seulement. [...]
À cette époque, la Cité de la joie ne comptait qu'une dizaine de puits et de fontaines pour soixante‑dix mille habitants. [...j
Plus de soixante‑dix mille habitants s'y agglutinaient aujourd'hui sur un espace à peine trois fois plus vaste qu'un terrain de football. soit environ dix mille familles géographiquement réparties selon leur religion. [...]
Elle détenait [...] le triste record de la concentration humaine la plus forte de la planète : cent trente mille habitants au kilomètre carré.
Mais surtout, la Cité de la joie était un lieu où sévissait la plus extrême misère économique. Neuf habitants sur dix n'avaient pas une roupie par jour, quatre‑vingts centimes, pour s'acheter trois cents grammes de riz. [...]
Toutes les conditions v étaient réunies pour conduire ces anciens paysans à la déchéance : sous‑emploi et chômage chroniques, salaires effroyablement bas, travail inévitable des enfants, impossibilité d'épargner, endettement incurable avec mise en gage des biens privés et leur perte définitive à plus ou moins longue échéance : absence de toute réserve de nourriture et nécessité d'acheter en quantités infimes : dix centimes de sel,
vingt‑cinq centimes de bois, une allumette. une cuillerée de sucre ; manque absolu d'intimité : une seule pièce pour dix ou douze personnes.
D. Lapierre. La Ciré de la joie, Laffont. 1985.
III. Vingt-cinq roupies par mois
"Vous êtes bien sûr, Father, que c'est ici que vous voulez habiter ? demanda‑t‑il en examinant le visiteur avec incrédulité.
‑Tout à fait sûr, dit Paul Lambert. Quel est le montant du loyer ?
‑Vingt‑cinq roupies par mois (vingt francs). Payables d'avance.
‑Vingt‑cinq roupies ? s'indigna 1'Anglo‑Indien. Vingt-cinq roupies pour ce taudis sans fenêtre, c'est du vol !
D. Lapierre. op. cit.
I. Lisez attentivement le doc. "L'or des chambres de bonne", puis complétez le texte ci‑dessous à l'aide des mots suivants : rare, offre, demande, hausse, stagne, prix.
La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de logements pour étudiants à Paris est en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ En même temps, le nombre de chambres disponibles _ _ _ _ _ _ _ _ et ce type de logement devient _ _ _ _ _ _ Il en résulte que la _ _ _ _ _ _ _ _ de chambres devient supérieure à l' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et que les _ _ _ _ _ _ _ _ des chambres sont en forte _ _ _ _ _ _ _ _
II. Comment expliquer la concentration de l'habitat dans la Cité de la joie !
III. Expliquez les différents aspects de la « misère économique » de ses habitants.
IV. Le prix du logement de Paul Lambert est‑il élevé ? Pourquoi ? (doc. "25 roupies par mois")
$$$$$fiches 76 et svtes
I. Les secteurs institutionnels
Dans quels secteurs institutionnels - ménages (M), sociétés et quasi-sociétés (SQS), administrations publiques (APU), administrations privées (APRI), institutions financières (IF), entreprises d'assurance (EA)- faut-il classer les unités institutionnelles suivantes ?
· Une entreprise individuelle
· Une entreprise dont le capital est réparti entre plusieurs associés
· Des religieux vivant dans un monastère
· La Poste
· La Banque Nationale
· Une mairie
· Un syndicat
· Un célibataire vivant seul
· Une caisse mutuelle de retraite
· Un collège
II. Complétez le tableau ci-dessous en utilisant les expressions suivantes (plusieurs expressions peuvent être utilisées pour un même secteur institutionnel) :
Colonne "fonctions principales"
· produire des biens et services marchands
· collecter l'épargne et prêter des fonds
· production de services non marchands destinés à la collectivité
· production de services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages
· circulation et création de moyens de paiements
· vente sans but lucratif de services destinés aux ménages
· consommation finale de biens et services
· redistribution des revenus
· indemnisation des sinistres.
Colonne "ressources principales"
· prélèvements obligatoires (>50 %)
· contributions volontaires des membres (>50 %)
· ventes de la production (>50 %)
· revenus d'activité et de transferts
· épargne collectée et emprunts contractés
· primes ou cotisations volontaires
· Secteurs institutionnels
|
|
Fonctions principales |
Ressources principales |
|
Ménages |
|
|
|
Sociétés et quasi-sociétés |
|
|
|
Administrations publiques |
|
|
|
Administrations privées |
|
|
|
Institutions financières |
|
|
|
Entreprises d'assurance |
|
|
III. Oui / Non et justification
Une filiale d'une société étrangère installée en Belgique fait partie du Reste du monde ?
Une filiale d'une société belge installée à l'étranger fait partie du Reste du monde ?
IV. Biens et services
Quelle est la différence entre un bien et un service ?
Donnez un exemple de bien :
.." " .de service marchand :
Un service fait partie de la production non marchande lorsqu'il est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou lorsqu'il est vendu à un prix _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à son _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Donnez trois exemples de services non marchands :
Indiquer dans ces opérations celles qui sont de consommation finale [C.F.], de consommation intermédiaire [C.I.], ou de formation brute de capital fixe [FBCF] :
· achat d'une automobile par un ambulancier
· achat d'une automobile par un particulier
· achat d'un essuie-glace par un particulier
· achat d'un essuie-glace par un garagiste
· achat d'une place de parking par un ménage
Qu'est-ce que l'amortissement du capital fixe ?
Complétez : investissement brut = investissement + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indiquez dans les opérations ci-dessous s'il s agit d'opérations sur biens et services [OBS], d'opérations de répartition [OR] ou d'opérations financières [OF] :
· paiement de l'impôt sur les bénéfices :
· règlement à un fournisseur
· importation
· dépôt de monnaie à un CCP
· paiement de droits de douane
· remboursement de soins médicaux
· versement d'un salaire à un travailleur
· achat à crédit d'un téléviseur par un ménage (deux opérations)
· achat d'un journal financier
V. Les facteurs de production
Julie et Christophe, après leurs études de sciences économiques, et une longue pratique de théâtre amateur, décident de fonder leur propre compagnie. Ils parviennent à réunir la somme de 600 000 F sur leurs économies et avec l'aide de parents et d'amis. Ils achètent et aménagent pour 300 000 F une grange et se procurent 150 000 F de matériels (projecteurs, sono...). Ils obtiennent, pour 50 000 F, les droits d'exclusivité sur le montage d'une pièce écrite par un auteur contemporain. Les frais engagés pour leur premier spectacle comprennent en outre : affiches et publicité (10 000 F), costumes (40 000 F), location d'une camionnette (30 000 F), location d'une salle (50 000 F), fournitures diverses (20 000 F).
Ils engagent trois comédiens pour compléter la distribution, et leur avancent 50 000 F chacun. La commune où ils résident leur attribue une subvention de 150 000 F, en contrepartie d'une animation dans les écoles. Le soir de la seconde représentation ils font leurs comptes : 300 spectateurs ont payé leur place 600 F.
Complétez le tableau, pour vérifier si la compagnie a atteint son équilibre d'exploitation. Justifiez.
|
Capital (au sens juridique) Capital fixe : dont - immatériel : - matériel : Chiffre d'affaires : Autres recettes : Coûts de production : dont - rémunération du facteur travail : - consommations intermédiaires : Bénéfices :
|
|
I. Le circuit économique de Quesnay
En 1758, François Quesnay publie le "tableau économique d'ensemble".
Il part de l'exemple suivant :
"Supposons qu'un grand royaume dont le territoire porté à son plus haut degré d'agriculture rapporterait tous les ans une production de la valeur de 5 milliards [...] Dans ce royaume. la vie économique est constituée par les échanges entre trois classes : la "classe productive"des agriculteurs, la classe des propriétaires fonciers et la classe que Quesnay appelle "stérile"(essentiellement des artisans).
Quesnay décrit les opérations suivantes :
- les agriculteurs produisent donc 5 Mds. Ils doivent louer les terres aux propriétaires 2 Mds. ils conservent 2 Mds (pour leur subsistance et l' "avance annuelle"en semences pour l'année suivante), et font 1 Md d'achats de produits artisanaux.
- les propriétaires achètent pour 1 Md de produits agricoles et pour 1 Md de produits artisanaux ;
- les artisans vendent pour 1 Md aux agriculteurs, 1 Md également aux propriétaires. Ils achètent aux agriculteurs 1 Md de nourriture et 1 Md de matières premières.
Complétez à l'aide de ces chiffres le circuit économique :
Complétez, avec les mêmes chiffres, le tableau ci-dessous.
Vérifiez que chaque classe reçoit autant qu'elle dépense, à l'aide de la ligne et de la colonne Total
|
Achats (entrées de produits) Ventes (sorties de produits) |
Agriculteurs |
Propriétaires |
Artisans |
Total ventes |
|
Agriculteurs
Propriétaires
Artisans
|
2
_ _ _ _
_ _ _ _ |
1
0
_ _ _ _ |
_ _ _ _
0
0 |
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ |
|
Total achats |
_ _ _ _
|
_ _ _ _ |
_ _ _ _ |
_ _ _ _ |
Aide :
ce tableau est présenté sous la forme d'un TES (tableau d'entrées-sorties. voir fiche n"12).
Première ligne (ventes ou sorties) : la classe des agriculteurs vend à elle même 2 Mds de produits, correspondant à son intraconsommation ; elle vend le reste de sa production aux deux autres classes, dont 1 Md aux propriétaires.
Première colonne (achats ou entrées) : les agriculteurs, outre leur intraconsommation. doivent payer la location de leurs terres aux propriétaires. et l'achat de produits artisanaux.
II. Construction d'un circuit économique détaillé
La Syldavie, pays imaginé par Hergé, sert de cadre à l'exercice suivant. On supposera que sa population est le dixième de celle de la Belgique, et que sa monnaie, le khor (Kh). vaut 0,50 F. Les chiffres sont choisis de sorte qu'en les multipliant par une constante, on obtienne un ordre de grandeur des opérations sur biens et services de l'économie belge en 1992.
Les entreprises regroupent l'activité marchande des sociétés et quasi-sociétés et des entreprises individuelles ; on ne décrit pas la production non marchande des administrations.
|
LES OPÉRATIONS DE L'ÉCONOMIE SYLDAVE (milliards de Kh) |
|
Opérations (marchandises) sur biens et services |
|
PVE Production vendue par les entreprises 2 180 CIE Consommations intermédiaires des entreprises 1 040 CFM Consommation finale des ménages 840 FBCFE Formation brute de capital fixe des entreprises 160 FBCFM Formation brute de capital fixe des ménages 50 FBCFA Formation brute de capital fixe des administrations 90 M Importations 320 X Exportations 320
|
|
Opérations de répartition |
|
RAM Revenus d'activité versés aux ménages par les entreprises 720 RPM Revenus dé la propriété versés aux ménages par les entreprises 170 TSFM Transferts sociaux reçus par les ménages 340 PVTM Prélèvements obligatoires versés par les ménages 300 PVTE Prélèvements obligatoires versés par les entreprises 100
|
|
Opérations financières |
|
PLM Placements des ménages 40 EMPE Emprunts des entreprises auprès des institutions financières 10 EMPA Emprunts des administrations auprès des institutions financières 30
|
· Construisez le circuit détaillé de l'économie syldave, à partir des chiffres ci-dessus, en reliant les secteurs institutionnels et les marchés par des flèches. Ne décrivez que des flux monétaires : le sens d'une flèche doit correspondre au sens de la circulation de la monnaie. Précisez le long de chaque flèche le symbole et le montant de l'opération correspondante.
· Vérifiez l'équilibre des flux de ressources (entrées de monnaie) et d'emplois (sorties de monnaie) pour :
1. les ménages :
2. les entreprises :
3. les administrations :
4. les institutions financières :
· Vérifiez l'équilibre entre les achats et ventes sur l'ensemble des marchés : ....
· Utilisation du circuit : imaginez les différentes conséquences possibles d'une hausse de 10% des revenus d'activité ménages sur les différentes opérations retracées dans le circuit.
Attention :
· Toutes les ventes passent par les marchés.
· Le Reste du monde ne doit être relié qu'aux marchés.
· Veillez à placer les flèches dans le bon sens (circulation de la monnaie).
· Pour une meilleure présentation de votre travail. évitez de superposer ou d'entrecroiser vos flèches.
$$$$1 fiches 29 et 30
$$$$1 fiche 39 (partie) pour ci-dessous
♦ Évaluation des connaissances et des savoir-faire |
3 = oui_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 = à peu près... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 = pas encore!
Pensez‑vous maîtriser les savoirs et savoir‑faire suivants ?
‑Savoirs :
besoins primaires et secondaires_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
origine sociale des besoins_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lien entre rareté, besoins, ressources_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lien entre rareté et travail_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
offre, demande_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
définition de la science économique_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
définition des sciences sociales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‑Savoir-faire :
étapes de l'analyse d'un texte_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
en particulier : sélectionner les idées principales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
... et les classer_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Selon les économistes, la satisfaction des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est vitale, celle des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ apporte un mieux‑vivre.
En Belgique, aujourd'hui, nous avons besoin de fourchettes et de couteaux pour manger. Donnez deux exemples de sociétés ne les employant pas : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cela prouve l'origine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de nos besoins.
Donnez un exemple de ressource :
a) rare dans la société traditionnelle, abondante aujourd'hui :
b) abondante dans la société traditionnelle, rare aujourd'hui :
Complétez : Le travail a pour objet la _ _ _ _ _ _ _ _ _ des ressources naturelles en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ destinés à la satisfaction de nos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En dehors de la sécheresse, des facteurs économiques, sociaux ou politiques peuvent expliquer la pénurie alimentaire de certains pays en développement. Donnez‑en des exemples :
a) économique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) social : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c) politique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le prix de l'eau courante devrait augmenter dans les années à venir car :
- raison 1 : son _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de production augmente en raison de la pollution.
- raison 2 : la _ _ _ _ _ _ _ _ _ d'eau tend à être supérieure à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d'eau.
Quels sont les 4 éléments d'une définition de la science économique ?
a)
b)
c)
d)
La science économique fait‑elle partie des sciences sociales ? Oui/Non
Pourquoi , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Âge de pierre, âge d'abondance
Est‑il à ce point paradoxal de soutenir qu'en dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs' connaissent l'abondance ? [...] Les chasseurs‑collecteurs ont, par la force des choses, un niveau de vie objectivement bas. Mais si tel est leur objectif, et s'ils disposent de moyens de production suffisants, leurs besoins matériels peuvent généralement être satisfaits sans peine. [...] Bien que richement dotées, les sociétés capitalistes modernes se vouent elles‑mêmes à la rareté. (Si vous achetez une voiture, une Plymouth par exemple, vous ne pouvez pas avoir aussi une Ford... et il me semble, à en juger par les programmes publicitaires de la télévision américaine, que les frustrations encourues ne sont pas seulement d'ordre matériel.) C'est nous, et nous seuls, qui avons été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. [...]
M. Sahlins. Âge de pierre, âge d'abondance, Gallimard, 1976.
= Soulignez dans le texte ses deux idées principales.
= D'après ce texte, notre société connaît‑elle l'abondance ?
= Comment peut‑on critiquer le raisonnement de l'auteur ?
615.31
Montant T.T.C. (toutes taxes comprises) : l'État prélève la T.V.A.
(taxe sur la valeur ajoutée) au taux de 6 %.
Location compteur : montant fixe.
Facturation eau : dépend du volume d'eau consommée
(ici le tarif augmente au‑dessus de 72 m)).
Taxe F.N.D.A.E. (Fonds national d'adduction d'eau) : permet le financement de l'extension du réseau d'eau potable dans les communes défavorisées
Redevance assainissement : finance l'amortissement et les
dépenses de la station d'épuration.
Redevance d'affermage : versée à l'entreprise à laquelle la commune a confié l'exploitation du réseau.
Redevance d'agence de bassin (appelée Agence de l'eau depuis la loi du 3.1.92), elle comprend :
‑la redevance pollution pour le traitement des eaux usées, l'aménagement des ressources (barrages) ;
‑la redevance prélèvement dépend de la rareté de l'eau dans le site où elle est prélevée.
eau
consommation en eau. entretien du branchement et du compteur
en % des dépenses totales
Agence de l'eau
redevance prélèvement
redevance pollution
FNDAE
fonds national d'adduction d'eau
assainissement collecte. dépollution des eaux usées
Science et Vie Économie, n° 66. novembre 1990.
|
Idée méthodologique : Vous pouvez vous servir d…. |
♦ Voir aussi... |
Ouvrages de référence :
Denis Clerc, Déchiffrer l'économie, Syros Altematives, 1991.
J.-M. Albertini, les Rouages de l'économie nationale, Éditions ouvrières 1987.
John K. Galbraith, Nicole Salinger, Tout savoir ou presque sur l'économie, Points-Seuil, 1981 .
'Revues :
Alternatives économiques, revue destinée tout particulièrement aux élèves de sciences économiques et sociales.
Regards sur l'actualité (Documentation française) : fait chaque mois le tour des principaux événements et examine quelques dossiers.
Problèmes économiques (Documentation française) : chaque semaine sur un thème précis, un recueil d'articles de la presse économique spécialisée.
Albums :
Uderzo, Goscinny, Obélix et Compagnie, Albert-René 1976, ou comment Jules César tente de convertir les Gaulois à l'économie de marché.
Les albums de Plantu, publiés régulièrement par Le Monde - Éditions : comment l'actualité provoque humour, colère ou compassion.
Jeux :
1. Comprendre les mécanismes de base de l’économie d’entreprise , livre / jeu de rôle publié en 1995 par European training Institute, Yserstraat 30b/020, 8400 Ostende, tél. : 059/70 78 41
¤ Consommation : les enfants aux mains des marchands in Enfants d’abord n° 208 - janvier 1997 - pages 30 à 40
¤ Vie de l’entreprise : j’échange donc je vis. Quand le troc deviens un moyen de gestion des entreprises S. KALIISZ in Eco-Soir n° 251 - 25/10/96 - page 14
¤ Le troc à la rescousse J. SLOOVER in Eco-Soir n° 221 - 20/09/96 - page 8
¤ La productivité, une obsession. L’entreprise confrontée à un choix de ... société M. VANESSE in Eco-Soir n° 280 - 02/12/94 - page 2
¤ Revenu, consommation et épargne des ménages in Problèmes économiques n° 2533 - 10/09/97 - pages 13, 14 et 15
¤ 1000 jours pour inventer de nouveaux échanges M. AUTHIER in Ça m’intéresse n° 194 - avril 1997 - page 84 et 85.
¤ Le travail : vers un nouveau partage in Actualquarto n° 7 - Décembre 1993
¤ Mieux vaut être riche et consommateur in Le Ligueur n° 15 - 09/04/97 pages 4 et 5
¤ Le troc, ce vieux truc V. LEONARD in Le Vif/l’Express n° 46 - 14/11/97 - pages 40 et 41
¤ Troc : trucs et astuces in Le Ligueur n° 14 - 05/04/95 - page 20
¤ « Le troc, un truc d’entraide in Le Ligueur n° 4 - 02/02/90 - page 20
¤ La productivité J-F. RAMQUET in Bulletin du FAR n° 209/2 - pages 31 à 34
¤ Pas de file aux caisses in La Libre Belgique, La Libre Entreprise n° 4 - pages 4 à 7
¤ Troc c’est du belge T. Bo. in La Libre Belgique, la Libre Economique - 13/03/98 - page 15
Proposition d’exploitation
Texte : « Le troc, ce vieux truc V. LEONARD in Le Vif/l’Express n° 46 - 14/11/97 - pages 40 et 41
1. En t’aidant du contexte, recherche la définition des termes suivants :
- coutume ancestrale
- mettre en exergue
- assidu
- éolienne
2. Que troque-t-on ?
3. Qui a recours au troc ?
4. Qu’est-ce que le RES ?
5. Quel est le but poursuivi par le RES ?
6. SEL. Explique en quelques mots de quoi il s’agit.
7. Explique cette phrase : « le troc, un mode de réinsertion sociale
8. Le troc est-il reconnu par la loi ? Explique
♦ Ce que les programmes en disent... |
- Économie : sa nature p. 11
“Quels problèmes les sciences économiques s’attachent-elles à résoudre ?”
- “Peut-on facilement satisfaire nos besoins ?”
- “Comment arrive-t-on à satisfaire des besoins multiples en partant de ressources trop peu abondantes ?”
- Les différentes formes de l’entreprise et leurs caractéristiques essentielles, leurs avantages et leurs inconvénients.
- Notions du chiffre d’affaire, de bénéfice brut, de bénéfice net et de marge bénéficiaire.
Le prix de revient comporte deux éléments principaux: les frais directs et les frais indirects.
♦ Table des matières détaillée |
Les biens meubles et immeubles // les autres distinctions que fait la loi
les droits
Introduction // Définition du droit de propriété
Possession et détention //Droits que confèrent la propriété // Les limites du droit de propriété // La copropriété // Les différentes façons d'acquérir la propriété
Introduction // Définition de l'usufruit
Droit de l'usufruitier // Sources de l'usufruit
Les ménages // Les sociétés et quasi-sociétés non financières // Les administrations publiques// Les administrations privées // Les institutions financières //Les entreprises d'assurance(s) // Le reste du monde
Les opérations de répartition // Les opérations financières // Les administrations publiques//
Les sociétés de personnes // Les sociétés de capitaux // Les sociétés mixtes
La société en commandite simple // La société en commandite par actions // La société coopérative :// La société en nom collectif : // La société privée à responsabilité limitée : // La société anonyme :
Du chiffre d'affaires au profit // L'environnement concurrentiel de l'entreprise // L'organisation du travail
La combinaison productive // La productivité // Les gains de productivité
TdM Bis
[1]Émile Durkheim, "Les règles de la méthode sociologique", 1894 ou 1895
Durkheim ramène les faits moraux aux faits sociaux, qu'il considère comme indépendants des consciences individuelles. Un des fondateurs de la sociologie.
[2] d'après une idée de M.T. Popeler, Syllabus Éco 3TT, 1990
[3] évitons les définitions de M. Francis Boulanger qui prétend :
· qu'un bien de consommation se consomme tel quel (comme le tracteur du fermier, l'œuf ou le steak que je mange cru ou le stéthoscope du médecin [J]) ou
· qu'un bien de production sert à fabriquer un autre bien (comme le beurre qui sert à frire mon steak ou l'œuf acheté pour en faire une omelette [J])
[4] Claude Lévy-Strauss, "Tristes tropiques", Plon, Coll. Terre humaine, 1955
[5] J. et F. Fourastié, "Les écrivains témoins du peuple", J'ai lu, 1964
[6] Marshall Sahlins, "Âge de pierre, âge d'abondance", Bibliothèque des sciences humaines, Gallimard, 1976
[7] Raymond Aron, "Les étapes de la pensée sociologique", Paris, Gallimard, 1967
[8] Bertrand de Jouvenel, "Arcadie, essais sur le mieux-vivre", SEDES, 1968
[9] Jean Fourastié, "Pourquoi nous travaillons"
[10] Paul Samuelson, "L'Économique", T 1, Armand Colin, coll. U, 1965
[11] Raymond Barre, "Économie politique", tome 1, P.U.F., 1980
[12] Jacques Lizot, "Éléments d'ethnologie", Armand Colin, 1975
J.-M. Bouguereau, "les dernières tribus", dir. J F Held, Flammarion, 1988
J M Tjibaou, "Etre mélanésien aujourd'hui", Esprit, sept 1981
|
Des liens ne fonctionnent plus ? |
|
Retour à la page d'accueil de CUY = See you why ?
![]()
Compteur gratuit